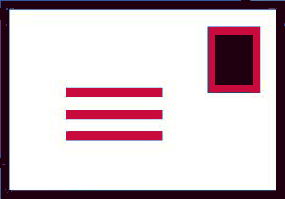Les
dernières années du séjour de Trotsky à
Prinkipo sont dominées par la bataille engagée par
l'exilé pour provoquer un redressement de la politique du
Parti communiste allemand et de l'Internationale communiste devant la
mortelle menace, toujours plus précise, du nazisme et la
marche de Hitler au pouvoir.
Pour
la deuxième fois dans le siècle commence une bataille
qui constitue pour les révolutionnaires l'épreuve de
vérité. L'Allemagne est alors toujours le pays
capitaliste le plus développé d'Europe. Elle a déjà
été ravagée une première fois en 1923 par
une terrible inflation qui a bouleversé la société,
opposant la masse uniformément paupérisée des
travailleurs de toutes catégories à une poignée
de magnats. La crise économique et sociale déclenchée
en 1929 a déchaîné sur le pays une vague de
chômage sans précédent à l'époque :
plus de 5 millions de sans-emploi complets officiels en 1932, autant
de chômeurs partiels, 2 millions de chômeurs non
inscrits. La totalité des jeunes, indépendamment de
leur origine sociale, sont sans travail, sans perspective d'emploi
avant de longues années. La petite et la moyenne bourgeoisie
ne sont pas moins frappées et s'exaspèrent de leur
paupérisation, de leur « prolétarisation »,
et de ce qu'elles considèrent comme « l'humiliation
nationale » consécutive à la défaite
et à la paix de Versailles.
Trotsky
analyse :
« Dans le langage de
la
psychologie sociale, cette tendance politique peut être décrite
comme une hystérie épidémique de désespoir
parmi les classes moyennes : les petits commerçants
ruinés, les artisans et les paysans ; en partie aussi.
les prolétaires en chômage; les employés et les
anciens officiers de la Grande Guerre. qui portent encore leurs
décorations, mais sans toucher de solde ; les employés
des bureaux fermés, les comptables des banques en faillite,
l'ingénieur sans emploi, le journaliste sans salaire, le
médecin dont les clients sont encore malades, mais ne savent
comment le payer2. »
Apparu
pour la première fois au premier plan de l'actualité en
Bavière lors de la crise de 1923, le Parti national-socialiste
surgit de nouveau avec la crise et progresse de façon
foudroyante : de 809 000 voix et 13 députés
en 1928, il passe à 6 401 000 voix et 105 députés
en 1930, 13 417 000 voix aux élections
présidentielles d'avril 1932, 12 732 000 et 280
députés en juillet suivant. Contre Versailles, il fait
appel aux sentiments chauvins et revanchards. Disposant de moyens
financiers et matériels considérables, d'un noyau
d'anciens militaires formés dans la violence guerrière
et la brutalité, bénéficiant d'appuis importants
dans l'appareil d'Etat - l'armée qui entrepose ses armes, la
police qui laisse filer ses hommes de main -, il exploite le
désespoir des classes moyennes, la frustration de la jeunesse,
joue adroitement de l'anticapitalisme, alimente l'antisémitisme
pour se poser finalement à la fois en apôtre du
« socialisme allemand » et en parti de l'ordre
face au communisme.
En
dehors des déclamations chauvines et démagogiques, la
solution préconisée par le national-socialisme - on dit
nazisme et aussi, souvent, fascisme par analogie avec l'Italie - est
de sortir de la crise d'abord en remettant en cause toutes les
conquêtes et institutions ouvrières, ensuite en
relançant l'économie par une politique d'armement au
terme desquelles se trouvent la guerre et la conquête de
nouveaux marchés. Dans l'immédiat, la politique des
nazis passe par la destruction du régime parlementaire,
incapable d'imposer les mesures radicales qu'elle préconise,
et par l'anéantissement du mouvement ouvrier organisé,
partis et syndicats, qu'ils soient
« révolutionnaires »
ou « réformistes ».
La
guerre civile des nazis est donc une guerre de classe qu'ils mènent
dans le mouvement même de leur lutte pour la conquête du
pouvoir, à travers harcèlement et agressions
quotidiennes contre les locaux, les permanences, les vendeurs de
journaux ouvriers, les assauts et la dispersion violente des réunions
publiques, les attaques contre les responsables. Dans cette campagne,
tout leur est bon, y compris les rancunes de certains secteurs
ouvriers contre les bureaucraties syndicales - les
« bonzes »,
comme disent les ouvriers et les communistes - et les rancœurs
soulevées ici ou là par les méthodes des
dirigeants communistes.
Social-démocrates
et communistes sont menacés au même titre par cette
entreprise. Ils ont également en commun de la minimiser. Les
social-démocrates, dénonçant, sur le même
pied, le danger nazi et de ceux qu'ils appellent par analogie les
« kozis » - communistes -, se font les
champions de l'Etat démocratique en pleine décomposition
et lui confient la mission d'interdire, voire de réprimer les
activités antidémocratiques des « extrémistes »,
de droite et de gauche.
Les
communistes, de leur côté, se sont lancés, depuis
le VIe congrès et surtout à partir du Xe plénum
de l'exécutif de l'I.C. en juillet 1929, dans l'absurde
théorie dite du « social-fascisme ».
C'est devant cette dernière instance que Manouilsky. l'homme
de Staline dans l'I.C., a assuré que la social-démocratie
allait prendre de plus en plus l'initiative de la répression
contre la classe ouvrière et « se fascisera ».
Il parle même de la « transformation de la
social-démocratie en social-fascisme» - dont Béla
Kun entreprend aussitôt de démontrer le caractère
« nécessaire ». Dans le même
temps, les services spécialisés et les groupes de choc
du Parti communiste allemand démontrent à chaque
occasion que les communistes ne répugnent pas à la
violence contre ceux qu'ils dénoncent...
L'analyse
selon laquelle il n'y a aucune différence entre la
social-démocratie et le fascisme, qui aboutit à la
théorie de l'existence d'un « social-fascisme »,
est aux yeux de Trotsky extrêmement dangereuse. Elle s'oppose
en effet radicalement à l'idée - communément
acceptée et démontrée par l'évidence des
faits -, selon laquelle le « fascisme » est un
danger majeur pour l'ensemble du mouvement ouvrier. Elle ouvre aussi
la voie à l'autre idée selon laquelle la victoire du
fascisme et l'écrasement de la social-démocratie, sa
disparition en tant que force politique, deviendraient en quelque
sorte la condition de la levée du principal obstacle sur la
route vers la victoire du communisme. Tout en rassurant les
militants, en leur promettant que le tour des communistes viendra,
après Hitler, Manouilsky pontifie : « Dans de
nombreux pays hautement développés, le fascisme sera le
dernier stade du capitalisme avant la révolution sociale3. »
Trotsky,
lui, dans son analyse de la situation allemande, insiste beaucoup sur
ce qu'il considère comme le plus précieux du capital
théorique de l'Internationale communiste, élaboré
du temps de Lénine, et que ses successeurs sont en train de
fouler aux pieds. Il s'agit en particulier de la politique de lutte
pour la constitution, face au nazisme menaçant, d'un front
unique ouvrier avec au premier chef les partis socialiste et
communiste. Seule une telle unité contre Hitler,
souligne-t-il, peut permettre aux travailleurs d'abattre cet
adversaire fort de leurs divisions.
Or
les dirigeants du parti allemand assurent qu'ils sont partisans d'un
tel front unique. Mais ils repoussent par principe tout accord avec
les dirigeants du Parti social-démocrate, qu'ils appellent
avec mépris le « front unique au sommet »,
qu'ils jugent opportuniste. Selon eux, le front unique doit se
réaliser à la base, c'est-à-dire contre les
dirigeants socialistes au départ. Trotsky ironise férocement :
« Dans l'appel de la Rote
Fahne (28 janvier), le dernier qui me soit parvenu, on
démontre
encore une fois qu'il n'est permis de faire le front unique que
contre les chefs social-démocrates et sans eux. Pourquoi ?
Parce que "personne de ceux qui ont vécu l'expérience
des dix-huit dernières années et qui ont vu ces 'chefs'
à l'œuvre ne les croira plus". Et qu'adviendra-t-il,
demandons-nous, de ceux qui sont dans la politique depuis moins de
dix-huit ans et même depuis moins de dix-huit mois ?
Depuis le début de la guerre, plusieurs générations
politiques se sont élevées qui doivent faire
l'expérience de la vieille génération, ne
serait-ce qu'à une échelle réduite. "Il
s’agit précisément - enseignait Lénine aux
ultra-gauchistes - de ne pas prendre l'expérience vécue
par nous pour celle qu'a vécue la classe, qu'ont vécue
les masses"4. »
La
politique qu'il préconise, c'est de s'adresser aux ouvriers
social-démocrate et de leur dire:
« Puisque vous
acceptez d'une
part de lutter en commun avec nous et que, d'autre part, vous ne
voulez pas rompre avec vos chefs, nous vous proposons :
obligez-les à commencer une lutte commune avec nous pour tels
ou tels buts pratiques par telles ou telles voies ; quant à
nous, communistes, nous sommes prêts. »
Il
ajoute :
« Que
peut-il y avoir de plus simple, de plus clair et de plus
convaincant ? C'est précisément dans ce sens que
j'écrivis - avec l'intention préméditée
de provoquer le sincère effroi ou la feinte indignation des
imbéciles et des charlatans - que, dans la lutte contre le
fascisme, nous sommes prêts à passer des accords
pratiques avec le diable, avec sa grand-mère et même
avec Noske et Zörgiebel5
*. »
Rappelant
qu'en Allemagne, des millions d'ouvriers votent pour la
social-démocratie et tolèrent la bureaucratie
réformiste des syndicats, il revient sur le passé de
l'Internationale pour caractériser ceux qui combattent contre
une politique de « front unique ». Sa critique
est ravageuse. Il écrit :
« De fait, sous cette
crainte
que l'on prétend "révolutionnaire", du
"rapprochement" (avec les socialistes), se dissimule au
fond une passivité politique qui tend à conserver un
état de choses dans lequel les communistes, comme les
réformistes, ont chacun leur cercle d'influence, leurs
auditoires, leur presse et dans lequel cela suffit à donner
aux uns et aux autres l'illusion d'une lutte politique sérieuse.
Dans la lutte contre le front unique, nous voyons une tendance
passive et indécise de l'intransigeance verbale masquée
[...]6. »
Il
explique :
« Le Parti communiste
compte
dans cette lutte avec l'état réel de la classe ouvrière
à chaque moment donné : il s'adresse non seulement
aux masses, mais aussi aux organisations dont la direction est
reconnue par les masses : il confronte aux yeux des masses les
organisations réformistes avec les tâches réelles
de la lutte de classes. En révélant effectivement que
ce n'est pas le sectarisme du Parti communiste, mais le sabotage
conscient de la social-démocratie qui sape le travail commun,
la politique du front unique accélère le développement
révolutionnaire de la classe. Il est évident que ces
idées ne peuvent en aucun cas vieillir7. »
Ce
n'est pas le premier combat qu'il livre pour défendre, contre
le stalinisme, ce qu'il considère comme les acquis de
l'Internationale communiste en ses premiers congrès :
ceux qu'ils clouent ainsi au pilori considèrent pourtant ses
arguments, inspirés par la haine de leurs dirigeants ou la
« pression de la social-démocratie » et
de « l'impérialisme », comme nul et non
avenus.
*
* *
Pour
Trotsky, dont on connaît l'analyse de l'époque de
l'impérialisme, c'est la révolution allemande qui est
mise à l'ordre du jour de l'histoire en même temps que
la contre-révolution incarnée par le nazisme. La crise
de ce pays capitaliste avancé pose une fois de plus
l'alternative déjà proclamée par la guerre
mondiale : socialisme ou barbarie. Face aux nazis, porteurs en
définitive de la solution du grand capital et incarnation de
la barbarie, les communistes ont la possibilité, en entraînant
dans des actions communes de défense et de front unique les
organisations social-démocrates, de devenir les dirigeants
reconnus des masses et d'avancer vers le socialisme.
Le
parti communiste allemand est sans doute le plus important
numériquement à cette époque en dehors du P.C.
de l'Union soviétique, mais il est loin d'être le plus
sain et le plus solide. Un régime interne autocratique, les
zigzags de sa politiqué ont contribué déjà
à écarter de lui les éléments ouvriers
les plus solides et les plus capables d'un travail militant
systématique. L'application à l'Allemagne de la ligne
de la « troisième période » a
aggravé cette situation. Le K.P.D. est un parti de tout jeunes
gens et de chômeurs, un parti de marginaux, de révoltés
plus que de révolutionnaires comme le note Simone Weil, en
tout cas un parti-passoire qui se renouvelle constamment. Sa
politique de création de « syndicats rouges »
a contribué aussi à le couper des travailleurs dans les
entreprises. Le parti social-démocrate est, aux yeux de ses
membres, moins un parti de frères de classe égarés
qu'un parti ennemi, un adversaire de classe : ses dirigeants,
d'ailleurs, savent mettre opportunément l'accent sur le sang
qui les sépare depuis l'assassinat de Liebknecht et de Rosa
Luxemburg en janvier 1919 jusqu'aux fusillades de Berlin le 1er
mai 1929 sur l'ordre du préfet social-démocrate
Zörgiebel. Toutes ces conditions font que les membres du parti
ne tenteront guère de résister à la théorie
du « social-fascisme ».
Toute
la politique du Parti communiste allemand, le K.P.D., est donc axée,
conformément aux directives de Moscou, sur une violente
dénonciation permanente des dirigeants social-démocrates :
ces derniers disposent ainsi en permanence, vis-à-vis de leurs
troupes, d'un alibi de poids pour interdire toute action commune avec
leurs « insulteurs ». Simultanément, le
Parti communiste se livre avec le Parti nazi à une véritable
surenchère sur le terrain de sa politique, menant grand bruit
autour du mot d'ordre commun de « libération
nationale» ou reprenant à son compte le mot d'ordre nazi
de «révolution populaire ». Adversaire
farouche des socialistes, il en arrive à se comporter souvent
comme un allié de fait du Parti nazi tant par sa politique
générale que par certaines de ses violences contre
militants ou réunions socialistes ou oppositionnels.
Le
premier éclat spectaculaire en ce sens a lieu lors du
référendum organisé le 8 août 1931 en
Prusse à la demande des nazis qui veulent obtenir la
révocation du gouvernement social-démocrate de minorité
et font de cette consultation le « plébiscite
brun ». Le K.P.D. appelle, lui aussi, à voter pour
le départ du gouvernement social-démocrate, mais parle,
lui, de... « plébiscite rouge » !
En juillet, lors du XIe plénum de l'exécutif,
Manouilsky avait présenté ce qu'il appelait une
justification « théorique » de cette
politique en s'inscrivant en faux contre le « mensonge
social-démocrate » selon lequel le fascisme serait
l'ennemi principal de la classe ouvrière.
En
1932, le K.P.D. recueille 5 277 000 voix et 100
députés,
la moitié de ce qu'ont obtenu les nazis. Il dissout ses
groupes de combattants qui, les années précédentes,
affrontaient dans la rue les groupes nazis armés. Le XIIe
plénum soutient la nécessité de diriger d'abord
les coups contre la social-démocratie. En novembre 1932, du
fait de leur politique anti-social-démocratie, les communistes
se font déposséder par les nazis de la direction d'une
grève des transports déclenchée à Berlin
contre la volonté des « bonzes»
social-démocrates, et un de leurs dirigeants assure que les
communistes se rapprochent tous les jours de leur objectif,
« la
conquête de la classe ouvrière »...
*
* *
Trotsky
aborde la question de l'Allemagne à Prinkipo pour la première
fois après les élections au Reichstag de 1930. Après
avoir relevé que les hésitations de la grande
bourgeoisie sont « le symptôme le plus manifeste
d'une situation prérévolutionnaire », il
rappelle qu'une des conditions pour qu'une crise sociale débouche
sur la révolution prolétarienne est que les couches de
la petite bourgeoisie basculent vers la classe ouvrière. Or
cette condition n'est pas réalisée : au contraire,
la croissance gigantesque des nazis démontre que la masse
petite-bourgeoise a été gagnée par « le
désespoir contre-révolutionnaire ». A la
base de ce phénomène, il y a bien sûr
l'expérience directe de ces couches opprimées, mais
aussi le fait que le gros des travailleurs qui votent encore pour la
social-démocratie le font par une méfiance justifiée
à l'égard des communistes, ce qui exprime l'énorme
différence entre cette situation et celle de la Russie en
1917.
« Nous sommes ainsi
devant une
situation profondément contradictoire. Certaines de ses
composantes mettent à l'ordre du jour la révolution
prolétarienne ; mais d'autres excluent toute possibilité
de victoire dans une période très proche. car elles
impliquent une profonde modification préalable du rapport des
forces politiques8. »
On
ne s'étonnera donc pas de le voir inscrire au nombre des
conditions « la question de vie ou de mort » du
« changement de régime du parti »
allemand pour « l'arracher à sa prison
bureaucratique ». Quant à la formule générale,
elle est, selon lui, dans l'adoption d'une politique défensive
de « rapprochement avec la majorité de la classe
ouvrière allemande et de front unique avec les ouvriers
social-démocraties et sans-parti contre le danger fasciste ».
Il
s'exprime à nouveau avec insistance sur l'Allemagne à
partir de l'été 1931. Immédiatement après
le référendum en Prusse, alors que Well et Sénine
sont en visite à Prinkipo, il écrit deux articles dont
l'un est dirigé contre la politique du K.P.D, sous le titre
« Contre
le national-communisme (Leçons du référendum
rouge) 9 ».
Il y pose la question du front unique, tout en soulignant l'échec
de la politique du K.P.D. qui, dans certains secteurs ouvriers, a
obtenu, avec les nazis, moins de voix au référendum
qu'il n'en avait eu tout seul aux élections précédentes.
Il assure que c'est une sanction sévère, mais juste
pour cette politique de « front unique avec le
fascisme ».
Il
revient sur la question en septembre, dans un article intitulé
« La
Clé de la situation internationale se trouve en Allemagne 10 ».
Après une rapide revue de la situation mondiale, il explique
que l'issue de la crise allemande « règlera pour de
très nombreuses années le destin de l'Allemagne […],
de l'Europe et du monde entier ». Pour lui, par la faute
de Moscou qui veut attendre et faire traîner les choses en
Allemagne du fait de ses propres difficultés internes,
l'attitude de l'I.C. est devenue une politique « de
panique et de capitulation ». Il argumente :
« La victoire des
fascistes,
que l'on déclarait impensable il y a un an, est considérée
aujourd'hui comme déjà assurée. Un quelconque
Kuusinen, conseillé dans les coulisses par un quelconque
Radek, prépare pour Staline une formule stratégique :
reculer en temps opportun, retirer les troupes révolutionnaires
de la ligne de feu, tendre un piège aux fascistes sous la
forme... du pouvoir gouvernemental.
« Si
cette théorie était définitivement adoptée
[...], ce serait, de la part de l'Internationale communiste, une
trahison d'une ampleur historique au moins égale à
celle de la social-démocratie le 4 août 1914 - avec des
conséquences plus effroyables encore11. »
Il
entreprend donc de « sonner l'alarme » devant
le danger de cette gigantesque catastrophe :
« L'arrivée au
pouvoir
des nationaux-socialistes signifierait avant tout l'extermination de
l'élite du prolétariat allemand, la destruction de ses
organisations, la perte de confiance en ses propres forces et en son
propre avenir. [...] Dans l'immédiat, dans les dix ou vingt
prochaines années, la victoire du fascisme en Allemagne
provoquerait une coupure dans l'héritage révolutionnaire,
le naufrage de l'Internationale communiste, le triomphe de
l'impérialisme mondial sous ses formes les plus odieuses et
les plus sanguinaires. La victoire du fascisme impliquerait forcément
une guerre contre l'U.R.S.S. [...], un isolement terrible et une
lutte à mort dans les conditions les plus pénibles et
les plus dangereuses12. »
Devant
le danger, il en appelle aux prolétaires du monde entier et
même aux soldats et officiers de l'Armée rouge :
« Le devoir
révolutionnaire
élémentaire du Parti communiste allemand l'oblige à
dire : le fascisme ne peut arriver au pouvoir que par une
guerre
civile à mort, impitoyable et destructrice. Les ouvriers
social-démocrates, sans parti, le prolétariat dans son
ensemble doivent le comprendre. Le prolétariat mondial doit le
comprendre. L'Armée rouge doit le comprendre à
l'avance13.»
La
victoire est possible. Le prolétariat a la « supériorité
sociale et militante » ; le découragement,
l'abattement, la résignation sont le résultat des
hésitations des chefs et disparaîtront dès que le
parti « élèvera sa voix avec assurance,
fermeté et clarté ». Et ce sont les
convictions de toute sa vie que Trotsky engage, pour
convaincre :
« Pour l'instant, le
fascisme
n'est pas encore au pouvoir en Allemagne. Il doit le conquérir
en affrontant le prolétariat. Est-il possible que le parti
communiste mette en avant dans ce combat des cadres inférieurs
à ceux du fascisme ? Et peut-on admettre même un
instant que les ouvriers allemands, qui détiennent les
puissants moyens de production et de transport, qui, de par leurs
conditions de travail, forment l'armée du fer, du charbon, du
rail, de l'électricité, ne prouveront pas au moment
décisif leur immense supériorité sur la
poussière humaine de Hitler14 ? »
A
destination de l'U.R.S.S. où il compte toujours, à ce
moment-là, sur l'existence du bloc des oppositions et des
changements à court terme, il poursuit :
« Tout ouvrier
révolutionnaire
doit considérer comme un axiome l'affirmation suivante :
la tentative des fascistes pour s'emparer du pouvoir en Allemagne
doit entraîner une mobilisation de l'Armée rouge. Pour
l'Etat prolétarien, il s'agira d'autodéfense
prolétarienne au sens plein du terme. L'Allemagne n'est pas
seulement l'Allemagne. Elle est le cœur de l'Europe. Hitler n'est
pas seulement Hitler. Il peut devenir un super-Wrangel. Mais l'Armée
rouge n'est pas seulement l'Armée rouge. Elle est l'instrument
de la révolution prolétarienne mondiale15. »
Au
printemps de 1932, dans un article destiné au public
américain, mais, derrière lui, aux responsables
soviétiques, il démontre le caractère
inéluctable d'une attaque allemande contre l'Union soviétique.
Pour une fois - et c'est, semble-t-il, un exemple unique -, il
indique ce qu'il ferait « à la place »
du gouvernement soviétique :
« A sa place, dès que
j'apprendrais télégraphiquement cet événement,
je signerais un ordre de mobilisation de quelques classes. Lorsqu'on
se trouve en face d'un ennemi mortel et lorsque la guerre résulte
nécessairement de la logique de la situation de fait, il
serait d'une impardonnable légèreté de donner à
cet ennemi le temps de s'établir et de se renforcer, de
conclure ses alliances, de recevoir les secours nécessaires,
d'élaborer un plan d'attaque militaire de toute part - non
seulement de l'ouest, mais aussi de l'est - et de laisser ainsi
grandir un énorme danger. [...] Quel que soit celui des deux
qui prenne formellement l’initiative, c'est peu important ;
une guerre entre un Etat hitlérien et l'Etat soviétique
serait inévitable, et ce à brève échéance.
Les conséquences en seraient incalculables16. »
*
* *
C'est
alors que Trotsky s'engage dans une fantastique campagne qui
constitue peut-être l'épisode le plus étincelant
de sa vie de publiciste et, en tout cas, le plus digne de passer à
la postérité. De son bureau de Prinkipo, armé
des journaux qui lui arrivent d'Allemagne et du monde entier, des
coupures de presse que lui adressent ses camarades, des centaines de
lettres qu'il reçoit d'hommes et de femmes connus ou inconnus,
il entreprend un combat inégal et fascinant contre les forces
politiques et les appareils qui semblent dominer de toute leur
puissance matérielle sa frêle silhouette d'exilé
solitaire : le national-socialisme de Hitler et ses alliés
des partis bourgeois qui pavent sa route, le Parti social-démocrate
allemand et les partis socialistes du monde, engagés dans une
politique de soutien d'un régime parlementaire en train de se
décomposer, le Parti communiste allemand et l'Internationale
communiste qui tentent de couvrir leurs propres traces en l'injuriant
quotidiennement et, derrière tout ce monde, les dirigeants de
l'Union soviétique et Staline en personne.
Il
mène ce combat par la plume, sous toutes les formes :
lettres personnelles, interviews à la presse, articles, brefs
ou longs, brochures plus ou moins volumineuses, lettres ouvertes à
des destinataires réels ou imaginaires. Certains de ces textes
sont peut-être moins importants que d'autres, mais tous
traduisent le même effort, la même bataille, la même
tension pour le même objectif, celui de convaincre de la
réalité mondiale du danger qui menace et des moyens de
le conjurer.
Qui
Trotsky cherche-t-il à convaincre ? Le décalage
ici est immense entre la dimension de ses écrits et le
caractère restreint, pour ne pas dire mineur, des forces
politiques qui le soutiennent, quelques centaines de membres et
sympathisants de l'opposition de gauche unifiée allemande en
crise permanente, étouffée par les infiltrations du G
.P. U. Les militants diffusent ses écrits*,
mais sont incapables de capitaliser en termes d'organisation
l'intérêt, voire la sympathie qu'ils éveillent à
une échelle qui dépasse totalement leurs moyens
matériels.
C'est
probablement ce qui donne son caractère titanesque à
l'entreprise de cet homme seul ou presque seul. Ce sont les
travailleurs, par millions, ce sont leurs cadres, par centaines de
milliers, qu'il s'efforce de convaincre, par sa plume, en Union
soviétique et en Europe, en Allemagne et en Amérique.
Il le fait sans jamais se départir de son sens de l'humour ni
de sa plume assassine, comme quand il répond à
l'accusation de Die rote Fahne d'avoir conclu un
« front
unique » avec la presse social-démocrate qui le
cite :
« O sages
stratèges !
Vous affirmez que nous avons formé un "front unique"
avec Wels et Severing ? Uniquement dans la mesure où vous
avez, vous, formé un front unique avec Hitler et ses bandes
ultra-réactionnaires. Et avec la différence qu'il
s'agissait, dans votre cas, d'une action politique commune alors que,
pour nous, cela s'est résumé à l'utilisation
équivoque par l'adversaire de quelques citations de nos
articles17. »
Dans
l'ensemble pourtant, c'est le plus souvent aux ouvriers communistes
qu'il s'adresse ; c'est eux qu'il s'efforce de convaincre
qu'ils
tiennent dans une large mesure entre leurs mains le destin de
l'humanité pour de longues années, car c'est d'un
tournant et d'un redressement de la politique de leur parti que
dépend en dernière analyse la victoire de la révolution
ou celle de la contre-révolution nazie :
« Ouvriers
communistes, vous
êtes des centaines de milliers, des millions, vous n'avez nulle
part où aller, il n'y aura pas assez de passeports pour vous.
Si le fascisme arrive au pouvoir, il passera sur vos crânes et
vos échines comme un effroyable tank ! Le salut ne se
trouve que dans un combat sans merci. Seul le rapprochement dans la
lutte avec les ouvriers social-démocrates peut apporter la
victoire. Dépêchez-vous, ouvriers communistes, car il ne
vous reste pas beaucoup de temps18! »
Il
est évidemment impossible, dans le cadre de ce chapitre, de
résumer ne fût-ce que les plus importantes des analyses
consacrées par Trotsky pendant les deux années
décisives à la situation en Allemagne et aux conditions
de la victoire ouvrière. Nous nous contenterons d'indiquer ici
les thèmes sur lesquels il mène cette bataille.
Bien
entendu, selon sa méthode habituelle, il s'appuie sur
l'histoire récente. Il explique longuement la façon
dont l'Internationale communiste en est venue, entre le IIIe et
le IVe congrès, à définir la politique du
« front unique ouvrier » et les critiques et
oppositions auxquelles elle s'est heurtée. Il cite longuement
sa propre intervention devant l'exécutif de l'Internationale
communiste en 1926, immédiatement après le coup d'État
de Pilsudski en Pologne. Surtout, il revient à plusieurs
reprises sur l'expérience même de la révolution
russe, le coup d'Etat de Kornilov et l'engagement des bolcheviks,
pour résister à son coup d'Etat contre-révolutionnaire
aux côtés du gouvernement de Kerensky et de ses
soutiens, mencheviks et socialistes-révolutionnaires. Il le
dit et le répète : les bolcheviks n'ont pas établi
une hiérarchie des valeurs entre Kornilov et Kerensky,
distingué entre eux celui qui était « le
moindre mal » ou dont ils se sentaient plus proches ou
moins éloignés. Ils ont simplement, en fonction d'une
analyse concrète, établi une hiérarchie des
urgences et décidé d'anéantir d'abord Kornilov
pour « présenter la note » ensuite à
Kerensky - ce qui fut fait.
Il
concentre pourtant son argumentation sur la question du
« social-fascisme » ou, autrement dit, des
rapports entre fascisme et social-démocratie, voire fascisme
et démocratie tout court. Il établit dans un premier
temps leurs différences. La social-démocratie, plus
exactement la bureaucratie social-démocrate qui dirige partis
et syndicats, est à ses yeux la partie la plus décomposée
de l'Europe capitaliste pourrissante. Née avec l'objectif de
renverser la domination de la bourgeoisie, elle a commencé à
renoncer à la révolution, d'abord dans les faits, puis
en paroles. Elle est aujourd'hui selon lui en train d'essayer de
sauver la société bourgeoise en renonçant aux
réformes. Mais elle est en fait devenue tout à fait
insuffisante, et même gênante, pour la classe dominante,
et c'est précisément à ce point qu'intervient le
fascisme. Trotsky écrit :
« Le fascisme n'est
pas
seulement un système de répression, de violence et de
terreur policière. Le fascisme est un système d'Etat
particulier fondé sur l'extirpation de tous les éléments
de démocratie prolétarienne dans la société
bourgeoise. La tâche du fascisme n'est pas seulement d'écraser
l'avant-garde communiste, mais aussi de maintenir toute la classe
dans une situation d'atomisation forcée. Pour cela, il ne
suffit pas d'exterminer physiquement la couche la plus
révolutionnaire des ouvriers. Il lui faut écraser
toutes les organisations libres et indépendantes, détruire
toutes les bases d'appui du prolétariat et anéantir les
résultats de trois quarts de siècle de travail de la
social-démocratie et des syndicats19. »
Il
ne dissimule pas un instant la responsabilité indiscutable à
ses yeux de la social-démocratie dans la montée du
fascisme mais ajoute que cela ne permet nullement de les identifier.
Il résume :
« Dans la lutte
contre la
social-démocratie, les communistes allemands doivent s'appuyer
à l'étape actuelle sur deux positions distinctes :
a) la responsabilité politique de la social-démocratie
en ce qui concerne la puissance du fascisme, b) l'incompatibilité
absolue qui existe entre le fascisme et les organisations ouvrières
sur lesquelles s'appuie la social-démocratie20. »
C'est
autour du deuxième aspect qu'il argumente le plus,
expliquant :
« La
social-démocratie,
aujourd'hui principale représentante du régime
parlementaire bourgeois, s'appuie sur les ouvriers. Le fascisme
s'appuie sur la petite bourgeoisie. La social-démocratie ne
peut avoir d'influence sans organisation ouvrière de masse. Le
fascisme ne peut instaurer son pouvoir qu'une fois les organisations
ouvrières détruites. Le parlement est l'arène
principale de la social-démocratie. Le système fasciste
est fondé sur la destruction du parlementarisme. Pour la
bourgeoisie monopoliste, les régimes parlementaire et fasciste
ne sont que les différents instruments de sa domination :
elle a recours à l'un ou à l'autre selon les conditions
historiques. Mais pour la social-démocratie comme pour le
fascisme, le choix de l'un et de l'autre instrument a une
signification indépendante, bien plus, c'est pour eux une
question de vie ou de mort politique21. »
Trotsky
ironise sur les définitions prétendument
« théoriques »
de Staline sur le « social-fascisme » mais,
au-delà d'une affirmation d'un dirigeant du K.P.D., Werner
Hirsch, sur un passage de la démocratie au fascisme comme un
« processus organique [...] progressivement et à
froid22 »,
met le doigt sur le fait que cela « présuppose la
plus effroyable capitulation politique du prolétariat qui soit
imaginable23 ».
Or
Trotsky souligne que le conflit entre la social-démocratie,
avec toutes ses contradictions, et le fascisme, en train
d'apparaître, offre aux communistes la possibilité
d'intervenir et de gagner les ouvriers restés dans le parti
social-démocrate en leur permettant de faire, dans la lutte,
l'expérience de leur organisation et de leurs dirigeants. Or
il n'y aura bataille que s'il est possible d'opposer aux nazis un
front unique des organisations ouvrières. Parce que les
ouvriers socialistes ne commenceront à bouger que s'ils font
l'expérience de leur organisation dans le combat uni. Il n'y a
pas là la moindre caution ni le moindre soutien politique à
la social-démocratie. Trotsky donne, dans les lignes qui
suivent, la définition du front unique tel qu'il a été
conçu par l'Internationale communiste du temps de Lénine :
« Aucune plate-forme
commune
avec la social-démocratie ou les dirigeants des syndicats
allemands, aucune publication, aucun drapeau, aucune affiche
commune ! Marcher séparément, frapper ensemble !
Se mettre d'accord uniquement sur la manière de frapper, sur
qui et quand frapper ! On peut se mettre d'accord sur ce point
avec le diable, sa grand-mère et même avec Noske et
Grzesinski. A la seule condition de ne pas se lier les mains24. »
A
ceux qui reculent devant le caractère contradictoire des
éléments de son analyse concrète, il rappelle,
avec un éclat de rire qu'on croit deviner sous sa plume, les
exemples que « la dialectique révolutionnaire »
a depuis longtemps donnés dans des domaines divers :
« Combinaison de la
lutte pour
le pouvoir et de la lutte pour les réformes ;
indépendance complète du parti, mais unité des
syndicats ; lutte contre le régime bourgeois, tout en
utilisant ses institutions ; critique implacable du
parlementarisme du haut de la tribune parlementaire ; lutte
sans
pitié contre le réformisme tout en concluant avec eux
des accords pratiques pour des tâches partielles25. »
Reprenant
l'ensemble des problèmes posés en septembre 1932 et
s'efforçant de définir le rôle joué par le
parti allemand, il écrit :
« La situation en
Allemagne
est comme spécialement créée pour permettre au
parti communiste de conquérir en peu de temps la majorité
des ouvriers [...]. Au lieu de cela il s'est donné une
tactique que l'on peut résumer : ne donner au prolétariat
allemand la possibilité ni de mener des luttes économiques,
ni d'opposer une résistance au fascisme, ni de saisir l'arme
de la grève générale, ni non plus de créer
des soviets, avant que l'ensemble du prolétariat ait reconnu
d'avance le rôle dirigeant du parti communiste. La tâche
politique devient un ultimatum26. »
A
la question de l'origine de cette politique, il répond avec
une totale netteté :
« La réponse nous est
donnée par la politique de la fraction stalinienne dans
l'Union soviétique. Là, l'appareil a transformé
la direction politique en un commandement administratif. En ne
permettant aux ouvriers ni de discuter, ni de critiquer, ni d'élire,
la bureaucratie stalinienne ne leur parle pas autrement que dans le
langage de l'ultimatum. La politique de Thälmann est une
tentative de traduire le stalinisme en mauvais allemand. La
différence consiste cependant en ceci que la bureaucratie de
l'U.R.S.S. dispose pour sa politique de commandement de la puissance
d'Etat qu'elle a reçue des mains de la révolution
d'Octobre. Par contre, Thälmann ne possède, pour donner
force à son ultimatum, que l'autorité formelle de
l'Union soviétique. C'est une grande source d'aide morale,
mais, dans les conditions données, elle ne permet que de
fermer la bouche aux ouvriers communistes, pas de gagner les ouvriers
social-démocraties. Et c'est à cette dernière
tâche que se réduit maintenant le problème de la
révolution allemande27. »
Le
parti allemand peut-il se libérer de la tutelle de Staline ?
Trotsky assure que, s'il disposait de la liberté d'action
indispensable, il se serait déjà tourné vers les
solutions qu'il préconise lui-même. La dictature
personnelle de Staline semble certes approcher de son déclin
et des centaines de fissures laissent prévoir que la
liquidation du despotisme bureaucratique va coïncider avec
l'épanouissement du système soviétique.
« Mais c'est
précisément
dans sa dernière période que la bureaucratie
stalinienne est capable de faire le plus de mal. La question de son
prestige est devenue pour elle la question militaire centrale. [...]
Le régime plébiscitaire [...] peut-il admettre la
reconnaissance des erreurs commises en 1931-1932 ? Peut-il
renoncer à la théorie du social-fascisme ? Peut-il
désavouer Staline qui a résumé le fond du
problème allemand dans la formule suivante : que les
fascistes arrivent au pouvoir d'abord, notre tour viendra
ensuite28 ? »
Sa
conclusion sur ce point est que le problème du régime
stalinien et celui de la révolution allemande sont
indissolublement liés. La victoire de la révolution
allemande effacerait le stalinisme, mais ce dernier risque d'empêcher
cette victoire! Dans la brochure La seule Voie, il
insiste sur
le fait que le parti doit redevenir un vrai parti, car « une
politique juste exige un régime sain ». Il met en
avant le double mot d'ordre de congrès extraordinaire du parti
et de l'Internationale communiste. A ceux qui assurent emphatiquement
que le parti ne peut se payer le luxe d'une discussion, il rappelle
l'autorité dont jouissait en 1917, en Russie, la direction du
parti bolchevique, alors que l'ensemble du parti débattait
avec passion de la question qui coupait en deux le comité
central, celle de l'insurrection - et que c'est dans cette discussion
seulement que se forma la certitude générale de
justesse de la politique qui permit la victoire. Il s'efforce
d'évaluer les chances d'un redressement du K.P.D. :
« Quel cours les
choses
prendront-elles en Allemagne? La petite roue de l'opposition
réussira-t-elle à faire tourner à temps la
grande roue du parti29 ? »
Il
comprend et admet le scepticisme de nombre de militants sur ce point,
car l'opposition est faible et ses cadres inexpérimentés.
Cependant, il est sûr que « les leçons des
événements sont plus fortes que la bureaucratie
stalinienne » et que la fraction de l'opposition organisée
avec ses propres cadres, fait de son mieux pour aider l'avant-garde
communiste à élaborer la ligne juste. Il conclut :
« Le parti
révolutionnaire
commence avec une idée, un programme qui se dresse contre les
plus puissants appareils de la société de classe. Ce ne
sont pas les cadres qui créent l'idée, mais l'idée
qui crée les cadres. La peur devant la puissance de l'appareil
est un des traits typiques de cet opportunisme particulier que
cultive la bureaucratie stalinienne. La critique marxiste est plus
forte que n'importe quel appareil30. »
Il
ne nie pas la lenteur des progrès de l'opposition qu'il
explique par des circonstances exceptionnelles tout en disant sa
certitude qu'il se trouve dans le parti communiste « beaucoup
d'oppositionnels incomplets, effrayés ou cachés ».
Envisageant la possibilité que ces progrès ne soient
pas suffisants pour transformer à temps la situation
allemande, il écrit :
« Pour la formation
d'un
nouveau parti, il faut, d'une part, de grands événements
historiques qui auraient brisé l'épine dorsale du vieux
parti, d'autre part une position de principe élaborée
sur la base des événements et des cadres éprouvés.
« Tout en luttant de
toutes
nos forces pour la renaissance de l'Internationale communiste et la
continuité de son développement ultérieur, nous
ne sommes nullement enclins au fétichisme purement formel. Le
sort de la révolution prolétarienne mondiale est pour
nous au-dessus du sort organisationnel de l'Internationale
communiste. Si la pire variante se réalisait, si, malgré
tous nos efforts, les partis officiels d'aujourd'hui étaient
menés à l'écroulement par la bureaucratie
stalinienne, si cela voulait dire dans un certain sens qu'il faille
recommencer de nouveau, alors la Nouvelle Internationale ferait
descendre sa généalogie des idées et des cadres
de l'Opposition communiste de gauche31. »
Pressentant
peut-être l'imminence d'une catastrophe contre laquelle il
s'était bien battu et de toute la force de son génie,
il prend de la hauteur par rapport au coup que cette épouvantable
défaite lui portera inévitablement :
« Les critères courts
de "pessimisme" et d'"optimisme" ne sont pas
applicables au travail que nous poursuivons. Il est au-dessus des
étapes particulières, des défaites et des
victoires partielles. Notre politique est une politique à long
terme32. »
Hitler
devient chancelier du Reich le 30 janvier, à la tête
d'un gouvernement où les nazis sont encore en minorité
parmi les représentants des partis de droite. Quelques jours
plus tard, Lev Sedov lui donne de la réalité politique
allemande une description assez noire :
« Ce que nous vivons
ressemble
à une reddition de la classe ouvrière au fascisme.
[...] Au sommet, désorientation, personne ne sait que faire ;
à la base, pas de foi dans nos propres forces. [...] Je crois
que nous entrons maintenant dans les journées et semaines
décisives. Si une action vigoureuse de la classe ouvrière
- qui, dans son développement, ne peut pas être autre
chose que la révolution prolétarienne - ne se produit
pas maintenant, une effroyable défaite est inévitable.
Cette action n'est pas encore exclue, mais, à mon avis, elle
n'est plus très vraisemblable33. »
Le
5 février 1933 - nous ignorons s'il a reçu cette lettre
de Sedov - Trotsky commente l'arrivée de Hitler au pouvoir qui
correspond selon lui à un double objectif de redorer à
droite la « camarilla » des propriétaires
de l'entourage de Hindenburg et de mettre les forces nazies au
service des possédants. Il ajoute :
« L'arrivée de Hitler
au pouvoir est, sans aucun doute, un coup terrible pour la classe
ouvrière. Mais ce n'est pas encore une défaite
définitive et irrémédiable. L'ennemi que l'on
pouvait abattre quand il cherchait encore à se hisser au
pouvoir, occupe aujourd'hui toute une série de postes de
commande. C'est pour lui un avantage considérable, mais la
bataille n'a pas encore eu lieu. Occuper des positions avantageuses
n'est pas en soi décisif. C'est la force vivante qui tranche.
[...] Du gouvernement qui a à sa tête un chancelier
fasciste à la victoire complète du fascisme, il y a
encore pas mal de chemin. Cela signifie que le camp de la révolution
dispose encore d'un certain laps de temps. Combien ? Il est
impossible de l'évaluer à l'avance. On ne peut le
mesurer qu'au combat34. »
Un
tournant est-il possible? Trotsky rappelle que plus la lutte est
aiguë, plus elle est proche du dénouement, plus la clé
de la situation peut se trouver dans les mains d'un parti et de sa
direction. Personne ne peut dire si la direction du K.P.D. est
capable de résister à la pression qui s'exerce
certainement sur elle. Trotsky n'exclut pas la possibilité
d'un mouvement de masses spontané, mais qui ne réglerait
pas la question de l'attitude que prendrait à son égard
le parti communiste. De toute façon, il faut appeler,
juge-t-il, à une défense active qui peut encore et doit
être le point de départ du front unique en direction de
la social-démocratie.
C'est
son dernier texte avant la catastrophe. Il signera le 23 février
1933 un texte en forme de discussion avec un ouvrier
social-démocrate. Il la termine en posant brutalement ce qu'il
pense être le problème de fond :
« Pour faire
apparaître
plus clairement la signification historique des décisions et
des actions du parti dans les jours et les semaines qui viennent, il
faut, à mon avis, poser le problème devant les
communistes sans la moindre concession, au contraire dans toute son
âpreté : le refus par le parti du front unique, le
refus de créer des comités locaux de défense,
c'est-à-dire les soviets de demain, est la preuve de la
capitulation du parti devant le fascisme, c'est-à-dire un
crime historique, équivalent à la liquidation du Parti
et de l'Internationale communiste. Si une telle catastrophe se
produit, le prolétariat passera par-dessus des montagnes de
cadavres, à travers des années de souffrances et de
malheurs infinis, pour arriver à la IVe Internationale35. »
On
sait qu'avec l'incendie du Reichstag, sans attendre le déroulement
des élections, Hitler avait frappé le mouvement ouvrier
qui s'écroula sans résistance, en quelques heures. Les
autres partis suivraient. Le lecteur de Trotsky en 1988 ne peut pas
ne pas être frappé de la contradiction entre sa vision
pénétrante en ce qui concerne le déroulement de
l'Histoire et sa persistance dans l'erreur qu'il commet sur les
délais, lorsqu'il parle de la « dernière
période », déjà commencée, de
la domination de la bureaucratie stalinienne, ou lorsqu'il explique
que l'« idée crée les cadres »,
comme s'il était possible, dans les semaines dont il dispose,
de créer et de former les cadres en question. Nous
retrouverons pendant des années encore chez lui cette
difficulté à apprécier les rythmes qui n'est
certainement pas une faiblesse personnelle.
Il
reste que la tentative de « redressement » de
la politique du P.C. allemand avait finalement échoué
et que l'« effroyable catastrophe » que Trotsky
avait essayé d'empêcher, s'était finalement
produite : avec la défaite sans combat du prolétariat
allemand, la victoire de la contre-révolution en Allemagne
donnait corps à la menace de la « peste brune »
s'étendant sur l'Europe entière.
L'histoire
venait de faire un bond en arrière.