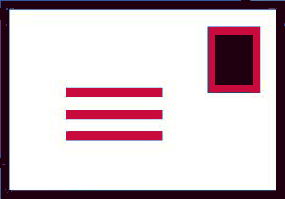La
monarchie prussienne régnait depuis des centaines d’années. Elle
dirigeait la totalité de l’Allemagne depuis un demi-siècle. En
quelques brèves journées, elle s’effondra. C’est à peine si un
coup de feu fut tiré pour la défendre.
Les
événements de Kiel suivirent un schéma qui fut reproduit dans
pratiquement toutes les villes allemandes. Dans la soirée des
premières manifestations de rues, un meeting de masse de
20 000
hommes élut un conseil de marins. A sa tête était un machiniste,
Karl Artelt, qui avait été condamné à cinq ans de prison pour le
rôle qu’il avait joué dans la précédente mutinerie manquée.
Dès le lendemain, le conseil était l’autorité de la ville.
Des
nouvelles de Kiel parvinrent bientôt aux autres ports. Dans les 48
heures qui suivirent, il y eut des manifestations et des grèves
générales à Cuxhaven et Wilhelmshaven. Des conseils d’ouvriers
et de marins furent élus, qui détenaient le pouvoir effectif.
Dans
la plus grande ville de la région, Hambourg, on aurait dit au début
que le mouvement révolutionnaire pouvait s'arrêter. Une réunion
des Socialistes Indépendants, tenue le 5 novembre, appela à la
libération des marins emprisonnés mais rejeta une motion en faveur
de l’élection d’un conseil ouvrier. Un des matelots, Friedrich
Zeiler, prit alors les choses en mains. Il réunit 20 camarades et
descendit au port chercher du soutien. A minuit ils étaient une
centaine, avaient pris possession du quartier général du syndicat
pour appeler à une manifestation le lendemain, et avaient envoyé
des délégations dans toutes les casernes.
L’atmosphère
de la ville était telle que 40 000 personnes participèrent à
cette manifestation improvisée, « non-officielle »,
et
votèrent pour une « république
des conseils ouvriers ».
Dans la soirée, un conseil d’ouvriers et de soldats fut formé,
avec à sa tête le révolutionnaire Lauffenberg. En même temps, un
groupe de soldats armés, dirigé par un autre révolutionnaire, Paul
Frölich, s’empara de l’atelier d’imprimerie du quotidien le
Hamburger
Echo,
et sortit un journal au nom du conseil d’ouvriers et de soldats
appelé die
Rote Fahne
(le Drapeau Rouge).
« C’est
le début de la révolution allemande, de la révolution
mondiale ! »,
proclamait-il. « Vive
le plus grand événement de l'histoire mondiale ! Vive le
socialisme ! Vive la république allemande des
travailleurs !
Vive le bolchevisme mondial ! ».1
La
première grande ville allemande était passée à la révolution.
Désormais, plus rien ne pouvait l'empêcher d'avancer. Déjà, il y
avait eu des manifestations dans les grandes villes du sud, Munich et
Stuttgart. Maintenant les marins des ports du nord agissaient comme
un bacille propageant l’infection révolutionnaire de ville en
ville. Lorsque la flotte de la Baltique s’était soulevée, de
nombreux marins voulaient rentrer chez eux. Il n’y avait plus
aucune autorité pour les empêcher d’entreprendre leur voyage de
retour – mais lorsqu’ils arrivaient, c’était pour se rendre
compte que les autorités militaires locales les considéraient
toujours comme des déserteurs. Les marins avaient donc le choix
entre deux solutions : soit répandre la révolution chez eux,
dans leurs villes, soit être arrêtés et emprisonnés.
Le
6 novembre la révolution avait conquis tout le nord-ouest. Les
conseils prenaient le pouvoir à Brême, Altona, Rendsburg et
Lockstedt. Le 7, c’était le tour de Cologne, Munich, Braunschweig
et Hanovre. Les grandes villes restantes passèrent à la révolution
le 8 : Oldenburg, Rostock, Magdebourg, Hall, Leipzig, Dresde,
Chemnitz, Düsseldorf, Francfort, Stuttgart, Darmstadt et Nuremberg.
Berlin demeurait un centre isolé de pouvoir impérial, où, comme le
décrivait un journaliste :
Les nouvelles arrivent de tout
le pays
des progrès de la révolution. Les cercles qui affichaient si
bruyamment leur loyauté envers le Kaiser et étaient si fiers de
leurs médailles ne bougent nulle part le petit doigt pour défendre
la monarchie, et les soldats quittent les casernes en courant.2
Pourtant
les autorités semblaient toujours tenir la capitale. Les soldats
restaient dans leurs casernes, saluant loyalement leurs officiers.
Les travailleurs pointaient dans les usines comme si rien n’avait
changé. Seule une couche réduite de leurs dirigeants était engagée
dans une activité frénétique. Les sociaux-démocrates avaient fait
de leur mieux pour prendre la révolution de vitesse, en pressant le
Kaiser d’abdiquer volontairement en faveur d’un autre membre de
la famille impériale. Comme leur dirigeant Ebert le disait au
premier ministre, le prince Max : « Si
le Kaiser n’abdique pas, une révolution sociale est inévitable.
Mais je n’en veux pas, oui, je la hais comme le péché ».3
Pendant
ce temps les spartakistes, les Délégués Révolutionnaires et les
Sociaux-Démocrates Indépendants discutaient sur le point de savoir
quand lancer le mouvement révolutionnaire à Berlin. Déjà,
quelques jours plus tôt, il y avait eu une réunion des dirigeants
de ces trois groupes. Les révolutionnaires avaient proposé une
grève de masse, et une manifestation qui devait être dirigée par
des unités de l’armée sympathisantes. La proposition fut rejetée.
L’opposition
principale à l’action venait du dirigeant social-démocrate
indépendant Haase, qui craignait tout ce qui pouvait compromettre
son désir d’unité avec les sociaux-démocrates majoritaires. Il
appela le soulèvement de Kiel « une
explosion impulsive »
et dit qu’il avait promis au dirigeant du SPD Noske de ne rien
faire qui puisse rendre plus difficile l’unité entre les deux
partis.
Ainsi,
pendant que la révolution s'étendait d'un d’un bout de l'empire à
l’autre, la question de l’action à Berlin était laissée en
suspens. Plus grave, dans la capitale l'appareil répressif demeurait
intact. La police étouffait tout soulèvement dans l’œuf. Le 6
novembre, elle empêcha une réunion des délégués d’usine
révolutionnaires, puis arrêta un de leurs dirigeants, Daümig. Elle
réussit à empêcher toute coordination entre les divers groupes qui
désiraient passer à l’action. Elle dispersa une réunion
célébrant l’anniversaire de la Révolution Russe le 7 novembre.
Le lendemain, des policiers armés patrouillaient dans les rues et
gardaient tous les édifices publics.
Une
réunion des militants sociaux-démocrates majoritaires dans les
usines le soir du 8 novembre fit savoir à la direction qu’ils ne
pouvaient plus retenir les ouvriers, qui voulaient passer à l’action
le lendemain.
Liebknecht,
quant à lui, était désespéré. Il semblait impossible d’amener
les Délégués Révolutionnaires à agir en solidarité avec les
autres villes allemandes – ils étaient toujours influencés par
les dirigeants Indépendants qui prétendaient qu’un soulèvement
armé n’était pas encore possible techniquement. La grande peur de
Liebknecht était que les dirigeants du SPD, même s’ils étaient
au gouvernement, appelleraient à l’action pour parvenir à mettre
au pouvoir un nouveau gouvernement contre-révolutionnaire revu et
corrigé. Finalement, le 8 novembre, Liebknecht sortit un tract
appelant à la révolution, signé seulement de deux noms, le sien et
celui d’un autre membre de la Ligue Spartakiste, Ernst Meyer. Il
fut distribué dans les rues juste au moment où les Délégués et
une partie des Indépendants avait aussi décidé de ne plus
attendre, éditant leur propre tract.
Le
Haut Commandement militaire avait toujours l’impression que
n’importe quel « désordre à Berlin » pouvait être
réduit en utilisant des troupes de première ligne. Ses espoirs
furent de courte durée. L'atmosphère de la caserne d’un des
régiments « sûrs » le lendemain matin a été décrite
par le rédacteur en chef de la principale agence de presse
berlinoise de la façon suivante :
Le régiment Kaiser Alexandre
est passé
à la révolution ; les soldats se sont précipités hors des
casernes, ont fraternisé avec la foule en liesse qui attendait
là ;
des hommes leur serraient les mains avec émotion, des femmes et des
jeunes filles leur épinglaient des fleurs et les embrassaient. Mes
collègues viennent et racontent qu'on (...) arrache aux officiers
leurs insignes et leurs galons.4
L’appel
à la grève générale fut suivi dans toutes les usines. Ceux qui
souffraient depuis quatre ans de guerre se déversaient des banlieues
dans le centre de la ville, conduits par des groupes de soldats en
armes et porteurs de drapeaux rouges.
Des
processions interminables de soldats et d'ouvriers s’étirent sans
interruption sur la route. La plupart des travailleurs étaient
d’âge mûr, avec des visages barbus et sérieux, (...) mais ils
ont l'état d'esprit syndicaliste, ils marchent consciencieusement en
rangs, et beaucoup d'entre eux ont un fusil, (...) Tous les
participants au défilé ont en boutonnière ou sur la poitrine un
nœud rouge, les membres du service d'ordre qui marchaient à leurs
côtés, le fusil en bandoulière, se distinguent par des brassards
rouges. Au milieu de cette lente masse qui passe étaient brandis de
grands drapeaux rouges.5
L’initiative
de la direction de cette vaste manifestation avait été prise par la
minorité persécutée de la veille, les spartakistes, et par les
Délégués Révolutionnaires. Les mots qu’ils avaient, pendant
quatre ans, gribouillés sur des tracts mal imprimés étaient repris
par des centaines de milliers de voix. Maintenant, ils pouvaient
appeler à l’action et des dizaines de milliers de personnes
allaient répondre à l’appel. Liebknecht conduisit une colonne de
soldats et d’ouvriers prendre le palais impérial, le Schloss ;
Eichhorn, un indépendant de gauche, en emmena une autre se saisir du
quartier général de la police, où il fut installé comme le
nouveau chef de la police révolutionnaire. Le pouvoir semblait
passer directement des dignitaires du Kaiser aux tenants du
socialisme révolutionnaire.
Pendant
que les masses s’emparaient de la ville, les dirigeants
sociaux-démocrates majoritaires conféraient avec les chefs de
l’ancien régime. Dans une tentative désespérée pour conserver
une espèce de contrôle de la situation, le prince Max avait nommé
le dirigeant SPD Ebert premier ministre. Mais les sociaux-démocrates
devaient en même temps donner l’impression qu’ils étaient avec
les travailleurs dans les rues. Ils déclarèrent à une réunion de
députés indépendants : « Nous
retenons les nôtres jusqu'à midi ».
Puis, à 13h, une édition spéciale du Vorwärts
appela à la grève générale, qui était déjà une réalité
depuis cinq heures !
Lorsqu’une
immense colonne de travailleurs et de soldats parvint au Reichstag,
des députés se précipitèrent auprès du collègue d’Ebert,
Scheidemann, qui déjeunait au restaurant de l’assemblée, et le
supplièrent de parler à la foule pour la calmer. Abandonnant sa
soupe à regret, il alla au balcon. Il vit en dessous de lui une
masse de visages affamés, de drapeaux rouges, de poings tendus,
beaucoup d’entre eux brandissant des fusils. Il leur dit que tout
avait changé, que le socialiste Ebert était maintenant premier
ministre. Comme cela n’avait pas l’air de faire cesser les
clameurs, il ajouta : « Vive
la République allemande ! ».
Un tonnerre d’applaudissements secoua l’édifice.
Les
collègues de Scheidemann n’étaient pas très satisfaits de ses
efforts. Ebert devait par la suite lui hurler au visage :
« Tu
n’as pas le droit de proclamer la république ! ».6
En
réalité, Scheidemann avait été pile à l’heure. Quelques
centaines de mètres plus loin, Liebknecht avait escaladé la façade
du palais impérial jusqu’à une fenêtre – la fenêtre même
d’où le Kaiser s’adressait à des foules patriotiques. Le
message de Liebknecht était un peu différent : « Le
jour de la liberté a commencé (...) Nous proclamons maintenant la
libre république socialiste d'Allemagne. (...) Nous leur tendons la
main et les appelons à accomplir la révolution mondiale. Ceux parmi
vous qui veulent voir l'acomplissement de la libre république
socialiste d'Allemagne et de la révolution mondiale, qu'ils lèvent
la main et prêtent serment. »7
Des milliers de mains se levèrent.
Les sociaux-démocrates prennent le
contrôle
L’empire
allemand s’était effondré. La monarchie des Hohenzollern avait
vécu. Il n’y avait même pas un parlement investi d’une
quelconque autorité. Dans les journées qui suivirent, les seuls
organes porteurs d’un semblant de pouvoir étaient les conseils
d’ouvriers et de soldats. Il n’était pas étonnant que de
nombreux travailleurs considérassent la révolution comme accomplie,
avec au pouvoir un gouvernement qui s’appelait lui-même
« socialiste ».
Mais
en finir avec l’ordre ancien n’était pas la même chose qu’en
fonder un nouveau. Pour détruire l’empire allemand, des grèves
spontanées et des combats de rue avaient suffi. Mais pour construire
un ordre socialiste nouveau, la majorité de la classe ouvrière
devait être consciente de ce qu’elle était en train de bâtir. Ce
qui était loin d’être le cas.
Un
événement des débuts du soulèvement révolutionnaire peut donner
une preuve vivante de ses limites. Dès que la révolte de Kiel
commença, le commandement naval demanda au gouvernement d’envoyer
un dirigeant social-démocrate au port « pour
empêcher que la mutinerie ne s’étende à toute la flotte ».8
Le gouvernement persuada le social-démocrate de droite Noske de s'en
charger. Noske avait l’ordre de proposer aux marins une amnistie
s’ils retournaient à leurs navires et rendaient les armes. Noske
fut stupéfait à la vue des 20 000 matelots armés refusant
d’accepter l’autorité de leurs officiers, et se rendit compte
qu’il n’était pas en mesure de les persuader de rentrer. Au lieu
de cela, il contacta les sociaux-démocrates indépendants et les
membres élus du comité de marins – et les trouva tout à fait
disposés à transmettre le pouvoir de la révolution de Kiel à
Noske lui-même.
Artelt
(le chef des mutins) et le dirigeant syndical Garbe suggérèrent que
Noske soit nommé président du conseil des marins. Noske monta sur
le capot d’une voiture et annonça à la foule qu’il acceptait la
responsabilité. La foule applaudit ; la révolte avait trouvé
son maître.9
Noske
était donc à la fois le représentant du gouvernement chargé d’en
finir avec la révolution à Kiel et
celui dont les marins et les ouvriers attendaient qu’il fasse
avancer la révolution. Dans les jours qui suivirent, il utilisa sa
position pour empêcher la destruction du capitalisme allemand ou des
structures – les hiérarchies militaire, policière, administrative
– qui le protégeaient depuis de nombreuses années.
Le
succès de Noske à Kiel se répéta lorsque la monarchie s’effondra
à Berlin. Les sociaux-démocrates n’avaient pas été à
l'initiative de la révolution. Mais à Berlin comme à Kiel la vaste
masse des travailleurs – et encore plus celle des soldats –
entraient dans l’action politique pour la première fois de leur
vie. Beaucoup d’entre eux avaient auparavant soutenu les partis
ouvertement capitalistes et considéraient les sociaux-démocrates
comme l’extrême gauche. Ils ne faisaient pas encore la différence
entre un parti « socialiste » et un autre. La masse
des
ouvriers et des soldats ne savait pas que les sociaux-démocrates
soutenaient la monarchie. Ils ignoraient que Scheidemann n’avait
proclamé la « république » que pour battre de vitesse
la proclamation par Liebknecht de la « république
socialiste ».
Les
chefs de l’USPD accroissaient la confusion sur les visées des
sociaux-démocrates majoritaires. Haase, le plus éminent des
dirigeants Indépendants, avait déjà accepté, à Kiel, que Noske
prenne la présidence du conseil des marins. A Berlin, le coup fut
réédité. Un « gouvernement révolutionnaire » conjoint
fut formé, comportant trois membres de chacun des deux partis
sociaux-démocrates, mais avec les majoritaires clairement aux
commandes. On donna à ce gouvernement un vernis révolutionnaire –
il fut appelé, à la mode russe, « Conseil
des Commissaires du Peuple ».
En
fait, il était tout sauf révolutionnaire. Les trois membres venant
du SPD majoritaire (Ebert, Scheidemann et Landsberg) se consacraient
avec passion, à peine 24 heures plus tôt, à arrêter la
révolution. Deux des Indépendants, Haase et Dittmann, se situaient
à l’aile droite de leur parti, dont le but n’était pas la
révolution, mais la « réunification
de la social-démocratie »
– comme si la guerre n’avait jamais eu lieu. Seul des soi-disant
« Commissaires du Peuple », Emil Barth venait de
l’aile
gauche, associée aux Délégués Révolutionnaires.
Liebknecht
s’était vu offrir un siège dans ce « gouvernement
révolutionnaire », mais il avait décliné, voyant bien qu’il
serait l’otage de la majorité non-révolutionnaire.
Malheureusement, Barth n’avait ni ses principes ni sa perspicacité.
Le
nouveau gouvernement se proclamait « purement
socialiste ».
Mais auprès de chaque « Commissaire du Peuple » se
trouvaient des « conseillers » agissant comme
secrétaires
d’Etat. Ils étaient en général membres des divers partis
bourgeois et s’assuraient que les « Commissaires »
laissaient intacte la hiérarchie de hauts fonctionnaires qui avaient
administré l’empire déchu. Ce que signifiait cette continuité
avec l’ancien régime devint apparent au bout d’une dizaine de
jours, lorsque le gouvernement appliqua la décision prise par le
gouvernement du Kaiser d’expulser l’ambassadeur de la Russie
révolutionnaire.
Mais
le vernis révolutionnaire était suffisant pour tromper les ouvriers
et les soldats – tout au moins pendant quelques semaines cruciales.
Le
« gouvernement révolutionnaire » fut formé le 10
novembre, le deuxième jour de la révolution à Berlin. Ce jour-là,
les Indépendants de gauche et les spartakistes avaient fait leurs
propres préparations pour résoudre la question du pouvoir. Ils
appelèrent à une assemblée des délégués des travailleurs et des
soldats – un délégué pour 1 000 travailleurs et pour chaque
bataillon de soldats. Mais lorsque l’assemblée se réunit au
Cirque Busch les révolutionnaires se rendirent compte que les choses
n’étaient pas telles qu’ils l'espéraient.
Les
dirigeants sociaux-démocrates avaient mis en branle tout l’appareil
de leur parti pour assurer leur domination sur l’assemblée. La
veille, alors que la révolution faisait rage dans les rues, ils
avaient constitué leur propre « comité
d’ouvriers et de soldats »,
constitué d’une douzaine de travailleurs sociaux-démocrates triés
sur le volet et de trois dirigeants du parti. Ces derniers avaient
alors lancé des milliers de tracts dans les casernes demandant qu’il
n’y ait pas de « lutte
fratricide ». On
donna à des soldats politiquement naïfs l’impression que
quiconque mettait en question le besoin d’une unité
inconditionnelle entre les différents partis
« socialistes »
était un scissionniste, un naufrageur, un saboteur.
Plus
de 1 500 délégués s’entassèrent dans la salle de réunion.
Les sociaux-démocrates s’étaient arrangés pour que les soldats
soient là plus tôt, de telle sorte qu’ils prenaient presque toute
la place dans la salle, obligeant les délégués ouvriers plus
expérimentés politiquement à trouver refuge dans les balcons. Les
soldats n’étaient pas intéressés par les subtilités du débat.
Beaucoup agitaient leurs poings et leurs fusils. Il y avait de
fréquentes interruptions des intervenants – en particulier de ceux
qui semblaient remettre en cause le slogan d’unité à tout prix.
Il était difficile, dans cette atmosphère, pour les délégués de
gauche d’objecter lorsque les notables sociaux-démocrates prirent
en charge la tribune.
Ebert
parla pour eux. Il annonça la formation d’un gouvernement de
coalition « purement socialiste » avec les
indépendants.
Haase monta ensuite à la tribune et répéta le même message. Pour
les masses présentes il semblait que la révolution était terminée.
Leurs dirigeants les plus connus étaient unis. La dernière chose
dont il pouvait être question était davantage d’effusion de sang.
La
résolution adaptée à cette assemblée avait une sonorité assez
révolutionnaire. Elle proclamait que l’Allemagne était une
« république
socialiste » :
« Les
détenteurs
du pouvoir politique sont maintenant les conseils d'ouvriers et de
soldats. (...) La paix immédiate est le mot d'ordre de la
révolution. Des salutations fraternelles seront envoyées au
gouvernement des ouvriers et des soldats en Russie ».
Les
soldats n’étaient pas contents lorsque Liebknecht mit un bémol à
l’euphorie révolutionnaire. « Liebknecht,
très calme, mais incisif, n'a pas la partie facile :
l'écrasante majorité des soldats est contre lui, hachant son
discours d'interruptions, d'injures, le menaçant même de leurs
armes, scandant : « Unité !
Unité ! »
à chacune de ses attaques contre les majoritaires. ».10
Malgré
tout il continua, mettant en garde les délégués contre les
sociaux-démocrates «qui vont aujourd'hui avec la
révolution et qui avant-hier encore étaient ses ennemis. (...)
La contre-révolution est déjà en marche, elle est déjà en
action, elle est au milieu de nous ! ».11
Les
avertissements de Liebknecht n’eurent aucun effet sur les soldats.
Ils insistèrent pour désigner 12 soldats sociaux-démocrates
majoritaires dans un Exécutif des Conseils d’ouvriers et de
soldats de Berlin, aux côtés de 12 ouvriers – six venant de
chacun des partis sociaux-démocrates.
L’Exécutif
berlinois des Conseils nouvellement élu proclama son droit à
contrôler le gouvernement. Il était, pour l’instant, le pouvoir
souverain. Mais il était entre les mains des partisans du SPD.
L’organe de la révolution était contrôlé par ceux qui avaient
peur de la révolution.12
A
la mi-décembre, l’Exécutif de Berlin transmit sa souveraineté à
un congrès des délégués ouvriers et soldats de toute l’Allemagne.
Mais les efforts des sociaux-démocrates furent une nouvelle fois
couronnés de succès. Les délégués votèrent l'abandon de leur
souveraineté au Reichstag qui devait être élu dans les quatre
semaines – à un parlement pour lequel les classes qui s’étaient
opposées à la révolution avaient le même suffrage que ceux qui
l’avaient faite.
Dans
les premières semaines de la révolution, il y avait eu chez les
vieux politiciens bourgeois une vraie peur d’être exclus
définitivement du pouvoir politique par les conseils. Ils étaient
désormais rassurés. Ils pouvaient envisager avec confiance des
élections dans lesquelles le contrôle par les milieux d’affaires
de la presse et des finances leur donnerait une longueur d’avance
sur les socialistes. Les élections pouvaient être utilisées pour
détruire le pouvoir révolutionnaire qui les avait organisées.
Les
manœuvres des sociaux-démocrates faisaient le jeu de la vieille
classe possédante. Mais elles n’étaient possibles que du fait de
la contradiction qui apparaît toujours au début de toute grande
révolution. Les révolutions jettent dans la vie politique des gens
qui n’étaient jamais sortis de leur place, dans les marges de
l’histoire, ignorants des grandes questions de société.
Lorsqu’ils se mettent en mouvement ils s’identifient souvent avec
ceux auxquels la vieille société permet d’exister,
« l’opposition
officielle ». L’ancien ministre a plus de chances d’être
connu que l’ancien prisonnier politique. Ses vagues bavardages
oppositionnels touchent ceux qui n’ont pas encore compris pourquoi
ils se battent. Seules des expériences amères peuvent amener des
millions de gens à se détourner de l’opposition officielle et à
évoluer vers la gauche.
Bien
sûr, dans la chaleur d’une insurrection contre un système
d’oppression ce sont ceux qui sont les plus francs et les plus
courageux – les Rosa Luxemburg et les Karl Liebknecht – qui
appellent des centaines de milliers de personnes à descendre dans la
rue. Mais lorsque la poussière retombe, ce sont ceux qui sont encore
à moitié connectés avec l’ordre ancien qui bénéficient d’un
soutien de masse – parce que les masses n’abandonnent pas du jour
au lendemain les préjugés qu’on leur a inculqués toute leur vie.
Il n’y a pas de chemin facile par lequel les dures leçons de
l’expérience, qui seules sont capables de changer leur façon de
voir, peuvent être contournées.
C’est
la raison pour laquelle les premiers soulèvements spontanés contre
l’ordre ancien qui réussissent sont presque invariablement suivis
d’une période d’euphorie, dans laquelle les tensions
sous-jacentes de la société sont oubliées. Les journalistes
utilisent des épithètes « poétiques » pour décrire de
tels moments – la « révolution des œillets », le
« printemps en octobre », la « révolution de
la
fraternité ».
Il
en était ainsi à Berlin en novembre 1918. Comme certains
participants devaient se le rappeler dix ans plus tard :
En une semaine la révolution
s’était
répandue dans toute l’Allemagne. Il y avait des manifestations et
des meetings de travailleurs. Mais il n’y avait plus aucune menace.
C’était des festivals de l’amitié. Drapeaux rouges, rubans
rouges flottaient aux boutonnières, et les visages étaient rieurs.
C’était comme si les jours sombres et pluvieux de novembre
s’étaient transformés en printemps. Tout le monde nageait dans la
confiance mutuelle. La révolution avait commencé, et elle avait
commencé par une fraternisation universelle des classes.13
Cela
ne devait pas durer longtemps.