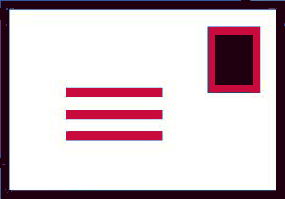Il
n'y a jamais eu de périodes dans l’histoire récente de
l’Allemagne aussi favorables à une révolution socialiste que
l’été de 1923. Dans le tourbillon de la dévaluation monétaire
toutes les idées reçues d’ordre, de propriété et de légalité
avaient s'était dissoutes. (...) Ce n’étaient pas seulement les
travailleurs dans leur ensemble qui ressentaient chaque jour plus
clairement que les conditions étaient intolérables et que le
système tout entier devait connaître un dénouement terrible. La
classe moyenne pillée et ruinée était également remplie d’un
ferment révolutionnaire. (Arthur
Rosenberg, un ancien intellectuel communiste « de
gauche »
écrivant dans les années 1930.)1
La
misère économique est trop grande dans les masses. (...) La misère
économique prépare le terrain sur lequel grandissent les semences
de coups d'Etat et de révolutions. (Un
rapport du commissaire prussien à la sécurité publique, au début
de 1923.)2
On ne
peut nier (...) que de larges masses de la classe ouvrière
s’éloignent de la tactique des vieux syndicats et recherche de
nouvelles voies. (...) Avec la meilleure volonté du monde, les
dirigeants (ne peuvent plus) plus tenir en main la classe ouvrière en
ébullition. (Un
social-démocrate d’Allemagne centrale, Horsing, dans un rapport au
gouvernement à l’été 1923.)3
L’Allemagne
était au bout du rouleau. Par d'incessantes grèves, manifestations
et combats de rue, les travailleurs protestaient contre le caractère
désespéré de leur existence. (Une
ancienne communiste écrivant dans les années 1960.)4
Une
dissolution de l’ordre social était attendue d’un moment à
l’autre (Le
ministre
des finances, se rappelant le passé immédiat en novembre 1923.)5
Nous
faisons face aujourd’hui à la crise la plus grave que le Reich ait
jamais connue (Ordre
général émis par le chef des forces armées, Seeckt, en septembre
1923.)6
La
situation en Allemagne est devenue telle que le problème de faire
une révolution victorieuse est devant nous dans toute sa magnitude.
(...) Les travailleurs accourent en masse vers notre parti. (...) La
prise du pouvoir est possible. (Brandler,
président du Parti Communiste Allemand, dans la Pravda
du 23 septembre 1923.)7
L’année
1923, pour la grande majorité des Allemands, fut l’Année de la
Faim. Ce fut l’année de la plus grande crise qu’ils aient
connue, l’année où les salaires tombèrent à moins de la moitié
de leur valeur de 1914, l’année où l’inflation détruisit
l’épargne d’une vaste section de la classe moyenne.
Ce
fut l’année où l’unité de l’Etat allemand semblait
moribonde, avec quatre puissances rivales occupant différentes
régions du pays : l’armée française en Rhénanie et dans la
Ruhr, l’extrême droite en Bavière, l’extrême gauche en
Allemagne centrale, et le gouvernement officiel au Nord. Ce fut
l’année où à la fois la gauche révolutionnaire et la droite
fasciste se mobilisèrent pour prendre le pouvoir. Pourtant, ce fut
une année qui se termina en laissant la démocratie bourgeoise plus
ou moins intacte.
Les origines de la grande
crise :
l’inflation
La
grande crise sociale de 1923 a été constituée de trois éléments
étroitement imbriqués. Le premier était une inflation sans
précédent, qui atteignit son pic à la fin de l’été. A ce
moment là, les prix doublaient en quelques heures. Des histoires de
la période sont entrées dans la mythologie sociale, bien au delà
de l’Allemagne : les queues de gens portant des boîtes en
carton à la banque pour y ranger les centaines de billets
nécessaires pour acheter quelques rares nécessités ; les
travailleurs payés à 11 heures du matin pour pouvoir aller faire
leurs courses avant que les prix n’aient doublé à midi ;
l’étudiant qui voyait le prix de sa tasse de café augmenter de
80 % pendant qu’il était assis devant elle ; et les
billets d’un million de marks utilisés comme papier mural.
C’était
l’argent-confetti dont les politiciens continuent sous nos yeux à
agiter le spectre. Ce qu’ils n’expliquent pas, cependant, c’est
comment
une inflation à une telle échelle a pu s’abattre sur une nation
dotée d’une des plus puissantes économies de la planète.
L’inflation
commença pendant la guerre, lorsque le gouvernement avait d’énormes
factures à payer. Il ne pouvait y parvenir en taxant les
travailleurs, qui vivaient déjà en dessous du niveau de
subsistance, et ne voulait pas faire payer ses amis du monde des
affaires. Alors il emprunta de vastes sommes, dans l’espoir de les
rembourser grâce aux bénéfices d’une victoire rapide. Lorsque la
victoire se fit prier, il eut recours à la planche à billets. Dans
les années 1914-1918 les prix doublèrent.
Mais
la politique consistant à financer de cette façon les dépenses de
l’Etat ne cessa pas avec la guerre. Elle comportait trop
d’avantages pour le grand capital. Les prix augmentèrent de
42 %
entre novembre 1918 et juillet 1919, et en février 1920 atteignirent
huit fois et demi leur niveau d’avant-guerre.
Dans
les années suivantes, les cercles nationalistes d’extrême droite
financés par les grands milieux d’affaires mirent l’inflation
sur le compte des réparations et des pertes de territoire
consécutives au Traité de Versailles. Mais c’était loin de
constituer une explication complète – le paiement des réparations
n’ayant pas commencé avant janvier 1920. Avant cette date vinrent
les énormes augmentations de prix mentionnées ci-dessus – et de
mars 1920 à mars 1921 la valeur du mark sur le marché des changes
resta stable. Puis elle s’effondra, passant de 70 marks pour un
dollar à 270 ; mais il y eut encore cinq mois de stabilité.
La
« grande inflation » commença à monter en puissance
en
juin 1922. Il fallait 300 marks pour acheter un dollar en juin,
8 000
six mois plus tard. Les prix intérieurs n’augmentèrent pas aussi
vite – mais ils s’élevèrent comme jamais auparavant. L’effet
sur les salaires était déjà catastrophique. En 1920, des groupes
tels que les mineurs avaient vu leurs salaires réels s’améliorer,
passant de 60 % du chiffre de 1914 à 90 %. Pendant
l’année
1922 ils descendirent à moins de la moitié du chiffre de 1914.
Le
retour de l’inflation en 1922 n’était pas
« inévitable ».
Bien des économistes dévoués au capital, à l’époque et depuis,
ont diagnostiqué qu’elle aurait pu être conjurée si le
gouvernement avait été prêt à utiliser ses réserves d’or et à
introduire un système fiscal adéquat. En fait, l’action du
gouvernement a bien
réussi
à trois
reprises à arrêter provisoirement la chute de la valeur de la
monnaie – en 1920, au début de 1922 et à nouveau en mars-avril
1923.
Mais
aucun gouvernement ne pouvait maintenir longtemps une telle
politique : elle fut obstinément combattue par les sections
les
plus puissantes du monde des affaires jusqu’à l’automne de 1923.
Comme trois historiens récents de l’inflation ont noté :
Les
représentants de l’industrie allemande propageaient inlassablement
leurs thèses, avertissant des conséquences qu’un renversement de
la tendance du mark à la baisse aurait pour les exportations,
l’emploi et l’économie allemande dans son ensemble.8
L’industriel
le plus influent était le « roi de la Ruhr »,
Stinnes.
La direction du département d’Etat américain pour l’Europe
l’appelait « l’homme le plus puissant d’Allemagne ».9
Stinnes parlait ouvertement de « l’arme de
l’inflation »
- et on pu voir quelle sorte d’arme c’était par ses effets sur
Stinnes lui-même.
L’empire
industriel contrôlé par Stinnes s'était étendu par bonds
successifs en même temps que les prix montaient à partir de 1914.
Lui et ses collègues magnats avaient un accès permanent aux crédits
bancaires, qu’ils pouvaient rembourser des mois plus tard avec du
papier-monnaie qui ne valait plus qu’une fraction des actifs
« réels » que ces crédits avaient permis d’acquérir.
De cette façon ils pouvaient racheter les entreprises plus petites
qui n’avaient pas les mêmes liens avec la finance. Pendant la
guerre, l’empire de Stinnes s’agrandit jusqu’à ce qu’il
contrôle les mines, les aciéries et une partie de l’industrie
électrique.
Le
retour de l’inflation après la guerre lui permit de s’étendre à
la fabrication du papier et à l’imprimerie, aux journaux et à
l’édition, aux chantiers navals et aux lignes maritimes, aux
hôtels et à l’immobilier. Au bout du compte, il possédait
4 000
entreprises distinctes. Et ce n’était pas tout. Le fait qu’il
contrôle l’industrie de l’exportation lui fournissait des
devises étrangères, avec lesquelles il pouvait spéculer contre le
mark à volonté, et acheter pas moins de 572 entreprises étrangères.
La
politique gouvernementale de financement des dépenses par la
création de monnaie avait un grand avantage de plus pour Stinnes et
ses amis : ils payaient les impôts de l’année passée avec
l’argent de l’année en cours, qui ne valait plus qu’une
fraction de la taxation originale. En fait, ils ne payaient pas du
tout d’impôt : en été 1923, les recettes fiscales du
gouvernement ne couvraient que 3 % des dépenses.
Chaque
fois qu’un gouvernement essayait de stabiliser le mark, c’étaient
les grands industriels qui sapaient délibérément ses efforts.
Ainsi, en 1920 ils réagirent à un impôt d’urgence sur la
propriété en déplaçant des fonds à l’étranger et en réduisant
la valeur du mark jusqu’à ce que les marks de papier avec lesquels
ils payaient l’impôt n’aient plus qu’une valeur négligeable.
En avril 1923, Stinnes prit la décision consciente de vendre de
grandes quantités de marks sur les marchés étrangers, ce qui donna
à la spirale inflationniste un nouvel essor. Stinnes et d’autres
comme lui « espéraient, par le sabotage de la taxation et une
inflation qui ruinait l’Etat, le peuple et le pays, sauvegarder
leur pouvoir et accroître la fuite de leurs capitaux à
l’étranger ».10
S’il
y avait le moindre doute à ce sujet, ils le dissipèrent eux-mêmes.
En 1920, et à nouveau en juin 1923, ils proposèrent un marché au
gouvernement. L’Association des Industriels du Reich se déclara
prête à consentir un prêt d’or et contribuer ainsi à stopper
l’inflation si « les autres partenaires sociaux faisaient
aussi des sacrifices » - un abandon complet des contrôles sur
les prix et les loyers, une extension de la journée de travail de
huit à dix heures « temporairement » (pour 15
ans !),
la réduction des salaires « non productifs », la
dénationalisation des chemins de fer, l’abandon des plans de
participation industrielle, et une « législation qui défende
et accroisse le capital industriel ».
Cela
revenait en pratique à démanteler tous les gains que les
travailleurs allemands avaient réalisés depuis la révolution de
1918. Les industriels avouaient implicitement que si la loi ne
satisfaisait pas leurs exigences, ils pouvaient réaliser le même
but, un accroissement massif des niveaux de profit, par l’effet de
l’inflation en appauvrissant la masse de la population. L’inflation
aboutissait à ce que les salaires étaient toujours en retard sur
les prix, la différence allant aux profits, même à une époque où
le gouvernement semblait encore faire des concessions aux salariés.
L’inflation
était incontestablement une « arme » - une arme pour
accroître la concentration et l’accumulation du capital aux dépens
à la fois des travailleurs et de sections de la classe moyenne.
Les origines de la grande
crise : la Ruhr
Le
capitalisme allemand et les gouvernements allemands des années 1920
faisaient face à un grave dilemme. Ils restaient enchaînés aux
buts et aux politiques impérialistes qui les avaient fait entrer en
guerre en 1914. Stinnes, par exemple, rêvait d’une Allemagne qui
serait capable d’éliminer la Pologne, de dominer la Russie et
l’Italie et de se répandre industriellement en Europe du Sud-Est –
la politique de Ludendorff et Hindenburg en 14-18, et plus tard celle
de Hitler.
Mais
l’Allemagne avait été battue et largement désarmée. Elle
n’avait pas la possibilité de se développer par des moyens
militaires. L’opposition de la France, par exemple, avait pu
bloquer la demande du parlement autrichien de fusion avec l’Allemagne
en 1919. Pire encore, l’Allemagne était elle-même la victime de
l’expansion étrangère. Elle avait dû céder des territoires à
la France et à la Pologne, et était obligée de livrer de l’or et
des biens comme « réparations » à la France, la
Belgique et l’Italie, parmi lesquelles un quart de sa production
totale de charbon.
Les
gouvernements sociaux-démocrates des premières années
d’après-guerre n’avaient pas vu d’autre choix que celui de se
soumettre à ces obligations. Ils suivirent ce qui devint connu sous
le nom de « politique d’acquittement »
(Erfüllungspolitik) –
essayer de payer ce qu’exigeaient les Alliés.
Mais
les partis bourgeois de droite trouvèrent politiquement avantageux
d’adopter une attitude d’extrême hostilité envers le Traité de
Versailles et les réparations. Ils n’étaient pas au gouvernement
et savaient qu’ils pouvaient facilement améliorer leur popularité
en mettant l’inflation et les difficultés au compte des
« traîtres
de Novembre » qui s’étaient « inclinés »
devant
le « diktat des puissances étrangères ».
Pour
les partis bourgeois « modérés » – les Démocrates et
le Parti du Centre catholique – les choses étaient un peu plus
difficiles. Les sociaux-démocrates comptaient sur eux pour conserver
une majorité parlementaire stable. Cependant ces partis ne voulaient
pas porter la responsabilité des concessions à
« l’ennemi »
du temps de guerre, sachant que cela leur aliénerait la sympathie
des partis situés sur leur droite.
Le
résultat était que l’Allemagne avait des difficultés à garder
un gouvernement stable, même après la défaite de la première
vague de révolution en 1919. Il y avait des crises ministérielles à
répétition, les partis bourgeois essayant d’accroître leur
emprise sur le gouvernement au détriment des sociaux-démocrates –
puis s’effrayaient des responsabilités liées à l’exécution
des termes du Traité de Versailles. Ainsi, ils firent sortir les
sociaux-démocrates de l’exécutif à l’été 1920, pour revenir
dans un gouvernement à participation social-démocrate, avec Wirth
comme chancelier, à peine 12 mois plus tard.
De
telles manœuvres ne pouvaient, en tout état de cause, arrêter la
croissance d’une extrême droite hostile à ces partis
« modérés ».
Un dégât collatéral était le doublement du vote d’extrême
droite entre 1919 et 1920. Un autre fut l’assassinat par des gangs
armés d’extrême droite de deux politiciens bourgeois associés à
la « politique d’acquittement » – Erzberger en août
1921 et Rathenau en juin 1922.
Le
grand capital encourageait l’extrême droite : le journal de
Stinnes, DAZ, avait un ton strident d’extrême
droite
nationaliste, pendant que Thyssen se vantait d’armer des groupes
terroristes de même sensibilité. Mais ils n’étaient pas assez
stupides pour croire que le capitalisme allemand pouvait opposer une
résistance complète aux exigences de l’Entente. Stinnes, par
exemple, savait que la guerre n’était pas une option. Alors il
essayait d’atteindre ses buts impérialistes par d’autres moyens
– en mettant la pression sur les Alliés, dans l’espoir que la
Grande Bretagne et les Etats-Unis cesseraient de s’entendre avec la
France, ouvrant une possibilité de compromis favorable à
l’Allemagne. Il rêvait d’un arrangement par lequel les
entreprises allemandes et françaises formeraient un trust conjoint,
sur une base 40/60, pour l’exploitation des ressources minières de
la Ruhr-Rhénanie et de l’Alsace.
Mais
en été 1922 les Alliés – en particulier les Français –
n’étaient pas d’humeur à conclure des compromis. Le capitalisme
français, comme le capitalisme allemand, avait encore des dettes
laissées par la guerre. Il subissait des pressions pour payer ce
qu’il devait aux autres puissances de l’Entente et pour donner
quelque chose aux classes moyennes. Un nouveau gouvernement, présidé
par Poincaré, posa ses exigences : si les réparations
n’étaient pas payées dans leur totalité, il mettrait en
mouvement les troupes qui occupaient déjà le sud de la Rhénanie
pour prendre le contrôle du centre de l’industrie allemande, la
Ruhr.
Le
grand capital allemand était convaincu que si la France mettait sa
menace à exécution, elle en souffrirait davantage que l’Allemagne.
Le chaos en résulterait, interrompant la livraison des matières
premières allemandes à l’industrie française. Et l’Angleterre
et les Etats-Unis se retourneraient contre la France. Pendant ce
temps, les coûts subis par l’industrie allemande pouvaient être
récupérés par une augmentation de l’inflation aux dépens des
travailleurs et de la classe moyenne allemands. Comme le disait
Stinnes, « Une extension de la zone d’occupation française
est un moindre mal », comparée à la poursuite du paiement
intégral des réparations.11
A
la fin de 1923, le « roi de la Ruhr » avait un
gouvernement disposé à appliquer sa politique. Le gouvernement
Wirth soutenu par les sociaux-démocrates fut remplacé par le
gouvernement le plus droitier depuis la guerre, présidé par Wilhelm
Cuno, un membre du parti auquel Stinnes appartenait et qu’il
finançait, le Parti du Peuple Allemand. Cuno était aussi président
de la ligne maritime Hamburg-Amerika,
qui étaient liée aux intérêts des Rockefeller aux Etats-Unis.
Le
nouveau gouvernement rompit avec la « politique
d’acquittement », lança le slogan « le pain d’abord,
les réparations ensuite », et mit les Français au défi de
passer à l’action. Ces derniers réagirent conformément à leur
menaces. Dans la troisième semaine de 1923, ils occupèrent les deux
tiers du bassin de la Ruhr.
Le
résultat immédiat fut un sentiment d’unité nationale comme il
n’y en avait pas eu en Allemagne depuis août 14. Le gouvernement
Cuno se retrouva soudain extrêmement populaire. Sa politique fut
approuvée par le Reichstag avec seulement 12 voix (les communistes)
contre. Dans tout le pays se tenaient des meetings massifs
d’opposition aux exigences françaises : un demi-million de
personnes manifestèrent à Berlin.
Les
sociaux-démocrates mirent tout leur poids dans le soutien à la
politique du gouvernement dont ils venaient d’être éjectés. Ils
organisèrent leurs propres meetings nationalistes, et lorsque les
Français arrêtèrent un certain nombre de chefs d’entreprises de
la Ruhr, Vorwärts
proclama :
Que
ces gens soient des amis ou des ennemis du mouvement ouvrier est de
peu d’importance. Le sentiment légaliste et humanitaire des
travailleurs reconnaît instinctivement, dans un moment pareil, que
ces questions n’ont pas d’importance.12
Les
dirigeants syndicaux rencontrèrent des représentants des employeurs
et du gouvernement tous les quinze jours pour coordonner la
« résistance » à l’occupation. Le 15 janvier, ils
soutinrent une grève de protestation d’une demie heure. Dans la
Ruhr même, les travailleurs faisaient montre d’une solidarité
tout à fait inhabituelle avec leurs maîtres. Une tentative des
Français d’arrêter Thyssen se heurta à une menace d’action
gréviste de ses salariés : seuls ses arguments purent stopper
la grève.
La
politique officielle du gouvernement était la « résistance
passive ». Le but était que l’occupation se retourne contre
les Français, leur rendant difficile et coûteuse l’obtention des
réparations et des matières premières dont ils avaient besoin pour
leur industrie. Les fonctionnaires et la police se virent interdire
toute coopération avec les occupants, les cheminots cessèrent tout
mouvement de marchandises et les mineurs toute extraction sous la
menace des baïonnettes françaises.
Il
y eut une réponse quasi unanime des travailleurs et des
fonctionnaires gouvernementaux. Le réseau ferré de la Ruhr fut
bientôt paralysé ; il y eut des grèves spasmodiques lors de
l’entrée des troupes françaises dans les mines ; les centres
postaux et télégraphiques furent fermés. En fait, la réaction
alla au-delà de ce que voulait le gouvernement – elle se répandit
de la Ruhr aux régions de la Rhénanie qui étaient occupées par
les Français avec l’accord du gouvernement allemand depuis quatre
ans.
Les
Français essayèrent de briser la résistance en procédant à des
arrestations et en expulsant les employés gouvernementaux
récalcitrants : quelque 100 000 expulsions dans les
six
premiers mois de 1923. Tous les cheminots furent licenciés et
remplacés par des soldats français et des volontaires. Les
douaniers allemands furent éjectés, et les policiers de sécurité
remplacés par des gendarmes français. Des villes de la Ruhr comme
Bochum et Essen, théâtre de combats acharnés entre travailleurs et
troupes allemandes
en 1919 et 1920, étaient maintenant la scène d’affrontements
entre les manifestants et la police française. En août, les
Français avaient tué 121 travailleurs allemands.
Au
début, les efforts mis en œuvre par les Français semblèrent peu
efficaces. Ils ne parvinrent à expédier que 500 000 tonnes de
charbon entre janvier et mai 1923 – à peine 14 % des
réparations qui leur étaient dues. Mais il y eut dès le départ
des accrocs à « l’unité nationale » de la résistance
allemande.
Dans
l’esprit des industriels et des propriétaires de mines de la Ruhr,
la résistance était destinée à arracher des concessions à la
France. Il considéraient que cela ne valait pas le coup de subir
d’importantes pertes économiques. Et en janvier leur politique
était de continuer les livraisons de charbon aux Français, à
conditions que les paiements soient effectués en espèces :
Les
propriétaires de mines ont donc accepté, en accord avec le
gouvernement, de continuer contre paiement des livraisons de
charbon, et cela alors même que leurs journaux et les résolutions
de leurs associations appelaient le peuple allemand à résister à
l’invasion.13
Le
gouvernement finit par interdire ces livraisons par peur de troubles
dans la population, mais les propriétaires firent de leur mieux pour
poursuivre les opérations d’extraction, même si cela aboutissait
à l’accumulation de vastes stocks de charbon. Ils ne semblaient
pas non plus s’inquiéter outre mesure si, comme dans les mines de
Stinnes à Buer, les Français faisaient des envois quotidiens
prélevés sur les stocks ; jusqu’en juillet, les mines de
Krupp tournaient encore à plein rendement.
Les
réunions bimensuelles des syndicats et des employeurs furent
utilisées pour décourager
un excès de grèves de protestation contre les actes des Français.
Ensemble, ils proclamaient avec insistance que « l’ordre doit
régner face à l’occupant ».14
Les dirigeants syndicaux s’opposèrent
à un appel à la grève générale, et les patrons accordèrent au
début de février une augmentation de salaire de 77,7 % aux
mineurs de la Ruhr pour obtenir leur bonne volonté.
La
presse de Stinnes prêchait une hostilité implacable envers les
« traîtres » qui collaboraient avec les autorités
d’occupation. Mais Stinnes lui-même était engagé dans des
négociations secrètes avec les intérêts industriels français et,
indirectement, avec le gouvernement français. Pendant ce temps, des
peines de prison prononcées contre des industriels tels que Krupp
leur permettaient miraculeusement de continuer à diriger leurs
affaires de leurs « cellules » avant qu’ils ne
soient,
tout aussi miraculeusement, mis en « résidence
surveillée ».
Il
ne fallut pas beaucoup de temps pour que les Français, dans de
telles conditions, commencent à jouir d’un certain succès :
ils obtinrent que le réseau ferré local fonctionne à nouveau,
persuadèrent la population de l’utiliser, et, en prime,
expédièrent entre mai et août un million et demi de tonnes de
charbon. Comme l’a remarqué un historien de la République de
Weimar, « la soi-disant résistance passive de l'année 1923
est donc en réalité une fable ».15
Cela
ne l’empêcha pas, cependant, d’être une fable très coûteuse
pour la plus grande partie du peuple allemand.
Le
gouvernement devait à tout prix conserver le soutien des
travailleurs et des échelons inférieurs de l’administration dans
la Ruhr. Sans cela, non seulement la « résistance
passive »
s’effondrait, mais il y avait un vrai danger que les Français
encouragent le séparatisme rhénan – et bien sûr il fallait aussi
compter avec la puissante tradition socialiste révolutionnaire
locale. Moyennant quoi le gouvernement paya les salaires et les frais
de déplacement des 100 000 personnes expulsées par les
Français, promit le maintien de leur entier salaire à ceux qui
avaient été licenciés pour avoir directement résisté à
l’occupation, et les trois quarts du salaire à ceux qui avaient
perdu leur travail pour des causes indirectes. Pour couronner le
tout, le gouvernement fit ce qu’il put pour assurer le
ravitaillement de la région, pour compenser une pénurie qui
provoquait une inflation supérieure à celle du reste de
l’Allemagne.
Mais
les sommes payées à ce titre étaient des misères comparées aux
autres dépenses de « l’aide à la Ruhr » – les
crédits consentis aux charbonniers et aux industriels de la région.
Des prêts énormes leur furent accordés, financés par la planche à
billets, qu’ils utilisèrent aussitôt sans vergogne pour spéculer
contre le mark.
La
« résistance passive » qui avait si bien uni le
peuple
allemand en janvier avait fin avril des conséquences qui déchiraient
le pays comme jamais auparavant ; l’inflation cédait la place
à l’hyper-inflation ; la classe ouvrière appauvrie accusait
Stinnes et les profiteurs ; les classes moyennes ruinées
affluaient dans les partis antisémites d’extrême droite financés
par Stinnes et les profiteurs. Dans la Ruhr et sur le Rhin, le
chauvinisme avait fait place au progrès de l’influence communiste,
d’une part, et à une certaine dose de séparatisme rhénan,
d’autre part. Dans les villes d’Allemagne centrale, il y avait
une augmentation considérable de l’activisme ouvrier. En Bavière,
un développement sans précédent de la droite fasciste.
Les origines de la grande
crise : la droite
nationaliste
L’inflation
eut un effet dévastateur sur des sections entières de la classe
moyenne – ceux qui vivaient des pensions et retraites,
d'obligations à intérêts fixes, de leur épargne accumulée et des
rentes sur la propriété. Même ceux qui avaient des emplois
dépendaient de ces sources supplémentaires de revenus pour
maintenir une façade de « respectabilité ». Et
soudain,
leurs coupons, leurs dividendes et leurs livrets d’épargne étaient
sans valeur. Les éléments les plus « respectables »
de
la société allemande étaient au bord de la famine – les
fonctionnaires, les officiers à la retraite, les professeurs
d’université, les anciens policiers. Des gens qui avaient passé
leurs vies à cultiver soigneusement un style de vie qui les plaçait
un échelon au dessus des « gens du commun », se
retrouvaient brutalement projetés bien en dessous : la vieille
aristocrate faisait la queue à la soupe populaire ; la fille
du
général avait de la chance si elle parvenait à vendre son corps à
un matelot étranger pour des devises.
Pour
les partis d’extrême droite, il était très facile de tirer
avantage de cette situation. Pendant les premières années de la
république, ils avaient été marginalisés. Leurs valeurs étaient
celles des Freikorps, mais lors des élections, les deux partis de
droite – les Nationalistes Allemands, un parti paysan monarchiste,
et le Parti du Peuple Allemand, soutenu par les industriels –
recueillaient à eux deux à peine un cinquième des suffrages. Le
gros de la classe moyenne s’identifiait toujours avec les partis
républicains bourgeois – les Démocrates et le Parti du Centre.
L’extrême droite militariste n’était même pas une aile
extrémiste marginale : Hitler était à Munich pendant les
journées de la République des Conseils et ne joua absolument aucun
rôle politique.
Les
choses avaient déjà commencé à changer pendant l’hiver
1919-1920. Malgré tout la classe moyenne, dans l’ensemble, se
joignit à la lutte contre le putsch de Kapp et les partis de droite
furent ensuite embarrassés par leur soutien, même tiède, à Kapp.
En
1922, cependant, la déception envers la république s’était
véritablement installée. La droite croissait en force et en
agressivité. Et aux côtés de la vieille droite conservatrice
apparaissait une extrême droite nouvelle, militante, reposant sur
un noyau d’anciens membres des Freikorps. Ce sont les hommes qui
assassinèrent Erzberger en 1921 et Rathenau en 1922 – et qui
commirent 351 meurtres politiques en quatre ans.
Leur
force était assez grande, au milieu de 1922, pour inquiéter les
politiciens sociaux-démocrates et démocrates bourgeois qui avaient
utilisé les Freikorps contre la gauche en 1919-1920. En Prusse, le
ministre de l’intérieur social-démocrate Severing essaya
d’interdire les nazis et la formation militaire nationaliste
conservatrice Stahlheim ; et après le meurtre de Rathenau, le
premier ministre démocrate du Reich avait déclaré :
« L’ennemi est à droite ».
Mais
de tels efforts pour neutraliser la droite étaient futiles. Parce
qu’elle avait deux grands protecteurs : les autorités de
l’Etat en Bavière et le Haut Commandement des forces armées.
La
Bavière était un centre d’intrigues et d’influence pour la
droite depuis l’écrasement de la République des Conseils. C’était
l’endroit où le putsch de Kapp avait bénéficié du soutien le
plus durable, portant au pouvoir le très conservateur Parti du
Peuple Bavarois, avec un ministre de l’intérieur d’extrême
droite, Escherich. Celui-ci transforma la Bavière en une forteresse
pour tous les groupes d’extrême droite d’Allemagne. Il créa une
organisation armée nationale, l’Orgesch
(pour Organisation
Escherich)
basée sur les Gardes Locaux Bavarois forts de 45 000 hommes,
et
rassembla dans le pays les divers vestiges des Freikorps, parmi
lesquels la Brigade Erhardt, qui avait dirigé le putsch de Kapp, et
d’autres groupes armés qui avaient combattu les Polonais en Haute
Silésie.
Le
travail du ministre de l’intérieur bavarois bénéficia de la
collaboration du commandement de l’armée en Bavière. Grâce à la
médiation d’un certain capitaine Röhm, celui-ci commença à
coopérer avec le Parti National-Socialiste des Travailleurs
Allemands, ou nazi, qui s’était récemment développé autour du
démagogue antisémite autrichien Adolf Hitler.
Sur
le plan national également, les forces armées étaient un bastion
de l’extrême droite. Le commandant en chef, Seeckt, considérait
les 100 000 soldats que lui autorisait le Traité de Versailles
comme le noyau possible d’une armée bien plus importante dans
l’avenir. Il fut donc ravi d’encourager la prolifération de
groupes paramilitaires, à moitié secrets, qui œuvraient en liaison
avec l’armée et qui pouvaient y être absorbés si nécessaire. Il
maintint également la position qu’il avait prise à l’époque du
putsch de Kapp : « La Reichswehr ne tirera pas sur la
Reichswehr ». Peut-être pensait-il que l’extrême droite
était trop impatiente et se mettait en mouvement prématurément,
mais si elle réussissait, tant mieux.
Ce
que cela signifiait en pratique fut démontré en 1922 lors de
l’assassinat de Rathenau. Le gouvernement de Wirth fit voter une
loi d’exception contre l’extrême droite au niveau de tout le
pays – mais le gouvernement du Land de Bavière refusa tout
simplement de l’appliquer. Comme Wirth savait que l’armée ne
bougerait pas contre la Bavière, il fut forcé d’accepter un
« compromis » qui constituait une véritable
capitulation
devant la droite bavaroise. Les paramilitaires continuèrent à
parader à Nuremberg et Munich, et à recevoir un entraînement aux
bons soins de la Reichswehr en Bavière – Wirth était impuissant.
En
janvier 1923, ce fut au tour du premier ministre bavarois de reculer
face à l’alliance des nationalistes et des militaires. Inquiet
d’une vague grandissante de violence nazie, il interdit une série
de manifestations armées. Hitler prit langue avec le commandant de
l’armée en Bavière, Lossow, qui fit lever l’interdiction. Le
journal nazi notait avec satisfaction, après la parade des
6 000
sections d’assaut : « C’était un défilé
militaire, même s’il n’y avait pas d’armes ».
Sur
le plan national, la collaboration entre les militaires et l’extrême
droite connut un nouvel essor après l’occupation française.
Seeckt pensait qu’une action armée contre les Français serait une
folie. Mais il était tout à fait prêt à encourager des petites
opérations de guérilla organisées par l’extrême droite, et il
donna le feu vert à l’absorption de nombreux groupes fascistes
dans une section clandestine de la Reichswehr, la « Reichswehr
noire ». L’argent des industriels était utilisé pour
entraîner des volontaires nationalistes de toute l’Allemagne pour
des opérations contre les Français dans la Ruhr – ou contre la
gauche n’importe où.
Au
fut et à mesure que la « résistance passive » se
révéler être une plaisanterie, le nombre de ces volontaires ne
faisait que croître, et dans tout le pays de jeunes nationalistes
brûlaient du désir de combattre « l’envahisseur ».
Mais
la croissance des forces de la droite n’était pas due
essentiellement à la Ruhr. Elle avait saisi l’occasion pour
affermir sa position en Bavière, où en été même le très modéré
Parti Social-Démocrate fut à moitié persécuté :
La
situation à Munich pendant l’été de 1923 était fantastique. Des
rumeurs constantes d’un putsch nazi circulaient et atteignaient un
paroxysme toutes les quatre semaines. La nuit, la ville bouillait
d’excitation. Des sections d’assaut patrouillaient dans les rues,
rossant les gens qui n’avaient pas le bonheur de leur plaire. (...)
Dans les bâtiments du Münchener
Post (le journal du
SPD) et du Temple du Travail, les hommes du Détachement de Sécurité
Social-Démocrate, armés de fusils, de quelques mitrailleuses et de
grenades artisanales, se tenaient derrière des barricades faites
d’énormes rouleaux de papier et regardaient passer les colonnes
nazies.16
Pour
le Haut Commandement de l’Armée, les nazis et les groupes
similaires étaient un utile contrepoids aux forces de la gauche.
Déjà, en janvier, Seeckt et Cuno avaient envisagé la possibilité
de dissoudre le parlement et d’établir une dictature
« temporaire ». Mais ils avaient été obligés
d’abandonner cette idée du fait de l’opposition d’Ebert, qui
était toujours président. Mais l’idée ne fit que croître en
popularité, au cours de l’année, dans l’armée et les milieux
d’affaires.
En
Bavière, le gouvernement de droite local essayait lui aussi
d’utiliser les nazis à ses propres fins – pas seulement pour
terroriser la classe ouvrière, mais aussi pour préparer le terrain
à la formation d’un Etat autoritaire, dirigé par la droite
cléricale et autonome de Berlin.
Les
projets d’Hitler allaient au-delà de ceux des piliers dont il
avait besoin – l’armée et le gouvernement bavarois. Quelques
mois auparavant, Mussolini avait marché sur Rome et pris le pouvoir.
Hitler considérait la Bavière comme la base dans laquelle
rassembler une armée fasciste pour marcher sur Berlin. Mais pour y
arriver, il lui faudrait d’abord passer par les bastions
traditionnels de l’extrême gauche – le Land de Saxe, en
Allemagne centrale, la Thuringe et la Saxe prussienne.
L’inflation,
la crise de la Ruhr, la montée du fascisme et l’éclatement de
l’Etat national se nourrissaient mutuellement, créant une crise
sociale et politique générale dans laquelle la lutte contre
l’inflation ne pouvait être séparée du combat contre l’extrême
droite.
La classe ouvrière
L’année
1922 avait été satisfaisante pour les deux grands partis en
compétition pour influencer la classe ouvrière allemande. Les
sociaux-démocrates avaient l’impression qu’ils pouvaient se
reposer, maintenant que les années éprouvantes dans lesquelles la
collaboration de classe avait été menacée par la guerre civile
étaient passées. Dans ces temps moins turbulents, le résidu des
sociaux-démocrates indépendants s’était rapproché d’eux,
jusqu’à ce qu’une fusion se réalise à l’automne. Cela donna
au nouveau Parti Social-Démocrate unifié un regain d’influence
parlementaire, avec 170 des 466 sièges du Reichstag. Au surplus,
cela facilitait les rapports avec la bureaucratie syndicale, dont
l’allégeance n’était plus divisée entre deux partis
sociaux-démocrates rivaux. Même en Bavière, le SPD avait gagné du
terrain sur la droite. Et, jusqu’à la fin de l’année, il
semblait qu’aucun gouvernement national ne pût durer longtemps
sans la participation des sociaux-démocrates.
De
façon caractéristique, cependant, obsédés qu'ils étaient par ce
qui se passaient dans les sommets de la société, les
sociaux-démocrates négligeaient ce qui se produisait en bas, dans
les profondeurs de la classe ouvrière.
L’inflation
et les activités des paramilitaires de droite créaient un
mécontentement nouveau. Il y eut une série de grandes grèves. Le
meurtre de Rathenau produisit le même genre d’unité et de
détermination de la classe ouvrière que le putsch de Kapp deux ans
auparavant – même si cette fois cela n’alla pas jusqu’à des
offensives armées des travailleurs.
Dans
la base social-démocrate, on ressentait de plus en plus que les
dirigeants ne faisaient pas ce qu’il fallait pour faire face à la
situation. Cette année d’autosatisfaction social-démocrate fut
tout de même une année dans laquelle les effectifs du SPD
s’effritèrent légèrement – il perdit 47 000 membres.17
Et seulement la moitié des adhérents de l’USPD avaient suivi
leurs dirigeants dans le nouveau parti unifié.
La
direction du SPD ne pouvait rester hors d’atteinte de ce
mécontentement dans sa base militante. Certains leaders commencèrent
à hésiter sur l’application intégrale de la vieille politique.
Lorsque les sociaux-démocrates prussiens approuvèrent un
gouvernement local de « grande coalition » incluant
le
Parti du Peuple Allemand de Stinnes, de nombreux députés au Landtag
exprimèrent leur opposition. Lorsque la même idée fut évoquée en
novembre pour le gouvernement central, l’opposition était
suffisamment forte pour faire avorter le projet, que le groupe
parlementaire national rejeta par 80 voix contre 48.
La
conséquence de ce vote fut que le SPD fut évincé du gouvernement
par ses partenaires bourgeois. Mais il ne mit pas fin aux divisions
internes. Le nouveau chancelier, Cuno, était un réactionnaire
notoire, dont la direction du SPD « tolérait » le
gouvernement. Lorsque la Ruhr fut occupée, elle s’empressa
d’appuyer l’appel de la droite à « l’unité
nationale »
– même si près de la moitié du groupe SPD voulait le rejeter. Au
Landtag prussien, certains députés du SPD allèrent jusqu’à
voter avec les communistes contre la ligne du parti.
Le
Parti Communiste avait de meilleures raisons d’être satisfait de
l’année 1922. Sans être une année où il pouvait rêver de lutte
pour le pouvoir, il avait, petit à petit, pansé les blessures
causées par l’Action de Mars et la perte de tant de cadres
dirigeants.
La
direction mettait désormais toute sa détermination dans la
politique du « front unique ». Les membres avaient
pour
instruction de faire tous les efforts possibles pour agir avec des
travailleurs non communistes, de combattre à leurs côtés sur des
questions apparemment loin d’être révolutionnaires, pour montrer,
selon les termes de Brandler, que les dirigeants sociaux-démocrates
ne se battraient même pas pour un « quignon de
pain ».
Seuls les communistes pouvaient diriger de telles luttes et seule une
tactique communiste pouvait permettre de gagner.
Le
premier exemple frappant de ce que signifiait cette politique vint au
début de 1922. Le gouvernement, dans une tentative molle d’améliorer
ses finances et d’apaiser le grand capital, refusa les
revendications de salaires des cheminots, exigeant au contraire des
licenciements et une augmentation du temps de travail. Les dirigeants
des principaux syndicats sociaux-démocrates
« libres »
étaient prêts à accepter, par loyauté envers leurs amis au
gouvernement. Mais un syndicat de cheminots indépendant,
« apolitique » et traditionnellement conservateur
organisa la résistance.
« Les
membres de ce syndicat », disait un rapport au Congrès du
parti Communiste un an plus tard, « étaient loin d’être
révolutionnaires. Ils croyaient qu’une action purement
syndicaliste pouvait mettre en échec la politique du
gouvernement ».18
Mais
le gouvernement considérait qu’une question politique était en
jeu. Il voulait montrer à la classe ouvrière qu’elle devait payer
pour la restabilisation du capitalisme allemand. Ebert, en tant que
président de la république, interdit la grève. Le chef
social-démocrate de la police de Berlin confisqua la caisse de grève
du syndicat. Des dirigeants de la grève furent arrêtés. Aussi bien
l’armée que la Technische
Nothilfe, la force
anti-grève mis en place par Noske en 1919, furent utilisées pour
essayer de briser le mouvement.
Le
Parti Communiste était la seule force organisée, à l’intérieur
de la classe ouvrière, qui fut prête à soutenir la grève. Le
syndicat « libre » dirigé par les sociaux-démocrates
restait intransigeant dans son opposition à l’action – même si
la plupart de ses membres avaient cessé le travail.
Finalement
le syndicat « indépendant » qui avait appelé à la
grève recula face à ces pressions combinées. Mais les communistes
avaient pu convaincre des centaines de milliers d’ouvriers et de
petits fonctionnaires que les syndicats réformistes ne défendraient
même pas des réformes.
Alors
que la grève des chemins de fer se développait, les travailleurs
municipaux qui alimentaient Berlin en eau, gaz et électricité
cessèrent le travail. A nouveau les dirigeants des syndicats s’y
opposèrent, et à nouveau seuls les communistes appelèrent à la
solidarité.
Lorsque
200 000 métallos d’Allemagne du Sud entamèrent ce qui devait
être une grève de deux mois, les dirigeants syndicaux furent plus
prudents. Ils soutinrent verbalement
les grévistes, mais, une fois de plus, seuls les communistes se
joignirent aux grévistes eux-mêmes en appelant d’autres
travailleurs à des actions de solidarité, et en s’opposant à des
tentatives de diluer les revendications.
L’appel
à l’unité d’action n’était pas limité aux questions
économiques. Il y eut même une tentative de « front
unique »
international contre l’offensive capitaliste.
« L’Internationale »
dirigée par les Indépendants allemands (que l’on a appelée
« l’Internationale Deux et Demi ») persuada aussi
bien
le Comintern que la Seconde Internationale reconstituée d’envoyer
des délégués se réunir à Berlin. Peu de choses sortirent de
cette conférence, sinon des discussions acerbes – mais elle
fournit l’occasion de manifestations unitaires KPD-USPD dans toute
l’Allemagne.
Mais
la raison non-économique la plus importante pour l’action commune
était la montée de la droite paramilitaire. Après que des
affrontements sanglants se soient produits au début de juin à
Königsberg entre des travailleurs de gauche et l’extrême droite,
la direction communiste, dans une lettre ouverte, avertit les deux
partis sociaux-démocrates et les syndicats que c’était un prélude
à une offensive nationale de la contre-révolution. Il n’y eut
aucune réponse des sociaux-démocrates. Mais l’argument des
communistes dut sembler confirmé aux yeux de nombreux travailleurs
lorsque Rathenau fut assassiné à peine une semaine plus tard.
Le
meurtre provoqua une flambée de rage dans les rangs ouvriers. Les
sociaux-démocrates ne pouvaient plus ignorer les appels des
communistes à l’unité. Dans toute l’Allemagne, leurs membres
marchèrent aux côtés des communistes contre l’extrême droite.
Ils auraient déchiré leur carte du parti si leurs dirigeants
n’avaient pas fait un geste dans le sens de l’unité. Dans une
série sans précédent de réunions communes, des représentants des
deux partis sociaux-démocrates, des syndicats et du KPD négocièrent
les termes d’une réaction commune à l’assassinat. Les
communistes poussaient à la mise en pratique de la politique
acceptée verbalement par les sociaux-démocrates après le putsch de
Kapp – un appel à la purge de la Reichswehr, au désarmement des
paramilitaires d’extrême droite, à la libération des prisonniers
politiques de la classe ouvrière, et à la formation de contingents
armés de travailleurs pour faire face à l’extrême droite.
Les
sociaux-démocrates répondirent en disant que la solution était
dans l’action parlementaire, mais signèrent néanmoins un accord
provisoire pour des manifestations communes, ce qui s’avéra
suffisant pour satisfaire leur base. Ensuite, lorsque le gros de la
colère fut passé et que les différents dirigeants se réunirent
pour savoir quelle était la suite à donner à l’action, les
sociaux-démocrates rompirent les négociations avec le KPD sous le
fallacieux prétexte que les activités militantes du KPD dans
certaines localités l’avaient « privé
du droit » de
participer à un accord. Le SPD mettait toute sa foi dans une
nouvelle « Loi pour la protection de la république »
qui
fut votée en urgence au Reichstag – même si, comme nous l’avons
vu, cette loi ne pouvait être appliquée en Bavière et fut, en
fait, utilisée quelques mois plus tard dans le reste de l’Allemagne
contre
la gauche.
Cette
rebuffade n’empêcha pas les communistes de poser encore et encore
la question de l’unité d’action – liant en général
l’autodéfense contre les fascistes à l’unité contre
l’inflation, exigeant la saisie de la propriété industrielle par
l’Etat et sous le contrôle des conseils d’usine.
Les
appels du KPD étaient adressés aux dirigeants des organisations
social-démocrates, mais ils étaient destinés aussi aux oreilles de
leur base. Les organisations communistes locales s’employèrent à
attirer celle-ci dans les activités conjointes que ses dirigeants
refusaient.
Dans
les usines, les communistes argumentaient en faveur de conseils
d’usines puissants, qui ignoreraient les limites imposées par la
loi les réglementant, et qui s’uniraient de façon transversale
pour lutter sur les salaires et les conditions de travail.
Alors
qu’une poussée d’activisme sur les salaires commençait à se
développer vers la fin de l’année, une assemblée de délégués
de conseils d’usine de Berlin appela à une réunion nationale. Les
délégués adressaient pour commencer leur appel aux dirigeants
syndicaux, et lorsqu’il fut rejeté, ils décidèrent de continuer
sans eux. Le congrès qui en résulta n’était pas le congrès de
toute la classe ouvrière qui avait été demandé aux syndicats.
Mais c’était loin d’être une réalisation négligeable – avec
846 délégués, dont 657 appartenaient au KPD, 38 au SPD et 52
non-affiliés (vraisemblablement ceux qui avaient quitté l’USPD
lors de la fusion avec le SPD). C’était un important indicateur de
possibilités futures, et avant longtemps l’exécutif élu au
congrès allait jouer un rôle important dans le déclenchement et
l’unification de luttes majeures de la classe ouvrière.
Les
conseils d’usine n’étaient pas conçus comme restreints à un
rôle purement économique. Le but étaient qu’ils remplissent des
fonctions sociales et politiques embryonnaires. Ils étaient exhortés
à se lier à d’autres conseils d’usine et à des groupes de
femmes au foyer pour former des « comités de
contrôle »
– qui luttaient contre la hausse des prix et la spéculation sur
les produits de première nécessité.
En
fait, les comités de contrôle élargissaient le pouvoir des
conseils de l’usine à la communauté, maillant les organisations
locales de base de la classe ouvrière en un réseau serré capable à
la fois de combattre les effets de l’inflation et de regrouper les
travailleurs dans une autodéfense contre l’extrême droite.
Les
dirigeants communistes ont proclamé que ces comités avaient été
construits dans de nombreux endroits immédiatement après le meurtre
de Rathenau, avec des « affrontements sanglants »
avec
« la police ou l’Orgesch » dans « la
Rhénanie,
Magdebourg, la Hesse, Bade et Pfalz. A Zwickau les travailleurs
prirent pratiquement le pouvoir entre leurs mains. Il y eut aussi de
nombreux tués et blessés ».19
La
politique du « front unique » fut très critiquée à
l’intérieur du Parti Communiste. Une section notable des effectifs
considérait tout discours de collaboration avec les dirigeants
sociaux-démocrates comme « révisionniste », et les
détails de sa mise en pratique furent à l’occasion critiqués par
la direction du Comintern pour son « excès de
tolérance »
envers le SPD (après le Congrès des Trois Internationales et la
campagne consécutive à l’assassinat de Rathenau). Pourtant il est
incontestable que cette politique reconstruisit le parti en 1922,
après la dévastation quasi-totale de 1921. Les effectifs
s’accrurent de 38 000 nouveaux adhérents. Avec un total de
222 000 membres (parmi lesquels 26 710 femmes) il
était de
loin le plus important parti communiste du monde occidental. Et en
plus, le parti exerçait une influence considérable au delà de ses
propres rangs.
Les
suffrages gagnés par le KPD en étaient un indicateur. Même si son
attrait électoral n’avait rien de comparable à celui de l’USPD
de 1920, il pouvait, par exemple, recueillir 266 000 voix dans
les élections du Land de Saxe. Il avait 12 014 conseillers
municipaux, contrôlait 80 conseils locaux et était le parti le plus
important dans 70 autres.
Dans
les syndicats également la tactique du KPD s’avéra payante. Les
communistes prirent la direction du syndicat
« libre »
(en d’autres termes, social-démocrate) des cheminots à Berlin et
à Leipzig, du syndicat des travailleurs du bâtiment à Berlin et
Düsseldorf, des métallos à Stuttgart. Au congrès de 1922 de la
fédération des syndicats « libres », un délégué sur
huit était communiste et sur un certain nombre de questions les
résolutions du parti furent adoptées – malgré une purge
considérable des communistes par les bureaucrates syndicaux quelques
mois auparavant.
Le
KPD avait aussi une forte présence dans les conférences d’un
certain nombre de syndicats – à la conférence des cheminots un
cinquième des délégués étaient membres du KPD ; dans le
syndicat des transports un dixième ; et celui des travailleurs
municipaux un huitième.
Finalement,
une addition faible mais utile aux forces du parti vint du contrôle
de certains des syndicats dissidents constitués par les
« gauchistes » deux ou trois ans plus tôt :
le
Syndicat des Travailleurs Manuels et Intellectuels, qui avait
80 000
adhérents dans la Ruhr et en Silésie, et deux syndicats de la
construction navale de la côte nord-ouest.
Il
y avait cependant des faiblesses dans les relations du parti avec ses
partisans – qu’ils votent pour lui aux élections ou
combattent avec lui dans les syndicats. La plus grande faiblesse
semble avoir été sa presse. Le KPD était capable d’éditer 38
quotidiens locaux – grâce au financement des Russes.20
Mais leur vente combinée était seulement de 388 600
exemplaires – à peine un et demi par membre. Cela peut avoir eu un
rapport avec leur coût. Mais il ne fait aucun doute que le contenu
était en cause : le journal central du KPD, Die
rote Fahne, faisait
peu de concessions à la popularité – pas de photos, très peu de
dessins, un feuilleton à l’occasion, mais essentiellement page
après page de longs éditoriaux pas particulièrement bien écrits.
Souvent le style semblait indiquer que l’article n’était destiné
qu’aux membres du parti : le titre d’une première page
célèbre fut « Aux membres du parti », comme si
personne
ne s’attendait à ce que les sociaux-démocrates de gauche ou les
non-membres ne soient intéressés.
Mais
de telles faiblesses ne changeaient rien au fait que le KPD était le
parti révolutionnaire le plus influent et le plus puissant qu’une
puissance industrielle avancée ait vu, avant ou depuis. Il était,
bien sûr, plus petit qu’immédiatement après la fusion avec la
gauche du SPD, mais il était bien mieux organisé.