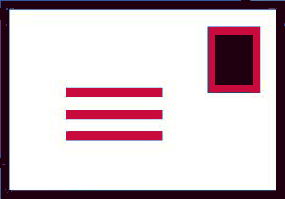A
l’été 1923, l’inflation prit des proportions absolument
démentielles. Jusque là, la monnaie s’était dépréciée à un
rythme hebdomadaire ou mensuel, mais il était encore possible de
s’adapter. Désormais, elle perdait de la valeur toutes les heures.
En juillet et août, le taux de change du mark contre le dollar était
réduit de moitié tous les quatre jours. Et, pour la première fois,
le pouvoir d’achat du mark en Allemagne même commença à baisser
plus vite que sa valeur sur le marché international.
La
masse de la population se trouva véritablement livrée au désespoir.
Sur
les marchés de Berlin, le prix des pommes de terre, des œufs et du
beurre changeait six fois par jour. (...) Le troc remplaça largement
les transactions en monnaie. Les gens offraient leurs derniers
bijoux, et leurs derniers meubles, pour avoir leur pain quotidien.
(...) Les masses en colère et désespérées se mirent à se
révolter, et il y eut des émeutes dans toute l’Allemagne.1
Un
changement significatif commença à se produire chez les
travailleurs. Il y avait eu, en dehors des zones occupées de la
Ruhr, un plein emploi relatif jusqu’au milieu de l’été, même
si le petit nombre des chômeurs était vraiment dans la misère la
plus complète. Mais à partir de la fin de juillet le boom
inflationniste arriva à sa fin, et de nombreuses firmes firent
faillite : le temps de porter leur encaisse à la banque, la
monnaie valait trop peu pour renouveler les stocks. Le chômage,
pratiquement nul au début de l’année, atteignait 6 % en août
et 23 % en novembre. Un grand nombre de travailleurs se
retrouvèrent en chômage technique partiel.
Mais,
au début, le niveau de chômage n’affecta pas la combativité et
la confiance des organisations ouvrières dans les usines. A la fin
de juillet, une autre vague de grèves commença, semblable à celle
de mai et juin, mais sur une bien plus grande échelle, et avec des
conséquences politiques autrement plus importantes.
En
Saxe, une grève de 20 000 mineurs avait éclaté le 25 juillet.
Trois mille mineurs prirent d’assaut les locaux de la fédération
patronale et les saccagèrent. Le même jour, les patrons de onze
usines de la ville saxonne d’Aue furent obligés d’accepter des
augmentations de salaires après des menaces de manifestations
armées. A Schneeberg, une semaine plus tard, les Centuries
prolétariennes saisirent une grande quantité de produits
alimentaires. Le 1er
août, les ouvriers des usines de huit villes voisines firent le
siège des négociations salariales en cours à Aue. Le 6 août,
c’était le tour de 4 000 ouvriers métallurgistes de Pobeln
de descendre dans la rue. Les Centuries traînèrent physiquement les
employeurs à la table des négociations et les obligèrent à faire
des concessions.
Des
rapports au Ministre de l’Intérieur du Reich se plaignaient :
« La force a été utilisée pour obliger les employeurs à
négocier, sans que les dirigeants syndicaux ou la police ne puissent
intervenir ».2
A Chemnitz, 150 000 travailleurs défilèrent dans les rues,
demandant le renversement du gouvernement.
Dans
la première semaine d’août, le mouvement gagna d’autres parties
de l’Allemagne. Il y eut de grandes manifestations à Stuttgart. A
Stettin, les dockers se mirent en grève. Au Brandebourg, des
salariés agricoles en grève commencèrent à se livrer à des
pillages. A Magdebourg les ouvriers ruraux cessèrent le travail le 9
août.
Pendant
ce temps, dans la région Ruhr-Rhénanie, 200 000 mineurs
commençaient une grève du zèle, malgré une augmentation de
salaire de 87 % à la fin juin. Celle-ci avait déjà été
absorbée par la valse des étiquettes. « Les manifestations et
les meetings contre les hausses de prix se multiplièrent. (...) des
affrontements avec la police se produisirent après un congrès des
sans-emplois et des bénéficiaires d’emplois d’urgence dans les
ateliers gouvernementaux, tenu les 28 et 29 juillet ».3
Il y eut trois morts à Oberhausen.
L’inflation
commença à causer une pénurie de denrées alimentaires qui à son
tour aggrava l’inflation : les paysans n’échangeaient plus
leurs produits contre du papier-monnaie ; les magasins
tiraient
leur rideau parce que les commerçants n’avaient plus les moyens de
reconstituer leurs stocks. Au moment où un conseil d’arbitrage du
2 août allouait aux mineurs de la Ruhr des augmentations de salaire
de 90 à 110 %, leur valeur avait déjà été réduite à
néant.
Dans
les mines et l’industrie lourde, les esprits ne se calmaient pas.
Des allocations spéciales de salaire furent exigées. C’est en
vain que les organisations centrales des travailleurs obtinrent le 9
août une augmentation de 245 %. (...) Les troubles se
répandirent.4
Ce
n’était pas surprenant. Le prix du charbon quadrupla dans la seule
journée du 9 août. Le coût de certains produits de première
nécessité avait été multiplié par vingt au cours du même mois.
A Berlin, il y avait déjà des grèves sporadiques dans les usines
de mécanique au début d’août et des arrêts de travail partiels
dans le réseau ferré municipal. Die
rote Fahne se fit
l’écho d’une grève des cols blancs dans l’industrie
mécanique. L’usine de Borsig s’arrêta le 9 août, puis les
ateliers du Métro. Mais ce fut la grève des imprimeurs, le même
jour, qui porta le mouvement à son sommet.
La
grève des ouvriers de l’imprimerie était officielle – mais les
dirigeants syndicaux ne voulaient pas impliquer les 8 000
travailleurs des imprimeries gouvernementales. Les communistes
réussirent à amener ceux-ci à cesser le travail – frappant le
gouvernement là où ça faisait vraiment mal. Car les presses qui
déversaient des quantités toujours plus grandes de billets de
banque cessèrent de tourner. Tout d’un coup, le flot énorme de
papier-monnaie nécessaire pour suivre l’envolée des prix se
tarissait. L’économie tout entière était menacée d’asphyxie.
Les
dirigeants communistes comprirent enfin la dimension des
évènements :
ils se mirent immédiatement à faire de l'agitation pour une grève
générale pour renverser Cuno et mettre à sa place un
« gouvernement ouvrier ». Les immenses ateliers de
Siemens, à Berlin, cessèrent le travail à la suite de Borsig, et
furent eux-mêmes imités par onze autres grandes usines. Désormais
les revendications n’étaient plus seulement économiques, mais
exigeaient le renversement du gouvernement. Les transports en commun
de la ville s’arrêtèrent complètement, puis les travailleurs de
l’eau, du gaz et de l’électricité posèrent eux aussi les
outils.
En
dehors de Berlin, il y eut un point mort total dans les zones
minières saxonnes5,
où les organisations armées de travailleurs montrèrent leur force
comme jamais auparavant : « Les Comités de Contrôle
semblaient dominer les marchés ».6
Dans l’ouest du pays, comme le disait un rapport destiné au
Ministre de l’Intérieur :
La
grève générale, malgré les syndicats paralyse Solingen, on se bat
à Krefeld, Homberg, Aix-la-Chapelle, Clèves, Opladen, Stoppenberg,
etc. Chômeurs et grévistes affamés pillent la campagne à la
recherche de nourriture. (...) Par douzaines, des plaintes et des
appels d’employeurs tombent sur le bureau du Ministre de
l’Intérieur. (...) Sur la rive gauche du Rhin les mineurs occupent
partiellement les installations et chassent la direction. (...) Dans
certaines mines des échafauds sont élevés avec des écriteaux
disant : « Ceci est pour vous si vous ne satisfaisez
pas
nos revendications dans les 24 heures ».7
Le
11 août, une conférence des conseils d’usine et de puits de la
Ruhr se réunit à Essen et formula les revendications de la grève
dans la région. En même temps que le renversement du gouvernement
Cuno et la formation d’un gouvernement ouvrier, la conférence
demandait le retour aux salaires réels d’avant-guerre, la journée
de six heures dans les puits et la réquisition des produits de
première nécessité par les Comités de Contrôle. A Hambourg, les
chantiers navals furent paralysés, et il y eut des tirs dans les
rues de Hanovre, Lübeck et Neurode.
A
Berlin les syndicats ne pouvaient ignorer la pression de leurs
membres. Ils furent obligés de donner au moins l’impression de
diriger le mouvement. Ils convoquèrent une réunion spéciale de
représentants du SPD, de l’USPD croupion et des communistes le 10
août. Les communistes réitérèrent leur appel à la grève
générale. Pendant un moment, certains dirigeants syndicaux
profondément réformistes semblèrent s’engager, non sans
hésitation, dans ce sens. Ils avaient peur de perdre tout respect de
leur base s’ils s’opposaient à l’appel ; mais ils
craignaient tout autant, s’ils approuvaient le mot d’ordre, la
propagation d’un mouvement qu’ils seraient incapables de
contrôler. L’un des délégués du SPD était le vieil ennemi de
la révolution de 1919, Otto Wels. Il s’exclama que la grève,
c’était l’anarchie, l’aventurisme, le chaos – et cela juste
au moment, prétendait-il, où le gouvernement mettait en œuvre un
ensemble de mesures économiques d’urgence qui allaient commencer à
arranger les choses. Son intervention fit pencher la balance au sein
des directions syndicales. La grève générale fut rejetée.
Mais
les communistes savaient que la base des syndicats n’était pas
d’humeur à écouter les avertissements de ses dirigeants. Une
circulaire fut envoyée à tous les districts du parti :
Les informations que nous
recevons
indiquent qu’une situation semblable à celle de Berlin existe dans
tout le pays. Partout, il y a des grèves du zèle et des arrêts de
travail. Il est nécessaire d’unifier ces mouvements et de leur
donner une orientation. Nous devons essayer d’obtenir des comités
locaux de l’ADGB [la principale fédération syndicale] qu’ils
prennent la tête du mouvement spontané. Là ou cela n’est pas
possible, les conseils d’usine doivent diriger et organiser le
mouvement.
C’était
précisément en vue d’une telle occasion que les communistes
s’étaient employés, pendant toute l’année passée, à
construire des organisations locales et nationales de conseils
d’usine hors d’atteinte du contrôle des bureaucrates syndicaux.
Le Comité des Quinze élu lors de la Conférence Nationale des
Conseils l’année précédente prit l’initiative d’appeler à
une réunion de délégués des conseils d’usine berlinois pour le
lendemain (11 août).
« Les
grandes salles débordaient de monde », se souvient un des
participants :
Les
rues (...) débordaient de voitures et de camionnettes que les
conseils d’usine avaient réquisitionnées dans les usines pour
avoir un moyen de transport rapide pour les travailleurs. Dans les
rues avoisinantes, il y avait des voitures de police, mais ils
n’osaient pas intervenir.8
Il
y a diverses estimations du nombre des présents. L’historien
français Broué donne le chiffre de 2 000, l’historien suisse
Favez, sur la base de documents officiels, dit que
« 10 000
comités d’entreprise étaient représentés »9
et l’Allemand de l’Est Ersil écrit que « s’assemblèrent
là près de 20 000 comités d’usine, parmi lesquels des
milliers de sociaux-démocrates ».10
Sans s’arrêter aux chiffres, une chose est certaine. Le mouvement
des conseils d’usine, qui semblait si faible neuf mois plus tôt,
avait généré une force capable d’unir la classe ouvrière
indépendamment des bureaucrates syndicaux.
La
réunion appela à une grève générale immédiate avec les
revendications suivantes : renvoi du gouvernement
Cuno ;
formation d’un gouvernement ouvrier ; réquisition des
produits de première nécessité sous le contrôle des organisations
ouvrières ; salaire minimum immédiat de 10
pfennigs-or ;
levée de l’interdiction des Centuries prolétariennes.
Le
Comité des Quinze donna des orientations à la grève générale –
élection de comités de grève, organisation de Comités de Contrôle
et de Centuries prolétariennes, désarmement par les Centuries des
groupes fascistes, propagande et fraternisation avec les soldats et
la police.
La
police saisit une édition spéciale de IDie
rote Fahne qui était
destinée à diffuser l’appel des conseils d’usine. Mais si la
répression avait pour but d’empêcher le développement du
mouvement, elle en fut pour ses frais. Berlin était complètement
paralysée par la grève.
la
capitale privée d’eau, de gaz, d’électricité, de journaux – à la fois
morte et tendue, où se multiplient les meetings, les
cortèges (...)11
L’appel
de Berlin donna un élan renouvelé aux mouvements hors de la
capitale. A Halle, 1 500 travailleurs participèrent à un
congrès local des conseils d’usine – 339 d’entre eux étaient
des délégués des puits, qui votèrent par 320 voix contre 19 pour
la grève générale. Il y avait dans la majorité favorable à la
grève 70 délégués du SPD.12
La grève fut effective à la fois dans la zone de Halle-Merseburg et
dans celle, traditionnellement plus social-démocrate, de Magdebourg.
Les travailleurs allaient de puits en puits et d’usine en usine,
propageant l’action.
La
grève générale fut un peu plus lente à gagner la Saxe et en
Thuringe – elle ne fut pas réellement engagée avant les 13-14
août. Mais il était toujours possible, le 14, à un certain Dr
Weigel de se plaindre, au Landtag, de la « terreur »
exercée pendant les négociations salariales, lesquelles se tenaient
« régulièrement face à des manifestations locales »
qui « menaçaient les dirigeants des employeurs » -
par
exemple à Aue, Schneeberg et Annsberg.13
En
même temps que la grève faisait tache d’huile dans tout le pays,
elle mena à une vague de manifestations et de batailles de
rue :
Dans
toutes les grandes villes ouvrières où la grève s'étend, des
bagarres éclatent. (...) Le 12 août, collision entre manifestants
et policiers à Hanovre, Rotthausen, Gelsenkirchen : trente morts. Le
13, nouvelles manifestations, nouvelles fusillades, plus graves, un
peu partout : six morts à Wilhelmshaven, vingt à Hanovre, quinze à
Greisz, dix à Aix-la-Chapelle, vingt à Zeitz, trente à Iéna, un à
Breslau, quatre à Crefeld, quatre à Ratibor.14
Il
y a eu depuis bien des discussions sur l’échelle exacte du
mouvement. Des historiens comme Ersil, Broué et Favez en donnent la
représentation d’un soulèvement énorme. Pour l’historien
américain Angress, au contraire, ce n’aurait été guère plus
qu’une tempête dans un verre d’eau. Il admet que l’appel à la
grève « fut suivi d’un effet d’une intensité surprenante
dans plusieurs groupes professionnels à Berlin », mais il
prétend que « même là, il ne prit pas les proportions d’une
grève générale ». Il écrit ailleurs :
« L’Allemagne
du Sud dans son ensemble et la Ruhr n’en furent pas
affectées ».
Mais
c’est tout à la fois ignorer la documentation officielle du
mouvement de grève citée par Favez et Ersil et traiter la grève
générale isolément des arrêts de travail partiels qui l’ont
précédée, en particulier dans la Ruhr. Il est clair que ces
journées semèrent l’inquiétude dans les sections les plus
conscientes du capitalisme allemand. Stresemann, le dirigeant du
Parti National du Peuple Allemand, confiait à l’ambassadeur
britannique :
[Stresemann]
pense que les communistes ne pouvaient pas laisser passer l’occasion
présente. (...) Toutes les circonstances sont en leur faveur. Jamais
une pareille occasion ne se présentera à nouveau à eux. Stresemann
a dit : « J’ai donc peur de deux choses, d'un succès
communiste immédiat et d'une réaction nationaliste violente qu’il
déchaînerait…’ »15
La
grève générale eut lieu alors que le gouvernement était de toutes
façons au bout du rouleau. Sa tentative de résoudre la crise de la
Ruhr en faisant intervenir les Britanniques venait d’échouer. Il
devait faire face à l’inflation. Et maintenant toute la classe
ouvrière semblait être tombée sous l’influence des communistes.
Cuno, « l’homme fort » huit mois plus tôt, qui
caressait des rêves de dictature personnelle, se disait désormais
« trop fatigué » pour continuer.
Le
capitalisme allemand trouvait des raisons d’être rassuré, comme
si souvent par le passé, dans l’attitude de la social-démocratie.
Le 10 août, le vote des députés du SPD permit à Cuno de faire
passer ses mesures financières. Le 12, la grève générale les
faisait changer d’attitude – leur « neutralité
bienveillante » ne pouvait plus maintenir Cuno au pouvoir. La
question était dès lors de savoir quel genre de gouvernement devait
le remplacer. La direction du SPD décida de voter contre Cuno, mais
proposa de participer
à un gouvernement dirigé par son collègue de parti Stresemann –
Stresemann, porte-parole d’un secteur puissant du patronat
allemand, le chef d’un parti qui dépendait de l’argent de
Stinnes, devint chancelier.
Il
était très heureux d’avoir quatre ministres
sociaux-démocrates :
Dans
certains cercles politiques, on voyait la situation sous le même
jour que celle de l’automne 1918 : de même que l’entrée
des sociaux-démocrates dans le cabinet du prince Max avait été
alors nécessaire, la crise de 1923 exigeait la participation au
gouvernement du parti le plus fort de la classe ouvrière.16
La
décision de participer au gouvernement provoqua une intensification
des discussions dans le parti : 53 des 171 députés SPD
s’abstinrent lors du vote de confiance au Reichstag. Pour eux,
comme l’écrit l’historien pro-social-démocrate Landauer,
« c’était une humiliation de participer à un gouvernement
fédéral avec le Parti National du Peuple Allemand ».
Malgré
tout, un gouvernement fut ficelé qui unissait tous les partis
séparant la gauche révolutionnaire de la droite fasciste – de
l’économiste « marxiste », ancien dirigeant de
l’USPD,
Hilferding à ceux qui rêvaient, comme Stinnes et Cuno, d’une
dictature d’extrême droite.
L’accalmie
L’effet
immédiat de la constitution du nouveau gouvernement fut de casser la
dynamique de la grève générale. Son slogan essentiel était « A
bas le gouvernement Cuno » – et le gouvernement Cuno était
tombé.
Bien
sûr, la revendication était couplée à l’appel à remplacer Cuno
par un « gouvernement ouvrier ». Mais satisfaire
cette
demande signifiait se mesurer à un obstacle que les groupes de
grévistes ne croyaient pas pouvoir surmonter : les dirigeants
sociaux-démocrates, tous les travailleurs le savaient, refusaient
toute perspective de gouvernement ouvrier. Continuer à appeler à un
tel gouvernement pouvait être un slogan propagandiste, mettant en
évidence l’inclination pro-capitaliste des dirigeants du SPD, mais
ne semblait pas constituer, aux yeux de larges couches de
travailleurs, un objectif immédiatement réalisable au moyen de la
poursuite de la grève.
En
même temps, il était assez facile pour les plus gros employeurs
individuels de satisfaire un certain nombre de revendications
salariales : le taux de l’inflation était tel que des
salaires doublés aujourd’hui seraient réduits au quart de leur
valeur en moins d’une semaine.
Finalement,
les pressions matérielles subies par les travailleurs dans le sens
de la reprise du travail furent les plus fortes. Les caisses de grève
des sections syndicales et les économies individuelles des
travailleurs étaient vidées de toute valeur par l’inflation.
Manquer une journée de salaire signifiait ne pas manger – sauf si
la grève, devenant plus qu’une grève, menait à la réquisition
révolutionnaire de denrées alimentaires. De longues grèves
n’étaient plus matériellement possibles. Le choix était la
reprise du travail ou la révolution – et personne n’avait encore
fait de préparations pour une révolution.
La
grève générale commença à s’essouffler à Berlin, raconta
Brandler plus tard, malgré les tentatives des communistes de la
prolonger « au moins 24 heures » pour en faire une
grève
contre la nouvelle Grande Coalition.
Même
si nous à la Centrale nous avions décidé de ne pas s'arrêter
après trois jours, mais de faire grève au moins encore un jour, nos
camarades radicaux berlinois n'ont pas pu appliquer la décision,
mais reprirent le travail malgré notre décision, parce que la
force interne n'était plus là.17
Die
rote Fahne du 14 août
titrait : « Des millions en lutte ». Mais la
reprise
continua à Berlin, et dans l’après-midi une édition spéciale
appelait à « terminer la grève dans l’unité ».
« La
grève est terminée », ajoutait-elle, « préparons-nous
pour la prochaine ». Ruth Fischer, de la soi-disant
« gauche »,
expliquait dans une réunion des conseils d’usine qu’ils devaient
tous reprendre le travail (ce qui ne l’empêcha pas d’attaquer
par la suite Brandler pour avoir pris la décision !).
N’y
avait-il aucun moyen de continuer la grève ?
Brandler
prétend que c’était possible en Allemagne centrale et en Saxe, où
la grève n’avait démarré à plein qu’après
la chute du gouvernement Cuno. Mais c’était parce que la grève y
était beaucoup plus politique qu’à Berlin, et que les
travailleurs étaient quasiment prêts à passer à l’offensive
révolutionnaire. Mais à Berlin même, disait-il, la grève était
encore basée sur des revendications essentiellement
« économiques »,
comme la vague de grèves de mai-juin en Allemagne centrale, en
Silésie et dans la Ruhr.
A Berlin, la grève contre Cuno
était la
continuation des luttes révolutionnaires sur les salaires dans la
Ruhr, en Saxe et en Haute Silésie. Mais à Berlin, cette lutte avait
une signification autre que dans la Ruhr, la Saxe ou la Haute
Silésie. C’est la grève qui causa la crise gouvernementale et la
chute du cabinet Cuno. Mais elle ne fut une grève politique que dans
ses conséquences, non au sens qu'elle se donnait des buts politiques
conscients.
Lorsque
la démission de Cuno fut obtenue, l’élan de la grève fut brisé.
Personne n'osera prétendre que nous aurions pu continuer cette lutte
contre la constitution du gouvernement de coalition.18
A
l’inverse, « Les camarades saxons entraient dans une grève
qui n’était pas économique mais politique, ce qui signifiait le
prélude d’un soulèvement armé ». Mais Berlin n’était
pas prête, et la Saxe ne pouvait aller de l’avant toute seule.
La
version de Brandler donne sans aucun doute un sens au tour immédiat
pris par les évènements. Ce qu’elle suggère, c’est que que le
véritable point faible du mouvement était Berlin (et la côte
Nord-Ouest) où la stratégie du front unique n’avait été mise en
œuvre qu’à contre-cœur par la direction locale, « de
gauche », du parti. Mais elle laisse sans réponse une
question : les choses n’auraient-elles pas été un peu
différentes si le parti était passé (comme Brandler lui-même le
suggérait) de la défensive à l’offensive deux ou trois semaines
avant
le déclenchement de la grève – s’il n’avait pas reculé sur
les manifestations de la Journée Antifasciste – et s’il avait
lancé un slogan plus
clair que celui de
« gouvernement ouvrier » ?
En
tout état de cause, la suite immédiate de la grève fut une baisse
du niveau de combativité. Dans les mines de la Ruhr, par exemple, la
lutte sur les salaires se termina rapidement, en dépit du fait
qu’une addition de 50 % à l’augmentation de 245 % des
rémunérations des mineurs ne suivait pas l’augmentation des prix
de 2 000 % par mois.19
La
faim et la colère ne disparurent pas. Loin de là. Le niveau de
pauvreté augmenta en même temps que les étiquettes étaient
libellées en millions et en milliards de marks. Il y eut davantage
d’échos de pillage des cultures dans la région de la Ruhr ;
les émeutes de la faim firent 13 morts à Aix-la-Chapelle20 ;
les 27-28 août, les chômeurs s’emparèrent de l’hôtel de ville
de Plauen ; dans la deuxième semaine de septembre, 13
personnes
furent tuées lorsque la police de Dresde attaqua une manifestation,
d’abord avec des matraques, puis en ouvrant le feu (bien que le
chef de la police saxonne fût un social-démocrate « de
gauche »).
Mais
ces incidents ne se combinaient pas pour former un mouvement national
comme du 9 au 13 août. Toute grande grève est suivie d’une
inévitable démoralisation : l’euphorie des manifestations et
des piquets de masse est remplacée par l’humiliation d’avoir à
nouveau à pointer et à obéir au contremaître. Cette fois-ci, la
reprise du travail fut accompagnée par une importante augmentation
du chômage, la prospérité due à l’inflation s’étant
transformée en récession inflationniste. En même temps que les
queues devant les bureaux de chômage s’allongeaient et que les
travailleurs commençaient à craindre pour leur emploi, les
employeurs passaient à l’offensive. Dans la semaine qui suivit la
grève générale il y eut 100 000 licenciements – parmi
lesquels de nombreux militants.
Les
forces de l’Etat elles aussi commencèrent à vouloir prendre leur
revanche. Deux cents grévistes furent arrêtés, la presse
communiste fut interdite, et le ministre de l’intérieur prussien
édicta des décrets mettant hors la loi à la fois le « Comité
des Quinze » de l’organisation nationale des conseils d’usine
et le comité des conseils d’usine du Grand Berlin. Dans la Ruhr,
« l’ennemi » français donna un coup de main, en
interdisant cinq journaux communistes.
Vers la révolution ?
Un
effet immédiat de la grève contre Cuno fut de d'éveiller
l'attention du mouvement communiste international – et les
dirigeants du Parti Communiste russe – à ce qui se passait en
Allemagne. Déjà, le 15 août, Zinoviev, le président du Comintern,
écrivait : « La crise se prépare. (...) Un nouveau
chapitre s'ouvre dans l'histoire du Parti Communiste Allemand et, par
conséquent, de l'Internationale communiste tout entière. ».21
Trotsky, en congé en Crimée, demanda à voir deux dirigeants
communistes allemands résidant à Moscou, Walcher et Enderle, et les
interrogea longuement sur la situation. Puis les dirigeants russes se
hâtèrent de rentrer à Moscou, où une réunion spéciale du
Politburo se tint le 23 août. Trotsky y exprima un point de vue que
tous les présents (y compris Radek) semblèrent approuver.
Le
moment d’une lutte décisive pour le pouvoir en Allemagne,
disait-il, l’Octobre allemand, approchait rapidement. On n’avait
que quelques semaines pour s’y préparer, et tout devait être
subordonné à cette préparation.
Des
dirigeants russes, Staline était le moins optimiste – il pensait
qu’il fallait attendre au moins jusqu’au printemps 1924.22
Quelques
jours plus tard, les dirigeants les plus importants du parti allemand
(parmi lesquels des représentants de la « gauche »)
furent invités à Moscou pour y discuter des préparatifs d’une
insurrection armée.
La
direction allemande était elle-même, à la mi-août, passée de la
défensive à l’offensive. Die
rote Fahne publia un
chapitre d’un livre sur la guerre civile, et conseilla au comité
national des conseils ouvriers d’agir en violation de
l’interdiction gouvernementale. Puis Die
rote Fahne reproduisit
l’appel de la direction russe : le 2 septembre, elle publia
une adresse du Comintern écrite par Trotsky, qui proclamait :
« l'Allemagne est en train de s'acheminer vers la
révolution ».
Le
président du parti allemand, Brandler, avait des doutes sur la
perspective insurrectionnelle. Il prétendit plus tard que Radek
partageait ces doutes : « Radek était convaincu de
l’irréalité de toutes ces décisions ».23
Mais Brandler fut bientôt intimidé par les arguments de Trotsky et
de Zinoviev : « Je ne m’opposai pas aux préparatifs
d’un soulèvement en 1923 », écrivit-il plus tard.
« Simplement, je ne considérais pas la situation comme étant
révolutionnaire, estimant qu’elle devait encore s’aiguiser. Mais
dans cette affaire je considérais Trotsky, Zinoviev et les autres
dirigeants russes comme plus compétents ».24
Il
fut décidé que toutes les forces de l’Internationale et du parti
allemand devaient être mises au service de la préparation technique
de l’insurrection. Trotsky voulait même qu’on lui assigne une
date :
le
P.C. ne peut rien commencer en s'inspirant d'une loi historique
libérale selon laquelle les révolutions se font, sans être faites,
sans pouvoir être fixées à l'avance. (...) C'est juste du point de
vue de l'observateur ; du point de vue du chef, c'est un lieu commun.
(...) Si le pays traverse une profonde crise, si les antagonismes de
classes y sont aggravés à l'extrême, si les masses laborieuses y
sont en constante effervescence, si le parti est suivi de la majorité
évidente des travailleurs, donc de tous les éléments actifs,
conscients et dévoués du prolétariat, le parti doit fixer un
moment, aussi proche que possible (...) puis concentrer les forces
essentielles à la préparation de la lutte finale, mettre toute la
politique et l'organisation courantes au service du but militaire
afin d'oser finalement, par la concentration des forces, le coup
décisif.25
Brandler
et Radek n’étaient pas d’accord avec l’idée d’une date fixe
pour la révolution (Trotsky avait suggéré l’anniversaire de la
Révolution Russe, le 7 novembre), mais ils étaient suffisamment
convaincus par l’approche de Trotsky pour proposer qu’il soit
envoyé en Allemagne pour préparer l’insurrection.
La
suggestion fut rejetée. Mais le Comintern s’efforça, pour la
première fois, de saisir une opportunité révolutionnaire :
dans l’histoire subséquente de l’Internationale, seules les
interventions en Chine au milieu des années 20 et en Espagne à la
fin des années 30 furent d’une plus grande échelle – et elles
n’avaient pas pour but d’organiser, comme en Allemagne, une
révolution prolétarienne.
Le
parti allemand avait déjà une organisation militaire secrète, le
M-Apparat (et aussi une organisation d’espionnage, le T – pour
Terror – Apparat). Le M-Apparat avait été renforcé l’année
précédente avec l’aide d’experts de l’Armée Rouge russe. Un
général de l’Armée Rouge, Gorev, fut envoyé en Allemagne pour
transformer tout cela en un mécanisme capable de mener à bien une
guerre civile. Il divisa l’Allemagne en six commandements
politico-militaires, correspondant aux six régions militaires du
pays. Ceux-ci furent à leur tour subdivisés en districts et
sous-districts. A chaque niveau correspondait une chaîne de
commandement, reliant les « détachements de
combat »
(Kampfleitungen)
chargés d’entraîner les Centuries prolétariennes et de les
conduire à la bataille.
Un
comité révolutionnaire présidait à toute la structure. Il avait à
sa disposition à la fois un certain nombre d’officiers russes et
quantité d’Allemands ayant connu, soit la Guerre Mondiale, soit
les Armées Rouges de 1919 et 1920. Parmi eux, par exemple, se
trouvaient Wilhelm Zaisser, plus tard le général Gomez de la guerre
civile espagnole, et Albert Scheiner et Hans Kahle, respectivement
commandant Schrindler et colonel Hans dans cette guerre.
Le
noyau des troupes rouges sur le terrain devait être fourni par les
Centuries prolétariennes. Elles étaient fortes, selon Brandler, de
60 000 hommes26 ;
de 100 000 hommes, pour la plupart d’anciens combattants du
front, d’après l’historien est-allemand Gast.27
Il y avait 300 Centuries distinctes en mai, et 800 en octobre.
Chaque
Centurie était basée dans une usine ou un district de la classe
ouvrière, et organisée comme un bataillon militaire. L’unité de
base était le « groupe » de 12, trois groupes formant
une « colonne » de 36 hommes, et trois colonnes, avec
ses
cyclistes et son équipe médicale, formant une Centurie. La plupart
de leurs forces étaient en Saxe et en Thuringe, où elles pouvaient
opérer ouvertement : 8 000 hommes défilèrent dans
Dresde
le 9 septembre ; 5 000 à Leipzig le 16 septembre.
Elles
étaient essentiellement constituées de communistes ; mais, en
Saxe au moins, il y avait des non-communistes et des
sociaux-démocrates à tous les niveaux.28
Mais
les Centuries ne seraient pas les seules à agir le jour venu. Tout
le parti était mobilisé comme pour une guerre, les dirigeants aux
niveaux national et local entrant dans la clandestinité pour éviter
des arrestations préventives. « Pas une cité du
pays »,
écrivit un communiste français qui était en Allemagne pendant
cette période,
où
l'on ne se soit consciencieusement préparé à la bataille avec le
souci minutieux d'hommes résolus à tout donner. Pas une journée
sans âpre labeur, pas une nuit sans tâche spéciale. Pas un
problème négligé. Je sais des camarades qui n'ont pendant de
longues semaines, pas dormi une nuit complète.29
Le
ton de la presse du parti était assez strident. Il y avait des
allusions continuelles à la lutte pour le pouvoir : par
exemple, un poème qui déclamait : « Formez fièrement
les rangs pour la lutte finale – unissez-vous, braves jusqu’à la
victoire » ; ou un titre : « La
voie de la
révolution prolétarienne en Allemagne ». Les journaux étaient
interdits – mais parurent assez souvent dans des éditions
semi-légales. Et leurs ventes montaient rapidement, malgré le fait
que la vente de la presse quotidienne dans son ensemble baissait.
Mais,
même à ce stade, tout n’allait pas pour le mieux. Beaucoup de
dirigeants ne savaient pas comment relier le but, encore vague et
distant, de la prise du pouvoir avec les luttes au jour le jour de la
classe. Ils empêchaient les travailleurs de s’engager dans des
« actions prématurées » – mais ne comprenaient pas
toujours à quoi d’autre ils se préparaient. A la fin août, le
principal théoricien du parti, Thalheimer, continuait à
écrire :
Il
faudra par conséquent parcourir, tant sur le plan politique que
celui de l'organisation, un long chemin avant de trouver les
conditions qui assureront la victoire de la classe ouvrière.30
Selon
Ruth Fischer (un témoin peu fiable), des dirigeants de premier plan
disaient :
En
aucune circonstance nous ne devons proclamer la grève générale. La
bourgeoisie découvrirait nos plans et pourrait nous écraser avant
que nous ayons bougé. Il faut au contraire calmer les mouvements
spontanés, retenir nos groupes dans les usines et les comités de
chômeurs, afin que le gouvernement pense que le danger est passé.31
Le
résultat, inévitablement, était un conspirationnisme plus fréquent
dans les groupes terroristes que dans les partis révolutionnaires de
masse. En même temps, le travail dans la masse des travailleurs
tendait à être négligé.
Brandler
déclara plus tard que pendant qu’il était à Moscou – une
période d’un mois – « il a manquà à ce moment la
campagne politique d'alarme du parti ».32
Le fait que Brandler, le leader le plus capable, ait été à Moscou
à ce moment crucial ne peut avoir été un facteur positif. Remmele,
un dirigeant qui s’opposait à Brandler sur la plupart des
questions, était pour une fois d’accord :
Tout
les autres travaux du parti, la mobilisation des masses,
l'unification des conseils d’usine, furent négligés parce que
tout notre appareil et nos permanents ne se souciaient que du
problème de l’armement et de l’organisation de l’action de
combat. (...) De telle sorte que tous les autres ponts menant au
prolétariat furent négligés.33
Pourtant
la classe ouvrière était pousée plus à bout que jamais. Le
chômage, après avoir doublé en août, passa dans la Ruhr de
110 000 au début de septembre à 160 000 à la fin
octobre. A côté des sans-emploi, il y avait cinq ou six millions de
travailleurs en chômage partiel. Les prix montèrent comme jamais
(ni avant ni depuis) : le coût de la vie augmenta de
165 %
entre le 13 et le 19 septembre. Le salaire moyen était estimé à
moins de la moitié du niveau de subsistance pour une famille de
quatre personnes. A Lübeck, on disait que les salaires étaient
tombés à 15 ou 20 % de leur niveau d’avant-guerre.34
Il fallait à un mineur une heure de travail pour pouvoir acheter un
œuf.
Les
grèves partielles économiques étaient désormais beaucoup moins
fréquentes. Le niveau de chômage aboutissait à ce que les
licenciements en étaient le résultat le plus probable. Le lock-out
devint plus répandu que la grève. Mais la colère pouvait encore
exploser dans les rues. Dans la province relativement arriérée de
Baden, des émeutes éclatèrent dans la petite ville de Lorrach,
avec pillage des marchés de rue et des boutiques. Des travailleurs
en grève prirent d’assaut la prison et libérèrent les
prisonniers.
Le 14
septembre, la ville était entre les mains de l’extrême-gauche.
(...) Les jours suivants les grèves et la violence s’étendirent
aux villes voisines, à Mülheim, Sackingen, Heidelberg, Karlsruhe.
(...) Les travailleurs de Baden marchèrent avec des drapeaux
soviétiques vers Lorrach, où la police d’Etat intervint. La poste
et le trafic ferroviaire furent interrompus.35
Dans
les territoires occupés, la colère trouva une expression légèrement
différente. Des groupes séparatistes rhénans de droite tentèrent,
avec l’encouragement des Français, de développer une agitation.
Mais des travailleurs dirigés par des communistes se battirent
contre la police et les séparatistes, au prix de nombreuses pertes.
Ce fut le « Dimanche Rouge » de Düsseldorf (30
septembre).
Le
mois de septembre vit des grèves continuelles en Allemagne centrale
– en particulier une grande grève du textile en Saxe – et
« une
grève de 150 000 travailleurs dans les territoires occupés, où
l’ajustement des salaires avait perdu tout sens du fait de
l’impossibilité de créer une indexation assez rapidement ».36
Un
Anglais qui résidait en Allemagne à l’époque décrivit dans son
journal intime l’atmosphère générale :
Avec
un salaire de 100 milliards, qui est la paye moyenne cette semaine,
un homme reste sous-alimenté. (...) Des hommes sont licenciés tous
les jours dans les chantiers navals et dans les usines, et l’Etat
paie une indemnité de chômage misérable. Des hommes, des femmes et
des enfants par centaines sont au bord de l’inanition, et il n’est
pas étonnant que les magasins soient pillés et que le bolchevisme
recrute des adeptes tous les jours.37
Dans
cette atmosphère, il y eut un mouvement perceptible vers la gauche
parmi les travailleurs qui demeuraient fidèles aux
sociaux-démocrates. Dans le SPD une nouvelle gauche émergea, qui
rejetait la Grande Coalition et appelait à la collaboration avec les
communistes. Ses leaders les plus connus étaient les anciens
dirigeants de l’USPD Crispien et Dittmann, le premier ministre
saxon Zeigner, et l’ancien responsable communiste Paul Levi. Mais,
de façon plus significative, elle avait l’allégeance des
dirigeants ouvriers les plus populaires dans des endroits comme
Zwickau et Plauen.
« Cette
opposition », rapportait un communiste en octobre
vient
d'avoir de grands succès dans tout le Reich. Elle est dominante dans
la plupart des districts de l’Allemagne centrale. Son influence
pénètre même dans les anciennes organisations de droite à Cologne
et Hambourg. La direction du district de Breslau a dû se prononcer
(...) pour la dictature de la classe ouvrière. Le 9 septembre,
l’opposition a conquis une majorité écrasante à l'assemblée
générale du district de Berlin. (...) Le groupe Lipinski [de
droite] a vécu dans sa citadelle de Leipzig.38
Les
grèves économiques, répandues et généralement victorieuses, de
mai-juin et du début d’août étaient reléguées dans le passé
par le climat nouveau de chômage de masse, mais une colère aveugle,
désespérée persistait dans la classe, pouvant exploser à la
première (correcte) étincelle.
Stresemann, la Bavière, la Saxe
A
la fin septembre le gouvernement Stresemann semblait en aussi
mauvaise posture que le cabinet Cuno qui l’avait précédé.
L’inflation faisait rage plus que jamais, accompagnée désormais
par une chute rapide de la production. Les ordres du gouvernement
central étaient le plus souvent ignorés en Bavière, où l’extrême
droite était plus fermement établie que jamais – 100 000
paramilitaires défilèrent devant Ludendorff et Hitler au début du
mois. Les injonctions gouvernementales étaient aussi peu respectées
par les gouvernements sociaux-démocrates de gauche de Saxe et de
Thuringe. Dans les régions de la Ruhr et de la Rhénanie, la tension
est telle que « seule une fin rapide de la résistance passive
paraît encore capable d'éviter l'explosion ».39
Les
grands industriels décidèrent que les choses étaient finalement
allées trop loin. « L’arme » de l’inflation se
retournait en fin de compte contre eux, et la
« résistance »dans
la Ruhr était trop coûteuse. Le 21 septembre, Stinnes confia à
l’ambassadeur américain : « C’est la fin. La Ruhr et
la Rhénanie doivent capituler. » Il ajouta que les ouvriers
auraient à travailler plus longtemps et plus dur, et qu’il y avait
« besoin d’un dictateur ».40
Helferrich, directeur de la Reichsbank et architecte de la politique
de la planche à billets, sentait désormais que
« l’effondrement
du mark menace la nation d’une catastrophe ».
Stresemann
écouta la voix de son maître le 26 septembre et annonça la fin de
la résistance passive. Un programme économique d’urgence fut mis
en place, dont le but était d’établir une monnaie stable. Pour la
première fois, Stinnes et compagnie coopérèrent avec le
gouvernement en acceptant le paiement des réparations en nature.
Cette
décision représentait un tournant crucial pour la classe
dirigeante. L’inflation et l’occupation de la Ruhr continuèrent,
mais pour la première fois depuis mars il y eut le sentiment, dans
les cercles du pouvoir, qu’une politique cohérente était mise en
œuvre, qui pouvait sortir le pays de ses tourments. Et cette
confiance en soi était la condition préalable du rétablissement
d’une emprise idéologique sur les classes inférieures.
Il
y avait encore de délicats problèmes à régler. Les industriels
exigèrent, comme prix de leur collaboration dans la politique
anti-inflationniste, l’abrogation de la journée de huit heures. La
fraction parlementaire social-démocrate savait cela et résista au
vote d’une loi-cadre donnant des pouvoirs économiques
exceptionnels au gouvernement. Il en résulta une crise mineure, qui
se termina par le renvoi de Hilferding du gouvernement. Mais il
restait deux ministres sociaux-démocrates et finalement, le 15
octobre, la loi-cadre passa avec le soutien du groupe SPD. Même
Angress, qui tend généralement à sous-évaluer
la force de la gauche dans la classe ouvrière à cette période,
admet que « La base du parti, dans l’ensemble, s’opposa à
son adoption. (...) Il y eut de nombreuses manifestations contre le
coût de la vie élevé ».41
Mais
le premier défi majeur à la décision gouvernementale du 26
septembre vint de l’extrême droite, qui dénonça avec colère la
« capitulation devant les Français ». Le gouvernement
bavarois décréta immédiatement l’état d’urgence et nomma un
dirigeant de droite, von Kahr, « commissaire
général »
– en fait dictateur – avec le slogan « Loin de
Berlin ».
Le prétexte de l’investiture de von Kahr avec des pouvoirs
dictatoriaux fut fourni par une réunion nazie provocatrice – mais
von Kahr désigna ensuite les sections d’assaut d’Hitler comme
« police d’exception », prit certaines mesures
antisémites et prononça la dissolution des « détachements de
sécurité’ sociaux-démocrates.
Le
gouvernement national de Berlin répliqua en décrétant l’état
d’urgence dans tout le Reich. Mais von Kahr, de la Bavière, refusa
de le reconnaître. Lorsqu’il reçut l’ordre d’interdire le
journal d’Hitler pour avoir calomnié Seeckt et Ebert, il refusa à
nouveau. Il fut rejoint dans sa rébellion par les unités bavaroises
de l’armée – le général qui était à leur tête, Lossow,
refusa soit d’obéir à Berlin soit de rendre son commandement, et
ses unités jurèrent fidélité à von Kahr au lieu du gouvernement
de Berlin. Lossow mobilisa les unités de volontaires présentes en
Bavière et les plaça sous le commandement d’Erhardt, l’ancien
dirigeant du putsch de Kapp, qui s’était évadé de sa prison de
Leipzig à peine quatre mois plus tôt et qui était toujours un
homme recherché dans le reste de l’Allemagne. Les unités de
volontaires furent stationnées le long de la frontière
septentrionale de l’Etat, menaçant directement la « Saxe
rouge » et prêtes à marcher sur Berlin si elles en recevaient
l’ordre.
Pendant
ce temps, en Allemagne du Nord, les unités de volontaires d’extrême
droite de la « Reichswehr noire » se mutinèrent le 1er
octobre, prenant deux forteresses importantes près de Berlin. Mais
le gros des officiers de l’armée du nord se rappelait de ses
mauvais calculs à l’époque du putsch de Kapp : les mutins
furent désarmés et leurs dirigeants mis aux arrêts de rigueur pour
une courte période.
L’attitude
des personnages clé, tant au gouvernement que dans l’armée, fut
de se désolidariser de la tactique d’Hitler, de Ludendorff, du
gouvernement bavarois et des volontaires de droite – mais ils
pensaient que ce désaccord ne devait pas mener à l’effusion de
sang si elle pouvait être évitée, car ils avaient tous intérêt à
maintenir un front uni contre la gauche. Le biographe de Stresemann
note :
Dans
l’opinion de Stresemann, les développements de Saxe et de Thuringe
étaient bien plus contrariants que la dispute de Munich. (...) Il
considérait les Bavarois, même s’ils étaient mal guidés, comme
des Allemands loyaux.42
La
Saxe et la Thuringe étaient des épines dans le pied du gouvernement
central depuis des mois. Depuis juin, les patrons charbonniers
demandaient la « pacification » de la région par
l’armée. Pendant les mois de juillet, août et septembre, les
Centuries prolétariennes et les Comités de Contrôle étaient
devenus de plus en plus puissants, prenant le pouvoir effectif dans
des localités entières pendant les grèves et les manifestations.
Les
gouvernements sociaux-démocrates de gauche n’étaient pas
complètement favorables à ces activités révolutionnaires :
ils refusèrent, par exemple, de soutenir un congrès des Centuries
en septembre. Mais ils refusèrent aussi de s’attaquer aux Comités
de Contrôle et aux Centuries – en partie parce que cela leur
aurait fait perdre leur soutien dans la classe ouvrière, mais aussi
parce qu’ils ne pouvaient y parvenir sans mettre en mouvement des
forces, au sein de l’armée et de la police, dont ils avaient peur.
Leur réticence à utiliser les policiers locaux contre les
travailleurs était liée à leur échec à purger complètement les
rangs de la police : de telle sorte que la police saxonne, par
exemple, pouvait toujours agir à sa guise, au nez et à la barbe du
gouvernement d’Etat, comme lorsqu’elle tira sur une manifestation
au début de septembre à Dresde, faisant 13 morts parmi les
travailleurs.
Les
ministres de gauche pensaient que le meilleur moyen d’empêcher une
intervention de l’armée dans les Länder était de promettre à
Berlin qu’ils maintiendraient l’ordre eux-mêmes. Zeigner, par
exemple, assurait au cabinet Cuno, le 8 août, que son gouvernement
réprimerait le mouvement révolutionnaire « avec une entière
détermination » en envoyant la police dans les zones
troublées43 ;
mais, en pratique, ces détachements policiers étaient rarement
envoyés. Brandler prétendit plus tard que « les gouvernements
sociaux-démocrates de Saxe et de Thuringe étaient impuissants face
aux communistes ».44
Les
historiens libéraux et sociaux-démocrates définissent le plus
souvent le premier ministre de Saxe Zeigner comme « plein de
bonnes intentions » mais « instable ».45
Ils oublient d’ajouter que cette caractérisation a été appliquée
à bon nombre de figures historiques, des Girondins de la Révolution
Française à Kerensky dans la Russie de 1917, de Dubček en
Tchécoslovaquie en 1968 à Allende au Chili : tous ont essayé
de conclure des compromis entre des forces politiques se polarisant
rapidement. Leurs « bonnes intentions », c’était
qu’ils savaient qu’une réaction triomphante (qu’elle soit
royaliste, tsariste, stalinienne ou de la CIA) signifierait un bain
de sang dans lequel ils perdraient leur propre popularité ;
leur « instabilité » consistait dans leur incapacité
à
adopter une position ferme contre la réaction, essayant plutôt
d’atteindre leurs buts par la persuasion de préférence à la
violence. Telle était la situation de Zeigner à l’automne de
1923.
Au
début d’octobre, il était clair qu’à un moment ou à un autre
le gouvernement central allait passer à l’action contre la Saxe et
la Thuringe. L’état d’urgence national donnait au gouvernement
des pouvoirs accrus qu’il pouvait utiliser contre la gauche. Déjà
un général, Müller, avait été nommé commissaire en Saxe, avec
des pouvoirs spéciaux qu’il avait utilisés pour mettre sous
juridiction militaire les réunions publiques, les publications et le
droit de grève. Ce n’était qu’une question de temps avant que
le gouvernement d’un Land qui refuserait d’obtempérer à ses
injonctions ne soit déposé par la force – que ce soit par les
troupes d’Erhardt parties de la Bavière et faisant mouvement vers
le nord, ou par celles de Seeckt et de Müller allant vers le sud en
provenance de Berlin.
Le projet de prise du pouvoir
Le
Parti Communiste passa le mois de septembre à faire des préparatifs
militaires pour la prise du pouvoir. Mais la mécanique finale de
l’opération ne fut décidée qu’à la fin du mois – à Moscou.
La
menace de la droite contre la Saxe et la Thuringe devait fournir
l’occasion d’une contre-offensive révolutionnaire. Dans toute
l’Allemagne, il y avait des millions de partisans du SPD qui
considéraient les gouvernements d’Allemagne centrale comme une
alternative positive à la Grande Coalition discréditée. Une
attaque de la droite contre ces gouvernements pouvait radicaliser ces
partisans, les poussant à l’action révolutionnaire aux côtés
des communistes. Ces derniers devaient montrer que la seule façon de
briser l’attaque sur la Saxe et la Thuringe était le passage des
travailleurs à l’offensive, avec la construction des Centuries
prolétariennes et le désarmement des paramilitaires de droite, de
la police et de la Reichswehr. Et ce n’était plus seulement un
thème de propagande. De tels mouvements défensifs devaient être
exécutés au moment même où commencerait l’attaque contre la
Saxe et la Thuringe.
Mais
même s’ils étaient présentés comme défensifs, ces mouvements
étaient également offensifs.
L’extrême droite et les unités de la troupe ne pouvaient être
désarmées que par des actions militaires contre elles. L’appel à
la défense de la Saxe et de la Thuringe était nécessairement un
appel à une offensive révolutionnaire massive, culminant dans la
mise en place d’un pouvoir nouveau. La base de celui-ci reposerait
sur un congrès des conseils d’usine – ce réseau d’organisations
ouvrières qui représentait le mieux la partie active de la classe
ouvrière, et qui était étroitement lié aux Centuries et aux
Comités de Contrôle.
Les
groupes communistes locaux, dans tout le pays, furent alors engagés
dans une préparation à l’action. Ils devaient établir des plans
locaux d’opérations – y compris des projets de réquisition des
approvisionnements vitaux, l’élimination des fonctionnaires locaux
les plus dangereux, la prise des centres de distribution électrique,
des chemins de fer et des télécommunications. Ils devaient surtout
trouver des armes pour eux-mêmes – localiser des postes de police
et des arsenaux dans lesquels des armes pourraient facilement être
saisies.
L’appel
à une grève générale nationale contre une attaque de la Saxe et
de la Thuringe serait le signal sur lequel tous les groupes locaux
devaient mettre leurs plans à exécution. Dans l’ouest, le
sud-ouest et l’Allemagne centrale les révolutionnaires devaient
prendre le pouvoir, envoyant toutes les unités dont ils pouvaient se
passer comme renforts à la bataille pour Berlin. Dans la Ruhr
occupée les soulèvements locaux devaient être évités, de peur de
conflits prématurés avec l’armée française d’occupation ;
mais les Centuries devaient pénétrer dans les zones non occupées
et y prendre le pouvoir. Puis autant de forces que possible devaient
être déployées le long de la frontière bavaroise, pour prévenir
des interventions venues de là tant que la plus grande partie de
l’Allemagne n’était pas aux mains des insurgés.
Le
rôle clé dans l’insurrection revenait à l’Allemagne centrale,
avec sa force légale de Centuries prolétariennes. « Nous
pensions pouvoir utiliser l’Allemagne centrale comme zone de
déploiement, que nous pouvions passer de la défensive à
l’offensive ».46
Un
élément du plan fut cause de dissenssion entre Brandler et les
dirigeants russes : les communistes devaient entrer dans les
gouvernements de Saxe et de Thuringe. Non pas parce qu’ils
croyaient qu’un gouvernement socialiste-communiste gérerait mieux
le capitalisme qu’aucun autre, mais dans le but de localiser les
stocks d’armes de la police afin que les travailleurs puissent les
saisir facilement. Ceci, proclamait Zinoviev, devrait les aider à
armer « 50 000 à 60 000 hommes ».47
Brandler objectait :
Le
gouvernement saxon n’était pas en situation d’armer les
travailleurs parce que, depuis le putsch de Kapp, toutes les armes
avaient été sorties de Saxe, à tel point que la police elle-même
n’était pas armée.48
Il
prétendit plus tard qu’il avait averti :
L’entrée
des communistes au gouvernement n’insufflera pas une nouvelle vie
dans l’action des masses, mais au contraire l’affaiblira :
parce qu’alors les masses attendraient des communistes qu’ils
fassent ce qu’elles ne pourraient faire elles-mêmes.49
S’il
donna effectivement cet avertissement, c’était un étrange
renversement des rôles : dans la discussion du mois de
décembre
précédent, la direction du parti allemand était fortement
favorable à des gouvernements communistes-socialistes et c’étaient
Zinoviev, Trotsky et Lénine qui étaient plus réservés.
En
tout état de cause, après que « Zinoviev ait frappé du poing
sur la table » et que « Trotsky ait passé une soirée
entière » avec Brandler, essayant de le convaincre,50
Brandler accepta la décision. Il rentra de Moscou en Saxe et, en
descendant du train, découvrit dans les journaux qu’il était
ministre !
La
décision sur la tentative de prise du pouvoir fut suivie par une
énorme campagne mondiale de propagande de la part du Comintern.
Partout, les partis communistes s’entendaient dire que, de la même
manière que dans le passé leur priorité avait été la défense de
la Russie ouvrière, désormais c’était le tour de l’Allemagne
des travailleurs. De façon caractéristique, l’hebdomadaire
communiste français, Bulletin
Communiste, qui avait
à peine mentionné l’Allemagne depuis des mois, se mit à donner
une couverture abondante des évènements d’outre-Rhin. Un
éditorial typique proclamait : « Cinq années après la
révolution démocratico-bourgeoise d'Allemagne, la révolution
prolétarienne est en vue. »51
– malheureusement, l’article parut après la défaite de la
révolution.
Nulle
part le message ne fut aussi martelé qu’en Russie même. Les
journaux, les affiches, les réunions, les manifestations
exploitaient le thème de « la révolution allemande qui
vient ». La Russie de 1923 était déjà loin de l’enthousiasme
prolétarien exubérant et de la démocratie de 1917. La guerre
civile avait prélevé une dîme énorme et la démocratie ouvrière
avait laissé la place à la pauvreté, la famine, la fermeture de la
plupart des usines, et le règne de plus en plus autoritaire d’un
parti dont les liens directs avec les travailleurs se décomposaient
rapidement. La guerre civile était terminée, pour abandonner le
terrain à la « retraite forcée » de la Nouvelle
Politique Economique. Le chômage de masse coexistait avec une
nouvelle couche privilégiée de petits négociants et de
bureaucrates.
En
1923, alors que Lénine, paralysé, se mourait, les pratiques
bureaucratiques avaient envahi le sommet même du parti, la fraction
stalinienne naissante manœuvrant, avec Zinoviev et Kamenev, contre
Trotsky.
Pourtant
tout ceci semble oublié dans les brèves semaines de ce début
d’automne. L’avance de la révolution allemande insufflait un
enthousiasme nouveau parmi ceux qui s’abandonnaient au cynisme ou
se bureaucratisaient. Les intrigues dans le parti étaient remplacées
par la recherche en commun des moyens de répandre la révolution. En
Russie, pendant ces semaines, on peut apercevoir, brièvement,
comment cette révolution aurait pu renaître si une Allemagne
révolutionnaire avait pu la sauver de l’isolement et de la
pauvreté.52
Lorsque
Brandler rentra en Allemagne, Trotsky l’accompagna à la gare,
l’embrassa sur les deux joues comme le dirigeant d’une révolution
saluant le dirigeant certain d’une autre. Staline lui-même, dans
une lettre à Thalheimer, faisait montre d’enthousiasme :
La révolution qui approche en
Allemagne
est l'événement mondial le plus important de notre temps. La
victoire de la révolution allemande aura plus d'importance encore
pour le prolétariat d'Europe et d'Amérique que la victoire de la
révolution russe il y a six ans. La victoire de la révolution
allemande fera passer de Moscou à Berlin le centre de la révolution
mondial.53
L’Octobre allemand
Désormais
les évènements atteignaient rapidement une tension paroxystique.
Les communistes avaient déjà, en septembre, menacé de déposer le
gouvernement social-démocrate de gauche de Saxe pour son échec à
purger la police saxonne, comme l’avaient montré les tirs sur les
manifestants à Dresde. Le gouvernement fut remanié avec trois
ministres communistes – Brandler, Böttcher et Heckert. De façon
significative, cependant, les sociaux-démocrates refusèrent aux
communistes le poste qu’ils voulaient le plus – le Ministère de
l’Intérieur, avec son contrôle de la police.
Zeigner
présenta son nouveau gouvernement au Landtag de Saxe le 12 octobre
comme un gouvernement de « défense républicaine et
prolétarienne ». Un de ses buts, disait-il, serait de désarmer
les formations militaires bourgeoises et de renforcer les Centuries.
Le président du groupe du KPD au Landtag exprima clairement
l’attitude de son parti : « Préparez-vous partout à
la
grève générale ! Faites des préparatifs pour stopper les
mouvements de la Reichswehr et des gangs armés contre les
travailleurs ! »
Frölich,
pour les communistes, déclara au Reichstag à Berlin :
Le gouvernement
socialiste-communiste est
une gouvernement de lutte contre la réaction, contre le séparatisme
en Bavière et en Rhénanie, contre la politique d’oppression des
grandes puissances économiques en Allemagne. C’est un pas vers la
libération du prolétariat allemand.
S’il
y a une tentative d’écraser la Saxe, ajoutait-il, « 15
millions de prolétaires décidés se dresseront contre vous ».54
De
leur côté, les autorités militaires de Berlin amplifiaient leur
pression sur la Saxe. Le général Müller interdit les Centuries
prolétariennes et les « organisations similaires »,
leur
donnant trois jours pour rendre les armes.
Le
décret fut défié ouvertement. Le même jour, 13 octobre, il y eut
un congrès des Centuries saxonnes à Chemnitz, qui constitua un
nouveau comité central du mouvement, composé de quatre
sociaux-démocrates de gauche et de quatre communistes.55
Les
deux partis tinrent des meetings dans toute la Saxe contre les
menaces de la Reichswehr. Ils furent renforcés par l’annonce, le
même jour, de la constitution d’un gouvernement de coalition
socialiste-communiste en Thuringe, engagé à construire « des
Comités de Contrôle réquisitionant les produits de première
nécessité » et une « Force Républicaine
d’Autodéfense ».
A
Leipzig, le ministre communiste Böttcher renvoya son ultimatum au
visage du général Müller et appela à l’armement immédiat des
Centuries. A Berlin, le Centre communiste appela les travailleurs à
s’armer pour se préparer à « une bataille pour établir un
gouvernement de tous les travailleurs ».
Le
général répliqua en édictant un nouveau décret le nommant chef
de la police saxonne – ce à quoi la dite police s’empressa
d’obéir – et en donnant à Zeigner un autre ultimatum : il
avait 48 heures pour se désolidariser de Böttcher. Zeigner refusa,
préférant faire un discours destiné à mettre en rage les généraux
de Berlin : il donna des détails sur les activités secrètes
des groupes paramilitaires attachés à la Reichswehr, la soi-disant
« Reichswehr noire ».
Les
menaces du général Müller contre ce qui était, après tout, un
gouvernement légalement constitué jeta la consternation dans le
seul parti du pays qui croyait vraiment à la constitution – le
SPD. Même des contre-révolutionnaires endurcis comme Otto Braun et
Severing se déclarèrent choqués. Il y eut des protestations dans
le cabinet. Une assemblée de délégués syndicaux tenue à Berlin
vota par 1 500 voix contre 50 pour une grève générale si la
Saxe était touchée. A Berlin, la direction de district du SPD
engagea des pourparlers avec les communistes sur la possibilité de
former un Comité d’Action unitaire en soutien au gouvernement
Zeigner. Le Vorwärts
lui-même dénonça l’état d’urgence – disant qu’il avait
été décrété sous le prétexte de lutter contre la droite mais
était en fait utilisé contre la gauche.
Mais
pour les dirigeants sociaux-démocrates de telles protestations
étaient des gesticulations à ne pas prendre trop au sérieux.
Lorsqu’une déclaration du gouvernement proclama que les unités
militaires étaient envoyées en Saxe pour défendre l’Etat contre
toute avance des paramilitaires de droite en provenance de Bavière –
les sociaux-démocrates firent semblant d’y croire.
Au
cabinet Stresemann raconta une autre histoire – mais qui évitait
toujours toute allusion au renversement du gouvernement
« constitutionnel » de Saxe. Les concentrations de
troupes, insistait-il, étaient destinées à « intimider les
éléments radicaux et à rétablir l’ordre public » – il
n’y avait rien dans cet exercice qui soit de nature à troubler des
ministres sociaux-démocrates qui avaient eux-mêmes utilisé les
Freikorps pour « intimider » la gauche.
Puis,
le 20 octobre, le général Müller proféra son ultime menace. Les
quelques soldats déjà en Saxe recouvrirent les murs de l’Etat
avec le texte d’une lettre de celui-ci à Zeigner. Müller,
disait-elle en substance, avait reçu l’ordre de déployer des
unités militaires pour « rétablir l’ordre constitutionnel
en Saxe ». Le lendemain matin, de larges contingents de
troupes
aux armes chargées commencèrent à traverser la frontière saxonne
– même si pour l’instant elles évitaient soigneusement toute
confrontation avec les travailleurs.56
C’était,
pour les révolutionnaires, l'heure de vérité. Ils devaient agir
immédiatement, ou reculer et assister au démantèlement de la base
de lancement de la Révolution Allemande. Comme l’a dit E H
Carr :
La
Reichswehr avait fait ce que Brandler n’avait pas osé faire. Elle
avait fixé la date à laquelle les communistes devaient soit agir,
soit confesser leur impuissance.57
Quelle
était l’humeur de la classe ouvrière allemande à ce moment ?
Les historiens et les révolutionnaires n’ont cessé depuis lors de
débattre sur le degré auquel la majorité des travailleurs était
prête à l’action révolutionnaire. Il ne fait aucun doute qu’il
y avait dans la classe laborieuse une grande colère. L’hebdomadaire
communiste français Bulletin
Communiste rapporta
qu’entre le 12 et le 18 octobre il y eut des combats dans les rues
de Hoesch, Francfort, Hanovre, Leipzig, Bibrich, Gelsenkirchen,
Düsseldorf, Cologne, Halberstadt, et que des magasins furent pillés
à Berlin.58
La
députée social-démocrate de gauche Toni Sender a donné par la
suite un récit des évènements de la même semaine à Francfort.
Elle décrit comment la nouvelle des mouvements contre la Saxe avait
coïncidé avec la fermeture d’une importante usine locale. A sa
grande horreur, elle découvrit qu’une réunion des conseils
d’usine locaux avait contraint les dirigeants syndicaux à appeler
à la grève générale dans cette ville généralement peu
combative.59
A
Hambourg, les nouvelles de Saxe parvenaient dans le cadre d’un
renouveau des luttes sur les salaires. Le 20 octobre, il y avait eu
une grève sur les docks qui s’était étendue aux entrepôts, et,
le même jour, les chômeurs et la police s’étaient affrontés
dans la rue. Le 21, les dockers votèrent pour la grève générale
s’il y avait une attaque contre la Saxe – et le lendemain une
réunion de représentants syndicaux de toute la ville appela les
dirigeants nationaux à déclarer la grève générale.
Au
cours des mêmes journées il y eut encore des échauffourées avec
des séparatistes rhénans qui tentaient de constituer une république
indépendante. Les séparatistes attaquèrent les hôtels de ville de
Speier, Bonn, Coblence, Krefeld et Gladbach. Selon un historien de la
République de Weimar, il y eut aussi des émeutes, avec des
victimes, dans les jours suivants à Aix-la-Chapelle, Berlin, Erfurt,
Cassel, Harburg, Essen, Marienburg, Francfort, Hanovre, Beuthen,
Lübeck, Braunschweig et Allenstein.60
On
peut mesurer l’irritation, dans la classe ouvrière, provoquée par
l’attaque contre la Saxe par le fait qu’elle parvint, une
quinzaine plus tard, à forcer les très respectables ministres
socialistes de Berlin à démissionner de leurs postes.
Mais
la question de savoir si cette colère ouvrière pouvait se
transformer en combativité ne pouvait être tranchée que par
l’action révolutionnaire. Le point était atteint où les
travailleurs n’étaient plus disposés à s’engager dans des
luttes pour des revendications limitées ou dans des grèves de
protestation : en dehors de toute autre considération, le
niveau de chômage était tel que les représailles étaient très
faciles pour les employeurs. Seule la lutte elle-même pouvait
prouver si l’exaspération qui avait fait tomber le gouvernement
Cuno s’était transformée en détermination révolutionnaire, ou
si, comme le pensait Victor Serge, alors permanent de
l’Internationale Communiste, « le chômeur passe, par des
gradations brusques, d’une fièvre d’insurgé à une lassitude de
résigné ».61
La
nécessité de soumettre le sentiment populaire à un test pratique
s’appliquait encore plus aux autres couches de la société. Depuis
que la « résistance passive » avait été abandonnée,
la classe dirigeante avait, pour la première fois depuis le
printemps, retrouvé une certaine confiance en elle, et se sentait
capable de résoudre la question des réparations et le problème de
l’inflation tout en préservant l’unité nationale. Mais il est
peu probable que cette humeur nouvelle se fût déjà répandue dans
les niveaux inférieurs de la fonction publique et de la petite
bourgeoisie, qui étaient plus paupérisés que jamais.
Dans
les rangs intermédiaires des forces armées la capitulation dans la
Ruhr avait accru, plutôt que diminué le courroux, même si c’était
habituellement l’extrême droite qui en bénéficiait. Cela faisait
des mois que le Parti Communiste dirigeait sa propagande vers les
rangs de l’armée et des fonctionnaires. Mais à elle seule la
propagande ne pouvait provoquer des failles réelles dans les forces
de l’Etat – seule l’action révolutionnaire en était capable.
La débâcle
Jusqu’au
21 octobre, la direction communiste semblait déterminée à l’action
qui seule pouvait mettre à l’épreuve le rapport des forces. Il
est vrai que l’initiative du général Müller contraignait les
communistes à agir plus tôt qu’ils ne l’avaient souhaité. Ils
n’avaient pas été capables, et de loin, d’armer autant d’hommes
qu’ils l’avaient espéré – ils avaient seulement 6 000
fusils au lieu des 60 000 annoncés. Il n’avait pas non plus
été possible de convoquer un congrès national des conseils d’usine
pour donner une légitimité à l’action révolutionnaire ;
l’interdiction gouvernementale du mouvement national des conseils
d’usine s’était avérée plus gênante que prévu. Mais dans
toute l’Allemagne il y avait des centaines de milliers de
communistes prêts à l’action. Et il semblait probable que leur
démarche serait suivie par une énorme section désorientée de la
social-démocratie.
Tôt
le matin du dimanche 21 octobre, alors que les troupes de Müller
commençaient à pénétrer en Saxe, Brandler expliqua le plan de
l’insurrection dans une réunion, tenue à Chemnitz, de
représentants de tous les districts du Parti Communiste. Il y aurait
le lendemain dans tout le pays une agitation pour la grève générale,
au moment où les ouvriers embaucheraient après le week-end. Le
mardi, dans le cadre de la grève, les unités révolutionnaires
armées exécuteraient les opérations qu’elles prévoyaient depuis
un mois et plus – prise de contrôle des postes de police, des
casernes, des centres de communication, des gares de chemin de fer et
des bâtiments administratifs.
L’appel
à la grève générale ne pouvait venir d’un congrès des conseils
d’usine pleinement représentatif. Mais il n’y avait pas lieu de
s’en soucier. Une conférence de diverses organisations ouvrières
de Saxe avait été convoquée conjointement par les ministres
sociaux-démocrates et communistes pour le même jour. Elle devait
discuter des actions à engager face à la détérioration rapide de
la situation économique – une personne sur sept, dans l’Etat,
était au bord de l’inanition. Il serait facile d’amener la
conférence à prendre en charge l’affaire urgente de la défense
contre l’invasion de la Reichswehr et de l’appel à la grève
générale.
Les
Centuries prolétariennes patrouillaient dans les rues de Chemnitz
pendant que les délégués à la conférence arrivaient en ville.
Mais elle n’eurent pas besoin d’intervenir. Müller jouait un jeu
attentiste rusé, évitant de provoquer les travailleurs d’une
manière qui aurait forcé les sociaux-démocrates à réagir. Les
498 délégués s’assemblèrent sans incident – parmi eux 140
venaient des conseils d’usine, 120 de sections syndicales, 79 de
Comités de Contrôle, 66 de sections du Parti Communiste, 7 du SPD.
Les travaux commencèrent de façon normalement routinière. Il y eut
des discours sur la crise économique, la pénurie aigüe de denrées
alimentaires et sur la montée catastrophique du chômage par le
ministre social-démocrate du travail, Graupe, et par les deux
ministres communistes, Böttcher et Heckert. Des délégués
intervenant de la salle abordaient les mêmes thèmes, mais certains
mentionnèrent les mouvements de la Reichswehr qui faisaient passer
au second plan les discussions sur le programme économique du
gouvernement. Puis Brandler monta à la tribune.
Il
proclama avec insistance que le moment était venu, pour les
travailleurs de Saxe, d’appeler à l’aide le reste de
l’Allemagne. Autrement, ils seraient écrasés. Leur seule planche
de salut était l’appel immédiat à une grève générale
nationale de solidarité. Il adjura les sociaux-démocrates de
renoncer à leur espoir vain de compromis pacifique avec Berlin. Seul
un vote immédiat et unanime pour la grève générale pouvait sauver
la situation.
Brandler
semble s’être attendu à ce que les dirigeants sociaux-démocrates
l’approuvent avec enthousiasme. Au lieu de cela, il essuya un
silence stupéfait.
Puis
le ministre social-démocrate Graupe prit la parole. La conférence
présente, dit-il, ne saurait par elle-même décider de la réponse
que les travailleurs saxons doivent donner aux menaces de l’armée.
La défense de la Saxe était la tâche du « Gouvernement de
Défense Républicaine et Prolétarienne » et de la majorité
socialiste-communiste au Landtag. Il serait tout à fait déplacé
que la conférence usurpât le pouvoir de ces institutions
officielles. Si une motion dans ce sens était déposée, l’ensemble
de la délégation social-démocrate quitterait la conférence.
Brandler
s’était mis – et la Révolution Allemande avec lui – dans une
situation impossible. Il s’était attendu à ce que les
sociaux-démocrates de gauche donnent leur accord à un projet dont
ils sauraient très bien qu’il signifiait la guerre civile – même
s’ils n’étaient pas au courant des préparatifs secrets des
communistes. Mais les sociaux-démocrates de gauche restaient, malgré
toutes leurs bonnes intentions, des sociaux-démocrates.
Ils avaient une foi sans limite dans les possibilités de compromis,
et n’étaient pas prêts à abandonner ces possibilités pour un
pari révolutionnaire, aussi désespérée que soit la situation. Ils
croyaient à moitié aux déclarations du gouvernement selon
lesquelles l’armée était en marche pour faire face à la Bavière
– et ils n’abandonneraient cette croyance que lorsque l’armée
elle-même aurait rendu impossible toute ignorance de ses buts réels.
Après tout, se disaient-ils, il n’y avait encore aucune certitude
que le rôle des politiciens sociaux-démocrates serait terminé.
Les
communistes prirent la menace de Graupe comme un signe que la base
des sociaux-démocrates ne soutiendrait pas une offensive
révolutionnaire, et se laissèrent convaincre de retirer leur
résolution. Brandler se souvenait, 36 ans plus tard :
Après
des discussions avec les autres membres de la Centrale je me
prononçai contre la proclamation d’une grève générale, et je
reçus dans cette démarche l’assentiment de tous les membres de la
Centrale présents, y compris Ruth Fischer.62
Dans
ce récit Brandler prétend que la situation militaire déterminait
sa décision – mais d’autres versions établissent clairement que
c’était le refus de combattre des sociaux-démocrates qui avait
été décisif :In Chemnitz auf der Konferenz zeigte
sich der
zweite Teil des Plans zerschlagen, nämlich der gemeinsame Aufmarsch
der sozialdemokratischen und kommunistischen Arbeitermassen. Der
Antrag auf Proklamierung des Generalstreiks und des bewaffneten
Aufstandes in Chemnitz wurde angesichts des Widerstandes der linken
S.D. [Sozialdemokratie] gar nicht gestellt ... Die
Zentrale
entschied sich, jedem Kampfe auszuweichen, aus der Anschauung heraus,
daß die Einheitsfront des Proletariats in diesem Kampfe nicht mehr
aufzustellen sei, daß es unmöglich sei, sie aufzustellen
[wenn
die Kommunisten allein vorangingen], und daß in dieser
Situation
bei den geteilten Kräften des Proletariats und dem Zustand der
technischen Vorbereitung der Aufstand unmöglich sei.
A
Chemnitz lors de la conférence, la deuxième partie du plan fut
battue – c’est-à-dire le soulèvement simultané des masses
ouvrières social-démocrates et communistes. La proclamation de la
grève générale et du soulèvement armé ne fut même pas proposée
à Chemnitz à cause de la résistance des sociaux-démocrates de
gauche. (...) La Centrale décida de refuser tout combat en se basant
sur l'idée que le front unique du prolétariat ne pouvait pas se
construire dans ce combat, qu'il était impossible de le construire
[si les communistes continuaient tout seuls] et que dans cette
situation, du fait de la division des forces du prolétariat et de
l’état de préparation technique le soulèvement était
impossible.63
En
tout état de cause, quels que soient les détails de la motivation,
la décision fut prise, à ce moment précis, d’abandonner la grève
générale – et avec elle la Révolution Allemande. L’appel à la
grève générale fut remplacé par la mise en place d’un Comité
d’Action qui devait sonder l’opinion du « mouvement
officiel ».
La
conférence avait eu lieu – et l’appel que les révolutionnaires
attendaient dans toute l’Allemagne ne fut pas lancé. L’axe
central de toute la stratégie révolutionnaire avait cessé
d’exister.
Une
réunion élargie de la Centrale communiste fut tenue immédiatement
après. Elle décida que puisque le plan pour la grève générale
était à l’eau, l’insurrection elle-même devait être annulée.
Des émissaires furent envoyés dans tout le pays avec des ordres
dans ce sens.
Lorsque
la Centrale se réunit à nouveau le lendemain, les troupes de Müller
avaient investi les rues de Chemnitz. Radek, fraîchement arrivé de
Moscou, était présent à la réunion. Il se déclara d’accord
avec l’annulation de l’insurrection, acceptant le fait que le
parti n’avait pas assez d’armes en Saxe – seulement 600 fusils
– et que, la classe étant divisée, la défaite était inévitable.
Mais il pensait que les communistes pouvaient encore appeler à une
grève générale défensive. « Tous les camarades présents
rejetèrent ce plan »64
– y compris les membres de la soi-disant « gauche ».
L’Octobre
Allemand, qui avait débuté sous des auspices aussi favorables,
s’était terminé par rien du tout. Les troupes de la Reichswehr
purent, quelques jours plus tard, déposer et emprisonner Zeigner
sans rencontrer la moindre résistance. Elles installèrent un
nouveau premier ministre social-démocrate de droite. Les
sociaux-démocrates de gauche furent alors d’accord pour une grève
générale. Mais les travailleurs ne pensaient plus que la résistance
était possible, et la grève ne fut soutenue qu’à moitié.
Mais
la révolution n’alla pas pour autant se coucher sans tirer un seul
coup de feu. L’ordre annulant l’insurrection n’atteignit jamais
Hambourg. A l’aube du 24 octobre, quelques centaines d’insurgés
communistes mirent à exécution l’opération qu’ils avaient
planifiée méticuleusement depuis des semaines. Ils prirent 12 des
16 postes de police des faubourgs et commencèrent à faire mouvement
vers le centre de la ville. Les insurgés croyaient au début qu’ils
faisaient partie d’un soulèvement national coordonné. « Dans
toute l’Allemagne », déclarait le « Comité Exécutif
Provisoire » aux « habitants du district de
Schiffbeck »,
« la classe ouvrière se bat pour le pouvoir. Dans de grandes
parties de l’Allemagne, le pouvoir est aux mains des
travailleurs ».65
Le
soulèvement dura à peine 24 heures. La masse des travailleurs ne
s’y joignit pas comme on s’y était attendu. On ne saura jamais
si c’était par manque de sentiment révolutionnaire (contrairement
à ce qu’on a prétendu plus tard, Hambourg n’était pas un
« bastion rouge » – il n’y avait dans la ville que
1 400 communistes, comparés aux 78 000 membres du SPD)66
ou parce qu’ils se rendirent compte que l’insurrection était
isolée et vouée à l’échec. En tout état de cause, les insurgés
se dispersèrent bientôt dans les banlieues, tenant seulement à
Bambeck. Le soulèvement de Hambourg fut ensuite mythifié par le
Parti Communiste Allemand – essentiellement à cause du rôle qu’y
joua le futur dirigeant stalinien Thälmann. Mais en fait, il était
moins significatif et mobilisateur que l’Action de Mars elle-même,
et ne fut rien comparé aux luttes à Berlin, Munich et la Ruhr en
1919-1920.
La fin d’un chapitre
La
chute de la Saxe prononça la faillite des espoirs en une issue
révolutionnaire à « l « année de la
faim ».
Non seulement la base la plus puissante de la gauche révolutionnaire
était désormais occupée par des troupes en armes, mais, ce qui est
plus important, elle n’avait vu s’organiser aucune résistance
coordonnée. Le gouvernement Zeigner tant vanté avait déguerpi sans
lever le petit doigt pour se défendre, et les 250 000
militants
communistes avait déserté le champ de bataille tout aussi
prestement.
Dans
toute l’Allemagne il y avait eu des millions de gens affamés,
désespérés, qui avaient espéré, au moins à moitié, que les
communistes feraient quelque chose pour mettre en place une
alternative. Au lieu de cela, ils se déclarèrent impuissants face
au général Müller. Il semblait que rien ne pourrait jamais changer
l’ordre ancien, aussi destructif et inhumain que soient son
fonctionnement. Ceux-là même qui auraient approuvé avec
soulagement un changement révolutionnaire approuvaient aujourd’hui
l’intronisation du général Seeckt avec des pouvoirs
quasi-dictatoriaux.
Le
communiste français Albert (Victor Serge - NdT) exprima ainsi le
sentiment général :
On
vient de vivre en Allemagne, en septembre, octobre et novembre, une
profonde expérience révolutionnaire, encore peu connue et souvent
peu comprise. Nous ayons été au seuil d'une révolution. La veillée
d'armes a été longue, l'heure H n'a pas sonné (...) Drame
silencieux, presque invraisemblable. Un million de révolutionnaires,
prêts, attendant le signal pour monter à l'assaut : derrière eux,
des millions de sans-travail, d'affamés, de meurtris, de désespérés,
tout un peuple douloureux, murmurant : « Nous aussi ! nous
aussi ! ». Les muscles de cette foule déjà prêts, les poings
déjà serrés sur les Mausers qu'on allait opposer aux autos
blindées de la Reichswehr. (...) Et rien ne s'est passé, que la
sanglante bouffonnerie de Dresde, un caporal suivi de quelques
réîtres chassant de leurs ministères les ministres ouvriers qui
faisaient trembler l'Allemagne bourgeoise, quelques flaques de sang —
soixante morts au total — sur le pavé des cités industrielles de
Saxe.67
Il
existe une interprétation mécaniste de l’histoire selon laquelle
l’issue des évènements est déterminée à l’avance par
l’interaction de « forces objectives ». Elle oublie,
comme le souligne Marx, que « la théorie se change, elle
aussi, en force matérielle, dés qu'elle pénètre les masses ».
Le développement économique, la croissance de la grande industrie,
des périodes de pauvreté succédant à des périodes de prospérité,
des grandes crises concourent tous à propulser un grand nombre
d’hommes et de femmes dans des mouvements sociaux nouveaux. Mais
l’avenir de ces mouvements dépend, au delà d’un certain point,
de leurs succès ou de leurs échecs dans des combats contre leurs
adversaires. Aucune bataille n’est jamais gagnée ou perdue
simplement parce qu’un général détermine que ses troupes sont en
nombre supérieur ou inférieur à celles de l’autre camp. La
psychologie des soldats, leur déploiement au bon endroit au bon
moment, la distribution correcte des armes et des munitions, tout
cela joue un rôle. Alors que des dizaines de milliers de combattants
se déplacent en masse confuse d’un côté à l’autre du champ de
bataille, le seul fait de brandir un étendard au bon moment peut
faire pencher la balance : des hommes en retraite, épuisés,
sont regroupés et menés à la victoire, ou abandonnés à une fuite
éperdue. Et ce qui s’applique à de simples batailles s’applique
encore plus aux grands conflits sociaux, aux grèves, aux
manifestations, aux révolutions.
Quelles
qu’aient pu être, ou ne pas être, les chances de victoire réelles
de l’Octobre Allemand, l’étendard n’a pas été brandi en
Saxe. Et la classe ouvrière, si puissante dans les premières
semaines d’août, courut se cacher à la fin d’octobre. Le
capitalisme allemand était laissé, sans une égratignure, en
possession du champ de bataille.
En
termes politiques, cela signifiait un coup de balancier à droite
brutal. Le 2 novembre, les ministres sociaux-démocrates
démissionnaient du gouvernement central. Ils avaient joué leur
partition en maintenant passives d’importantes sections de la
classe ouvrière au lendemain de la chute du gouvernement Cuno et
pendant les manœuvres contre la Saxe. Désormais le capitalisme
allemand pouvait se passer d’eux. Le parti qui avait dominé les
cinq premières années de la République de Weimar devait être
exclu du pouvoir pendant les cinq années suivantes.
A
Munich, Hitler crut son heure venue. Les 8 et 9 novembre, ses
sections d’assaut tentèrent de forcer le commissaire spécial de
Bavière, von Kahr, et le chef de l’armée bavaroise, Lossow, à se
joindre à lui dans une prise du pouvoir préludant à une marche sur
Berlin. Mais Lossow était satisfait du tournant à droite à Berlin,
et ce qui intéressait von Kahr était le séparatisme, pas le
national-socialisme hitlérien. Le fascisme n’était pas encore
assez fort pour agir sans le bouclier fourni par la
Reichswehr ;
et les généraux pensaient qu’ils pouvaient contrôler les choses
sans se soumettre à l’arrogant nouveau venu autrichien. Le putsch
fut rapidement circonscrit, et Hitler dut subir l’humiliation de
six mois en prison.
La
bourgeoisie allemande se hâta alors de mettre en œuvre sa solution
à la crise. Le mark fut stabilisé par un solide encadrement du
crédit, qui provoqua une cascade de fermetures d’entreprises,
jusqu’à ce que 28 % des syndicalistes fussent au chômage, et
48 % en temps partiel.68
En même temps,
l’acquis principal des luttes de novembre 1918, la journée de huit
heures, fut supprimé.
L’année
qui pour beaucoup devait être celle de la Révolution Allemande se
termina avec les partis de droite et le Haut Commandement militaire
dans une position encore plus dominante qu’après les marches des
Freikorps en 1919 et 1920.
Le
gouvernement du Reich ne pouvait consolider son pouvoir que par
l’intermédiaire de la Reichswehr, dont le commandant en chef, le
général Seeckt, fut investi d’une autorité exceptionnelle. Sous
protection militaire, l’économie fut stabilisée, l’indépendance
des cartels mesurée, la journée de huit heures abolie, et
l’arbitrage rendu obligatoire.69
Le
Haut Commandement n’était pas tout-puissant. Il devait encore
s’ajuster aux changements dans le rapport des forces sociales. En
particulier, il devait charger la social-démocratie de dompter un
mouvement ouvrier indépendant dans lequel on ne pouvait pas empêcher
les communistes de jouer un certain rôle. Mais il avait retrouvé
une grande partie du pouvoir dont il avait joui aux heures de la
Guerre Mondiale.
Pour
l’instant, au moins, le rêve d’une Allemagne des travailleurs se
joignant à la Russie ouvrière pour remodeler le monde était
terminé.
Les leçons d’Octobre
La
débâcle en Saxe provoqua immédiatement un énorme débat, dans
l’Internationale Communiste, sur la question de la source de
l'échec. Malheureusement, on ne peut pas dire qu’il se soit agi
d'un débat clair et rationnel. Il survint au moment où
l’aggravation du bureaucratisme en Russie y noyait toute discussion
rationnelle. Lénine était complètement hors d'état d'y
participer, et mourut en janvier 1924. Zinoviev, Kamenev et Staline
utilisaient l’autosatisfaction bureaucratique de larges rangs du
parti russe pour isoler Trotsky et détruire sa popularité.
Désormais ils étendaient les méthodes qu’ils avaient employées
en Russie aux discussions dans l’Internationale.
Dans
la discussion sur l’Allemagne, Brandler, Thalheimer et Radek
défendirent la tactique du parti allemand avec des arguments
rationnels et basés sur des faits, même s’ils étaient souvent
confus et contradictoires. Mais la plupart de ceux qui les
attaquèrent le firent pour des raisons d’animosité personnelle,
d’amertume fractionnelle et d’intrigue bureaucratique,
choisissant ou rejetant des arguments, inventant même des faits, à
leur convenance.
Il
n’était pas de mon propos, dans ce livre, d’examiner les
polémiques fractionnelles internes qui se sont élevées dans
l’histoire du parti russe, ou le cours suivi par la dégénérescence
de la révolution russe. Ces questions sont importantes, mais elles
ont été traitées par ailleurs de façon satisfaisante.70
Je vais donc me borner à donner quelques rapides exemples des
méthodes de discussion qui suivirent la défaite allemande.
Zinoviev
et Staline attaquèrent tous deux Brandler, et pendant à peu près
un an soutinrent les ultra-gauches Fischer, Maslow et Thälmann
contre lui. Pourtant, à l’été de 1923, Staline avait déclaré
avec insistance que les Allemands « devaient être
retenus »,
et Zinoviev avait complètement approuvé la décision de ne pas
poursuivre la grève générale et l’insurrection. A nouveau,
Zinoviev permit à Fischer de cogner à tour de bras sur Brandler et
Radek, considérés comme responsables du « gouvernement
ouvrier » saxon – pourtant, comme nous l’avons vu, Brandler
s’était opposé, en octobre, à l’entrée dans le gouvernement.
Finalement, la condamnation de Brandler et Radek lors du Cinquième
Congrès du Comintern, en 1924, fut basée sur la définition
nouvelle et insensée de la sociale-démocratie comme « aile
gauche du fascisme ».
Les
véritables « leçons d’octobre » ne peuvent être
tirées qu’en ignorant les conclusions des débats de
l’Internationale bureaucratisée. Mais certaines des contributions
à ces mêmes débats fournissent des indications précieuses de ce
qui avait mal tourné.71
Diverses explications furent proposées. En fait, la confusion du
débat était telle qu’il n’était pas rare que des individus
développent deux ou plusieurs explications contradictoires au cours
de la même intervention.
Quatre
explications principales furent proposées.
La
première proclamait qu’il n’y avait pas, dans l’Allemagne de
1923, de situation révolutionnaire : la majorité de la classe
ouvrière, loin de soutenir les communistes, était restée fidèle à
la social-démocratie. C’était un élément important de
l’argumentation utilisée par la direction brandlérienne pour
justifier sa retraite en Saxe :
L’erreur
commune de l’Exécutif [de l’Internationale] comme de la Centrale
du KPD a été une fausse estimation du rapport de forces entre le
SPD et le KPD au sein de la classe ouvrière. (...) La majorité des
travailleurs n’était pas encore gagnée au communisme.72
Si,
après la conférence de Chemnitz, nous nous étions lancés dans la
bataille, nous aurions subi une défaite décisive, qui aurait rendu
impossible pour des années toute discussion sur la possibilité
d’une victoire pour le prolétariat.73
A la
conférence de Chemnitz il était évident que les travailleurs
croyaient encore que la marche des troupes en Saxe était dirigée
contre la Bavière. (...) Si nous nous étions risqués à la
bataille, nous aurions, nous autres communistes, connu une défaite
sanglante. (...) Une large section de la petite bourgeoisie était
passée dans le camp ennemi.74
Clara
Zetkin prétendait avec insistance que la grève contre Cuno n’avait
montré aucune véritable tendance révolutionnaire. Au contraire,
elle révélait parmi les masses « un grand manque de maturité
politique pour la révolte, pour la prise du pouvoir ».75
Pour Thalheimer, la défaite avait des causes « de nature
objective,
et non imputables à des fautes de tactique du parti ».76
La
majorité de la classe ouvrière n’était plus prête à se battre
pour la démocratie de Novembre (1918), (...) et pas encore prête à
lutter pour la dictature des conseils et le socialisme.77
De
ce fait, toute action en octobre aurait opposé des groupes
misérablement petits de travailleurs armés aux forces combinées du
fascisme, de l’armée et de la police paramilitaire.
De
tels arguments ont amené des historiens comme l’Américain Angress
à accepter l’évaluation de 1923 comme une situation non
révolutionnaire. Pourtant ils sont porteurs de nombreuses
faiblesses.
D’abord,
ceux qui ont fait valoir ces raisons en 1923 n’en étaient pas
eux-mêmes totalement convaincus. Brandler, par exemple, a tenu dans
un certain nombre d’occasions ultérieures des propos semblant
impliquer, à l’inverse de ce que disait son ami Thalheimer, qu’il
y avait en 1923 des possibilités révolutionnaires, mais pas en
octobre
1923. Ce n’était pas la définition de l’année comme
potentiellement révolutionnaire qui était en cause, mais le mois
d’octobre en tant que moment de passer à l’offensive. Cela
ressort manifestement de son discours au Cinquième Congrès du
Comintern neuf mois plus tard, ainsi que de l’interview qu’il
donna, 25 ans après, à Isaac Deutscher :
Lorsqu’on
lui demande si aujourd’hui il considère que la situation de 1923
était révolutionnaire, Brandler ne donne pas de réponse claire.
Par la façon dont il décrit les évènements on a l’impression
que sa réponse est plutôt, dans l’ensemble, affirmative. Mais il
ne tire pas de conclusions définitives.78
L’évaluation
pessimiste faite en octobre 1923 découlait d’une peur
obsessionnelle constante d’une répétition de l’Action de Mars.
Brandler disait :
L’Action
de Mars 1921 nous a montré que la situation de la classe dans son
ensemble, toute la situation objective, n’était pas mûre pour que
nous battions le capitalisme par un assaut frontal : les
conditions objectives ont mené à ce que nous avons subi une grande
défaite après un assaut frontal. Je fus justement rendu
personellement responsable de cette défaite. (...) Mais je pense que
j'ai la capacité de ne pas faire deux fois la même erreur.79
Mais
il était absurde de mettre le signe égal entre l’Allemagne de
1923, année où toute la société était secouée par la crise, et
celle de mars 1921, où la crise n’était qu’un produit de
l’imagination de Kun, Brandler, Radek et autres.
De
plus, ceux qui disaient que la situation n’était pas mûre avaient
tendance à surestimer grossièrement la cohésion interne des forces
alignées contre la gauche. Ils parlaient de « centaines de
milliers » de combattants d’extrême droite qui auraient
facilement écrasé les « quelques milliers » de
travailleurs en armes, sans reconnaître qu’il y avait encore de
puissantes tendances, au sein des forces contre-révolutionnaires,
défavorables à une réponse rapide et unifiée à une offensive de
la gauche. Bien sûr, le gouvernement central, le commandement de la
Reichswehr, les séparatistes bavarois et les supporters de Hitler
étaient tous des ennemis de la révolution. Malgré tout, à peine
une quinzaine de jours après la débâcle saxonne, ils étaient en
train de se quereller entre eux.
Au
lieu de reconnaître cela, même après que Hitler ait été mis en
prison pour son putsch bavarois, la direction communiste allemande
amalgamait les forces de droite sous la qualification de
« fascistes ». Dans un remarquable travestissement de
l’histoire, la direction brandlérienne déclarait :
La
Révolution de Novembre est livrée au fascisme. Le pouvoir est entre
les mains de forces militaires déterminées à annihiler les
organisations de la classe ouvrière. (...) Alors que la classe
ouvrière voyait le centre du fascisme en Bavière, c’est à Berlin
que le fascisme s’installe sous la forme de la dictature de
Seeckt.80
La
surestimation des forces alignées contre la révolution était
accompagnée d’une tendance à traiter comme
un fait
ce qui n’avait pas véritablement été prouvé, à savoir que les
sociaux-démocrates restaient la force décisive dans la classe
ouvrière. Seule l’action pouvait déterminer quel était
l’équilibre réel des forces en octobre 1923 – pourtant la
direction du KPD se déroba sur la supposition que ce rapport ne
pouvait pas, malgré la crise totale de la société, s’être
radicalement modifié.
La
seconde explication donnée à la débâcle fut que la date de
l’insurrection avait été fixée avant
que la situation révolutionnaire ne soit arrivée à complète
maturité. Brandler lui-même opte à l’occasion pour ce point de
vue : « Je n’ai tout simplement pas considéré la
situation comme ayant atteint suffisamment d’acuité
révolutionnaire, comptant plutôt sur une intensification
ultérieure ».81
C’était également implicite dans les déclarations de Zinoviev et
de la direction du Comintern après
la défaite, selon lesquelles rien n’avait changé dans le rapport
des forces objectif, et « l’Allemagne va, semble-t-il, vers
une guerre civile aiguë ».82
L’histoire
a elle-même prouvé la fausseté de cet argument. Aucune vague de
grèves et de manifestations ne suivit. Les travailleurs étaient
démoralisés par le chômage massif et, surtout, par le sentiment
que les communistes avaient eu leur chance et avaient refusé de la
saisir.
La
troisième explication avancée est que la véritable opportunité
révolutionnaire avait été antérieure
à octobre, mais que le Parti Communiste et l’Internationale
n’étaient alors absolument pas prêts. Presque tous les dirigeants
communistes acceptèrent en partie cette interprétation (sauf
Zinoviev, qui la traitait de « sophisme » – sans
doute
parce qu’elle impliquait que son exécutif du Comintern était tout
autant à blâmer que le parti allemand).
Radek
prétendait qu’en avril et mai ni l’exécutif de l’Internationale
ni la direction du KPD n’avaient tiré les « conclusions
pratiques » de leur évaluation théorique selon laquelle la
lutte dans la Ruhr se terminerait en « guerre
civile ».83
Clara Zetkin disait qu’à l’époque de l’occupation de la Ruhr
le
parti ne prit pas connaissance à temps et avec assez de vigueur de
la situation révolutionnaire. (...) Le parti ne considérait pas la
lutte pour des revendications partielles comme un moyen de recruter,
mobiliser et éduquer le prolétariat pour la lutte de masse pour le
pouvoir.84
La
version la plus extrême de cet argument affirme qu’en octobre il
n’y avait aucune
chance de succès pour
l’insurrection, parce que le gouvernement Stresemann avait déjà
restauré la confiance de la bourgeoisie en mettant fin à la
résistance passive et en commençant à prendre des mesures pour
lutter contre l’inflation.
Le
problème avec ce raisonnement, c’est qu’il suppose que la masse
du peuple, y compris la bourgeoisie, acceptait à l’avance que les
plans de Stresemann allaient être couronnés de succès. Mais la fin
de la résistance passive ne fut pas suivie immédiatement
d’un accord avec les Français : le mouvement séparatiste
qu’ils soutenaient était encore actif en Rhénanie au moment de la
débâcle saxonne. Et l’inflation continua à s’accélérer
pendant encore une quinzaine de jours. Il y avait peu de raisons pour
que des gens qui avaient déjà assisté à l’échec de trois
tentatives gouvernernementales de maîtriser l’inflation se mettent
à croire que celle-là allait marcher.
La
quatrième interprétation de la défaite fut formulée par Trotsky
et ses partisans. Il en existe une version vulgaire, que l’on peut
trouver parfois dans la littérature trotskyste, et qui est à
l’évidence fausse, selon laquelle il y avait en octobre une
situation révolutionnaire que Staline
sabota.85
L’argument tombe de lui-même parce qu’il attribue aux jugements
désastreux de Staline une influence dans le Comintern qu’ils
étaient loin de posséder en 1923.
En
tout état de cause, la thèse de Trotsky est beaucoup plus
sophistiquée. Elle n’est pas subordonnée à l’acceptation que
le succès était garanti en octobre (même si Trotsky le pensait
probable). L’idée centrale de Trotsky est que la situation était
devenue tellement fluide que seule
une
offensive des
révolutionnaires pouvait révéler le véritable rapport de
forces :
C’est
à un pédant – et non à un révolutionnaire – qu’il siérait
d’analyser maintenant jusqu’à quel point la conquête du pouvoir
aurait été « garantie » avec une politique juste.86
Mais
le parti allemand n’avait pas su répondre au brusque changement de
la situation objective au cours de l’année :
Durant l’été 1923, la
situation
intérieure de l’Allemagne, en raison surtout de la faillite de la
tactique de résistance passive, prit un caractère catastrophique.
Il devenait parfaitement clair que la bourgeoisie allemande ne
réussirait à sortir de cette situation « sans
issue’ »que
si le Parti Communiste allemand ne comprenait pas clairement ce fait,
et n’en tirait pas pour son action toutes les conclusions
révolutionnaires nécessaires. (...)
Pourquoi
la révolution allemande n’a-t-elle pas abouti à la victoire ?
Les causes de l’échec tiennent entièrement à la tactique et non
aux conditions ou au hasard. Nous avons là l’exemple classique
d’une situation révolutionnaire manquée. Le prolétariat allemand
aurait marché au combat, s’il avait pu se convaincre que, cette
fois, le problème de la révolution était nettement posé, que le
Parti Communiste était prêt à aller à la bataille, qu’il était
capable d’assurer la victoire. Non seulement les droitiers, mais
aussi les gauchistes, en dépit de la lutte acharnée qu’ils se
livraient, envisagèrent jusqu’en septembre-octobre, avec grand
fatalisme, le processus du développement de la révolution.87
Trotsky
pensait que la direction du parti allemand avait fait une terrible
erreur en n’allant pas de l’avant en octobre 1923. Mais c’était
seulement l’expression finale du fait qu’ils avaient été à la
traîne des évènements pendant tout l’été.
Le
fait que, après les évènements, les réformistes semblaient avoir
une emprise aussi ferme sur la majorité de la classe ouvrière ne
prouvait pas que les travailleurs n’auraient pas suivi les
communistes dans la bataille au sommet de la crise sociale et
politique. Car la dérobade des communistes rendrait les masses à la
social-démocratie.
Un parti qui a longtemps mené
une
agitation révolutionnaire en arrachant peu à peu le prolétariat à
l'influence des conciliateurs, et qui, une fois porté au faîte des
événements par la confiance des masses commence à hésiter, à
chercher midi à quatorze heures, à tergiverser et à louvoyer,
paralyse l'activité des masses, provoque chez elles la déception et
la désorganisation, perd la révolution, mais par contre s'assure la
possibilité d'alléguer, après l'échec, le manque d'activité des
masses.88
Trotsky
cite longuement des déclarations de Bolcheviks – en particulier de
Zinoviev et de Kamenev – qui avaient, dans la Russie de 1917,
utilisé des arguments contre l’insurrection qui étaient proches
de ceux mis en avant en Allemagne en octobre 1923 par Brandler et
Radek. Il suggère que si ces raisonnements avaient eu le dessus en
1917, ils auraient semblé corrects après l’événement :
Il n'est pas difficile de se
représenter
la façon dont on aurait écrit l'histoire si la tendance à se
dérober à la bataille avait triomphé dans le Comité Central. Les
historiens officiels, à n'en pas douter, auraient représenté la
situation de façon à montrer que l'insurrection eût été une
véritable folie en octobre 1917; ils auraient servi au lecteur des
statistiques fantastiques sur le nombre des junkers, des cosaques,
des détachements de choc, de l'artillerie "disposée en
éventail" et des corps d'armée venant du front. Non vérifiées
dans l'insurrection, ces forces eussent apparu beaucoup plus
menaçantes qu'elles ne l'étaient en réalité.89
En
fait, la révolution aurait échoué, non pas parce qu’elle était
impossible, mais parce que le parti aurait omis d’agir au moment
décisif. Son hésitation aurait donné le temps à la bourgeoisie de
mettre ses troupes en mouvement et de reprendre le contrôle des
évènements. Car la révolution se développe jusqu’à un point
où, soit le parti révolutionnaire agit, soit l’histoire retombe
dans son vieux moule :
La force d'un parti
révolutionnaire ne
s'accroît que jusqu'à un certain moment, après quoi elle peut
décliner devant la passivité du parti, les espoirs des masses font
place à la désillusion et, pendant ce temps, l'ennemi se remet de
sa panique et tire parti de cette désillusion.90
Trotsky
insistait sur la nécessité pour le parti d’agir en octobre.
Même si on accepte les arguments de Radek et de Thalheimer – selon
lesquels en octobre le moment crucial était dépassé et la
bourgeoisie avait à nouveau le contrôle – le diagnostic essentiel
de Trotsky tient toujours. A partir de mai, de grandes possibilités
n’ont pas connu de test parce que le parti était sur la défensive,
et ne répondit pas au changement d’humeur des masses et à la
désintégration croissante de la société.
Pour
Trotsky, un certain niveau de conservatisme dans le parti était
inévitable. Cela provenait du fait que, dans la plus grande partie
de la vie d’un parti révolutionnaire, la possibilité objective de
prendre le pouvoir n’existe tout simplement pas :
La classe ouvrière lutte et
grandit avec
la conscience que son adversaire est plus fort qu'elle. C'est ce que
l'on observe constamment dans la vie courante. L'adversaire a la
richesse, le pouvoir, tous les moyens de pression idéologique,
tous les instruments de répression. L'accoutumance à la pensée
que l'ennemi nous est supérieur en force est partie constitutive de
la vie et du travail d'un parti révolutionnaire à l'époque de
préparation.D'ailleurs, les conséquences des actes imprudents
ou prématurés auxquels le Parti peut se laisser aller lui
rappellent brutalement chaque fois la force de son ennemi. Mais
il vient un moment où cette habitude de considérer l'adversaire
comme plus puissant devient le principal obstacle à la victoire. La
faiblesse d'aujourd'hui de la bourgeoisie se dissimule en quelque
sorte à l'ombre de sa force d'hier.91
La
décision de lutter pour le pouvoir ne comporte pas seulement un
changement tactique décidé par l’un ou l’autre des dirigeants
du parti, mais une complète transformation dans l’approche par le
parti de chacune de ses activités. Il n’est donc pas surprenant,
par conséquent, que des sections entières du parti tentent de se
dérober au changement :
Chaque
période du développement du Parti a ses traits spéciaux et
réclame des habitudes et des méthodes déterminées de travail. Un
tournant tactique implique une rupture plus ou moins importante
de ces habitudes et méthodes c'est là qu'est la source directe des
heurts et des crises. (...) De là un danger : si le virage a
été trop brusque ou trop inattendu et que la période supérieure
ait accumulé trop d'éléments d'inertie et de conservatisme dans
les organes dirigeants du Parti, ce dernier se montre incapable de
réaliser sa direction au moment le plus grave auquel il s'était
préparé durant des années ou des dizaines d'années. Le Parti est
rongé par une crise et le mouvement s'effectue sans but et va à la
défaite.92
La
confusion dans le parti a l’effet le plus profond sur la
classe :
Sur une seule et même base
économique,
avec la même différenciation de classe de la société, la
corrélation des forces varie en fonction de l'état d'esprit des
masses prolétariennes, de l'effondrement de leurs illusions, de
l'accumulation de leur expérience politique, de l'ébranlement de la
confiance des classes et groupes intermédiaires dans le pouvoir
étatique, et enfin de l'affaiblissement de la confiance que ce
dernier a en lui-même. En temps de révolution ces processus
s'effectuent rapidement.93
Si
le parti fait montre d’une foi dans la stabilité de l’Etat
bourgeois que même ceux qui contrôlent cet Etat n’ont pas, il
l’aide par inadvertance à maintenir les masses sous sa coupe. Au
lieu d’aggraver les conflits internes dans le camp ennemi, au lieu
de montrer aux classes moyennes que la révolution leur offre une
issue, il finit par les convaincre que leur seul espoir réside dans
le statu quo.
Voilà,
disait Trotsky, ce qui s’était passé dans l’Octobre Allemand.
La direction communiste, après avoir amené la majorité des
travailleurs et une section de la classe moyenne à un point où
elles appelaient de leurs vœux un dénouement révolutionnaire à la
crise sociale, n'accomplit pas sa tâche. Les masses perdirent
confiance dans le parti, et les sociaux-démocrates et les partis de
droite purent les récupérer.
Les
tendances au conservatisme sont inhérentes à tout parti. Mais cela
ne signifie pas que Trotsky pensait qu’on ne pouvait rien faire
pour le combattre. Il pouvait être évité par une direction qui
combinait une précision scientifique stricte dans l’analyse des
évènements avec la capacité de répondre à des changements vifs
et soudains dans les dispositions des masses – le genre de réponse
que Lénine et Trotsky avaient été capables de faire en 1917. Mais
une direction semblable ne surgit pas du néant. Le parti devait
développer des dirigeants de ce calibre à travers de longues années
de lutte, sélectionnant parmi ses membres ceux qui se montraient
capables de saisir la relation entre la situation objective et les
mutations rapides dans le moral des masses. Ce n’est qu’ainsi que
le parti pouvait se préparer à des batailles gigantesques pour
changer le monde. L’Octobre Allemand fut réduit à rien parce que
le Parti Communiste Allemand ne possédait pas une telle direction.
Une
telle interprétation ramène l’analyse de ce qui n’avait pas
marché en 1923 à l’appréciation historique de la décennie
écoulée.
Nous
avons vu, dans les chapitres précédents, comment l’absence fatale
d’un noyau stable de parti produisit les défaites dévastatrices
de 1919 et l’incapacité de saisir les opportunités
révolutionnaires après le putsch de Kapp en 1920. Ces échecs
suscitèrent à l’intérieur du parti une impatience qui lui monta
à la tête lors de l’Action de Mars 1921. Cette expérience
traumatisante préparait à son tour le terrain de la débâcle de
1923.
La
direction du parti avait perdu toute confiance en elle-même. Sa
fixation névrotique sur mars 1921 l’empêchait de répondre au
changement d’humeur des masses en mai 1923. Le parti était déchiré
par des querelles intestines, la direction peu sûre d’elle-même,
se jurant bien de ne jamais recommencer, alors que l’opposition
était encore porteuse de tous les symptômes de la folie de mars. Le
parti chercha à se rassurer, non pas dans la lutte en Allemagne
même, mais en se tournant pour un conseil tactique vers des hommes
de Moscou qui, aussi capables qu’ils fussent (et beaucoup ne
l’étaient guère plus que les dirigeants allemands), n’étaient
pas en position de juger des changements d’humeur des masses au
jour le jour.
1923
fut l’addition de tous les problèmes qui avaient empoisonné la
Révolution Allemande depuis le début – ou, plus précisément, de
l’impact répété d’un problème majeur : l’absence d’un
noyau de parti en novembre 1918. Sans un tel noyau l’expérience de
1918-1919 ne pouvait produire une couche de militants capables de
répondre de manière coordonnée au niveau national aux possibilités
de 1920. Et cela, à son tour, détermina une combinaison de folle
témérité et d’hésitation en 1921 et 1923.
La
société allemande produisit des centaines de milliers, et même des
millions, d’hommes et de femmes qui voulaient un changement
révolutionnaire entre 1918 et 1923. La tragédie de la Révolution
Allemande fut qu’un parti capable de canaliser et de coordonner
leur énergie ne vit le jour qu’au moment où il était trop tard.
L’histoire a souvent été comparée à une locomotive – mais
elle n’attend pas que les révolutionnaires veuillent bien monter à
bord. Ceux qui ne sont pas à l’heure sont contraints, comme le
Juif errant de la légende, de souffrir pour le reste de l’éternité.