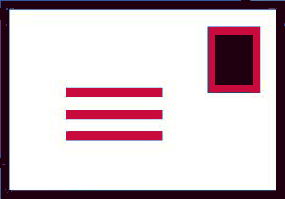Les militaires et la
bourgeoisie, qui
aident aujourd’hui Ebert et Scheidemann à se sortir du bourbier,
veulent jouir eux-mêmes des fruits de la moisson sanglante. Ces
éléments ne voulaient soutenir le gouvernement
« socialiste »
qu’aussi longtemps qu’ils pouvaient croire tenir la bride sur le
cou du des masses prolétariennes avec le faux drapeau. (...)
Désormais le charme est rompu. La semaine écoulée a rendu béant
l’abîme qui sépare le gouvernement Ebert de la révolution.
Aujourd’hui il est évident qu’Ebert et Scheidemann ne peuvent
régner que par les baïonnettes. Mais dans ce cas, les baïonnettes
règneront sans Ebert et Scheidemann. (...) Ainsi le corps des
officiers contre-révolutionnaires se rebelle contre le gouvernement
Ebert. (...)
Quel que soit, demain ou le
jour d’après,
le résultat et la solution de la crise, ce sera un arrangement
provisoire, un château de cartes (…) A très court terme la force
primitive de la révolution, les luttes économiques, barrera d'un
trait tous ces calculs (...) Les ruines et les cadavres de ce dernier
épisode seront à peine déblayés que la révolution reprendra son
inlassable travail quotidien.1
C’est
ainsi que Rosa Luxemburg, l’avant-veille de son assassinat,
pointait les problèmes auxquels faisaient face les vainqueurs de
janvier 1919. Ses prédictions devaient bientôt s’avérer
correctes.
L’écrasement
de la gauche révolutionnaire à Berlin avait permis aux dirigeants
sociaux-démocrates et au Haut Commandement militaire de réaliser
leurs premiers buts. Ils avaient créé les conditions dans lesquels
les élections de janvier à l’Assemblée Nationale pouvaient se
tenir en toute sécurité ; ils s’assuraient que les élections
étaient dominées, d’une part par le vieil appareil du SPD et,
d’autre part, par les fonds massifs versés par les milieux
d’affaires aux partis bourgeois ; et ils laissaient intactes
les vieilles structures du pouvoir dans la presse, la fonction
publique, l’armée et la magistrature.
Mais
leur victoire sur les révolutionnaires était précaire. La plus
grande partie de l’Allemagne était toujours sous l’influence des
conseils d’ouvriers et de soldats. La fonction publique dépendait
toujours de leur bonne volonté pour que les choses soient faites, et
les seules forces de police, dans de nombreuses localités, étaient
les « détachements de sécurité » ou les
« armées
populaires » sous les ordres des conseils.
Dans
les premiers jours de la révolution, les sociaux-démocrates avaient
dans l’ensemble réussi à dominer ces conseils, parce que la
plupart des travailleurs et des soldats étaient complètement
nouveaux à la politique et croyaient que le SPD poursuivait une
stratégie socialiste « réaliste ». Mais les
sociaux-démocrates ne pouvaient conserver ce soutien que s’ils
faisaient des concession verbales aux travailleurs. Ils n’entraient
pas dans la bataille sous la bannière de la contre-révolution. Bien
au contraire. Ils faisaient des promesses qui, dans d’autres temps,
auraient paru révolutionnaires.
Les
premières proclamations du gouvernement insistaient sur sa
« composition
purement socialiste »
et sur le fait qu’il « se
donnait pour tâche d’appliquer le programme socialiste »,
comme l’a noté un historien favorable aux dirigeants du SPD.2 C’était vrai en
particulier dans la sphère économique, où il était
continuellement question de « socialisation ».
Le même Congrès National qui avait voté pour transmettre le
pouvoir à l’Assemblée Nationale avait aussi voté pour « la
socialisation de l’industrie, en particulier des mines ».
Et le Congrès était dominé par les sociaux-démocrates.
Le
SPD devait aussi faire des concessions verbales en ce qui concernait
les conseils ouvriers eux-mêmes. Les conseils étaient extrêmement
populaires dans de larges couches de travailleurs, y compris parmi
ceux qui soutenaient le gouvernement ; là encore, le Congrès
National des conseils avait approuvé la résolution de Hambourg qui
donnait aux conseils de soldats des pouvoirs étendus.
Une
des raisons pour lesquelles le gouvernement avait si facilement brisé
le mouvement de janvier à Berlin était qu’une section importante
des ouvriers de la ville était toujours prête à collaborer
activement à la lutte contre la révolution. Les plus grandes usines
et certains des régiments les plus importants étaient restés
neutres, exhortant les deux camps à la « paix ».
L’Exécutif des Conseils de Berlin dénonça le soulèvement. En
fait, cela signifiait que la défaite des forces de gauche n’était
pas égale à la destruction du pouvoir de la classe ouvrière dans
son ensemble, mais seulement de ses éléments les plus
révolutionnaires. Une défaite complète des travailleurs n’aurait
pas seulement signifié la déroute des spartakistes et des
Indépendants de gauche, mais aussi de certaines forces
social-démocrates qui avaient combattu les révolutionnaires. Il y
avait des dizaines de milliers de travailleurs et de soldats qui
étaient prêts à donner leur accord au désarmement, voire même à
l’exécution des « rouges », mais qui étaient loin
d’être disposés à accéder aux autres exigences de la
contre-révolution – la restauration de l’essentiel du régime
d’avant Novembre, la destruction du pouvoir des syndicats, le
retour à la discipline militaire, et une augmentation des salaires
inférieure à la hausse des prix.
Il
était dès lors possible pour les sociaux-démocrates d’obtenir,
et de loin, la majorité des voix de la classe ouvrière aux
élections de l’Assemblée Nationale, tenues moins d’une semaine
après le bain de sang de Berlin. Ils eurent 11,5 millions de voix,
contre 2,3 millions aux Indépendants, sur un électorat total de 30
millions. Seul un électeur sur 13 montra un signe de sympathie pour
le socialisme révolutionnaire. La plupart des travailleurs voulaient
le socialisme – mais ils pensaient toujours pouvoir y accéder par
des moyens autres que révolutionnaires.
Cela
dit, Berlin une fois écrasé et les élections à l’Assemblée
tenues sans problème, les dirigeants sociaux-démocrates
commencèrent à démontrer qu’ils avaient plutôt tendance à
s’éloigner du socialisme qu’à s’en rapprocher. Ils formèrent
un gouvernement de coalition avec les partis bourgeois, puis, le 19
janvier, Noske publia un décret mettant fin aux pouvoirs des
conseils de soldats et restituant aux officiers toute leur ancienne
autorité.
« La
politique faible (...) des socialistes de droite, et la politique
subséquente du gouvernement de coalition, suscitèrent une amertume
d'autant plus profonde que les conditions d’existence (...)
s’aggravaient »,
écrivit un observateur contemporain.
Non seulement le nombre des
chômeurs a
atteint des sommets avec la démobilisation de millions de soldats et
l’arrêt de la production des industries de guerre, mais de plus la
partie employée du prolétariat a souffert de plus en plus de la
hausse incessante de tous les prix. Les efforts des travailleurs pour
obtenir des compensations par des augmentations de salaires étaient
vains.3
En
novembre et décembre, alors que les Indépendants étaient toujours
au gouvernement, ils avaient dénoncé les grèves visant à
maintenir le niveau de vie – un peu de la même façon que de
prétendus marxistes dénoncent aujourd’hui
« l’économisme » ;
l’indépendant de gauche Emil Barth, par exemple, s’insurgea
contre la tentative « de
rabaisser la révolution au niveau d’une grande revendication
salariale ».
Rosa Luxemburg, au contraire, proclamait avec insistance que seule la
lutte économique pouvait permettre à la lutte politique de s’élever
à un niveau supérieur. Son jugement était désormais confirmé.
Dans une région de l’Allemagne après l’autre, la lutte pour les
conditions d’existence amena les travailleurs à utiliser les
institutions créées par la Révolution de Novembre – et par
dessus tout les conseils – contre le gouvernement pour lequel la
plupart d’entre eux avaient voté.
Les
dirigeants sociaux-démocrates répondirent en se tournant vers leur
amis militaires pour détruire le pouvoir des conseils et des forces
de sécurité locales basées dans la classe ouvrière. Les Freikorps
furent lancés dans une marche à travers l’Allemagne pour une
opération de « nettoyage », de la même manière qu’ils
avaient « nettoyé » la gauche à Berlin. Cela les
amena
de Berlin à Brême, de Brême dans la Ruhr, de la Ruhr en Allemagne
centrale, de l’Allemagne centrale à Berlin, de Berlin à nouveau
dans la Ruhr, puis encore une fois en Allemagne centrale, puis à
Munich, de Munich à Chemnitz et à Hambourg. Les Freikorps étaient
de plus en plus dirigés contre toutes les organisations ouvrières,
et pas uniquement la minorité révolutionnaire. Des milliers de
travailleurs furent tués, et à la fin une grande partie de la
classe ouvrière allemande avait l’impression de vivre sous une
occupation militaire.
Brême
La
gauche révolutionnaire avait acquis à Brême une influence sans
équivalente ailleurs. La ville, sur la côte nord-ouest de
l’Allemagne, était un centre de l’opposition interne du SPD dès
avant 1914, son parti local publiant des articles de Luxemburg,
Mehring et Radek. La scission du SPD de 1917 se fit dans des termes
beaucoup plus favorables à l’opposition à Brême qu’ailleurs,
ne laissant au « vieux
parti » que
« quelques
centaines » de
membres.4
En même temps, la gauche révolutionnaire, sous la direction du très
capable Johann Knief, avait réussi à produire un hebdomadaire
local, Arbeiterpolitik.
Ils avaient pu neutraliser la répression de l’Etat impérial en
construisant une organisation illégale enracinée dans les lieux de
travail.
Dans
la première semaine après la révolution, les sociaux-démocrates
purent prendre le contrôle : dans l’euphorie générale
beaucoup pensaient que les conseils étaient compatibles avec le
vieux Sénat qui avait dirigé la cité-Etat de Brême sous l’empire.
Mais les attitudes commencèrent bientôt à changer, en particulier
après l’arrivée en ville de Knief le 16 novembre avec un
détachement de marins révolutionnaires, déterminé à construire
« le
noyau du
pouvoir ouvrier armé ».5
Dès
le 24 novembre les révolutionnaires conduisaient des manifestations
de masse devant l’hôtel de ville, et le conseil d’ouvriers et de
soldats de la ville votait pour la dictature du prolétariat et
contre la réunion de l’Assemblée Nationale. Les communistes
avaient « une
majorité des travailleurs industriels derrière eux »6,
même si les sociaux-démocrates conservaient une base dans la
garnison. Lors d’une réélection des conseils ouvriers le 6
janvier, le SPD bénéficia d’un peu moins de la moitié des voix –
113, contre 64 pour les Indépendants et 62 pour les communistes.
Les
combats continuaient à Berlin lorsque le nouveau conseil se réunit
à l’hôtel de ville de Brême le 10 janvier. Les rues
environnantes avaient été conquises par une énorme manifestation
de travailleurs armés dirigée par les communistes. Les Indépendants
du conseil se soumirent à l’humeur ambiante. Ils votèrent avec
les communistes pour déclarer Brême « république
socialiste indépendante ».
Un « Conseil des
Commissaires du Peuple »
(cinq Indépendants et quatre communistes) fut élu, et un certain
nombre de mesures révolutionnaires furent prises : la loi
martiale, qui devait être mise en œuvre par « l’armée
prolétarienne du peuple » ;
la remise de toutes leurs armes par la bourgeoisie et les officiers
dans les 24 heures ; la censure de la presse bourgeoise.
A
ce stade, le mouvement révolutionnaire de Brême connut un recul
tout à fait inattendu et inévitable : Johann Knief, son
dirigeant de loin le plus capable, tomba fatalement malade. Son
dernier acte politique avait été de sonner l’alarme contre toute
tentative de soutenir Berlin militairement ou contre une insurrection
locale. Son avis fut ignoré.
La
justesse de l’avertissement de Knief se trouva prouvée à peine
trois jours plus tard, alors que la plupart des Indépendants
commençaient à quitter le navire. Le conseil des ouvriers et des
soldats vota, à une courte majorité, pour permettre la tenue dans
la ville des élections à l’Assemblée Nationale. Les communistes
se rendirent compte qu’ils n’avaient pas assez de soutien dans la
population pour maintenir la « république ». Le 21
janvier, le conseil votait pour la mise en place dans la ville d’une
nouvelle autorité au moyens « d’élections
citoyennes » à
tenir en mars. La « république socialiste
indépendante »
était oubliée par ses initiateurs – mais elle continua à fournir
une excuse pour l’intervention militaire.
Pour
l’instant les conseils ouvriers demeuraient le pouvoir à Brême,
et les travailleurs restaient armés. Cela constituait en soi un
affront au gouvernement de Berlin. Dès que les élections à
l’Assemblée Nationale furent terminées, les opérations contre
Brême purent commencer.
Une
campagne de presse prétendit que le régime radical de Brême
retenait des fournitures alimentaires américaines destinées au
reste de l’Allemagne. « L’opinion publique » une fois
mise en rage, l’action militaire se mit en branle. Le 28 janvier,
le commandant des Freikorps, le futur nazi Erhardt, lança ses
troupes à l’assaut de la base navale de Wilhelmshaven.
Mitrailleuses, artillerie et grenades furent utilisées pour briser
le pouvoir des conseils de marins. Il y eut huit morts. Le 30
janvier, les troupes reçurent l’ordre de se porter sur Brême.
A
certains égards, la situation était la même qu’à Berlin au
début du mois. L’extrême gauche avait échoué dans une tentative
de prendre le pouvoir. Elle pouvait dès lors être présentée au
reste du pays comme étant composée de « fanatiques »
et de « putschistes »
qui voulaient interrompre « la
marche dans l’ordre à la socialisation »
entreprise par le gouvernement de Berlin.
Mais
il y avait une différence importante. A Berlin, l’Exécutif des
Conseils Ouvriers, le corps qui détenait la légitimité depuis la
Révolution de Novembre, avait soutenu le gouvernement. A Brême,
c’était le pouvoir des conseils ouvriers lui-même qui était
attaqué.
La
gauche de Brême se trouva donc soutenue par un large éventail
d’opinion de la classe ouvrière, à la fois dans la ville et à
l’extérieur. « La
classe ouvrière de toute la Waterkant
(la côte nord-ouest) considéra
l’action contre Brême comme une menace ».7
Le journal social-démocrate de l’autre grande ville de la région,
Hambourg, le Hamburger
Echo, posait la
question : « Devons-nous
laisser la révolution se faire étrangler par le militarisme ? »
La
région avait été le berceau du mouvement des conseils qui avait
renversé l’empire à peine trois mois auparavant. Et tous les
conseils semblaient devoir présenter un front uni pour la défense
de Brême.
Le
conseil de soldats du XIème
Corps d’Armée, basé à Hambourg, promit son aide. Le conseil
ouvrier de Hamburg décida, par 232 voix contre 206, que le XIème
Corps devait empêcher toute marche sur Brême ; il se prononça
également pour « l’armement
des travailleurs de Hambourg dans les 48 heures »,
l’occupation des quais pour prendre le contrôle de tous les moyens
d’existence, et le soutien à Brême « par
tous les moyens militaires ».
A
Brême, les Commissaires du Peuple et les conseils d’ouvriers et de
soldats proposèrent au gouvernement un compromis, selon lequel les
travailleurs de Brême ne rendraient pas les armes aux Freikorps,
mais à des unités stationnées à Hambourg et Brême, et le Conseil
des Commissaires lui-même serait réaménagé, la moitié des sièges
étant réservés aux sociaux-démocrates.
Les
sociaux-démocrates de Brême étaient très contents de cette
proposition. Mais Noske n’était pas intéressé. Les chefs des
Freikorps Lüttwitz et Erhardt lui avaient dit que « le
prestige du commandement militaire ne pourrait pas résister à un
retrait ».8
Passer un compromis avec Brême revenait à accepter le droit des
conseils de soldats de déterminer les mouvements de l’armée.
Le
3 février, les Freikorps entrèrent dans la ville, où les combats
étaient bientôt acharnés :
Les travailleurs n’avait pas
laissé
les négociations les entraîner à un sentiment trompeur de
sécurité, comme cela s’était trop souvent passé dans cette
révolution. Depuis que le télégramme d’avertissement venu de
Berlin le 30 janvier avait mis en branle les sirènes de l’usine,
on avait travaillé à l’armement des ouvriers.9
Les
Freikorps durent faire refluer les travailleurs rue par rue. Les
ouvriers tenant les ponts essuyèrent attaque après attaque de
véhicules blindés : seul, l’usage de grenades put les
déloger. Dans le combat lui-même 46 Freikorps furent tués, presque
le double des 28 ouvriers qui tombèrent.10
Mais
les travailleurs comptaient sur le soutien de Hambourg – et ce
soutien ne vint jamais. Les sociaux-démocrates de Hambourg, qui
avaient dénoncé verbalement les menaces du gouvernement contre
Brême, n’étaient pas prêts à transformer en actes leurs
rodomontades. Ils restèrent passifs, et Brême fut réduite.
Le
« nettoyage » de Brême se solda par une centaine de
morts, des arrestations arbitraires suivies d’exécutions sommaires
et de perquisitions en quête d’armes dans les maisons des
travailleurs. Ces mêmes sociaux-démocrates qui avaient
« négocié »
pour faire cesser l’assaut collaboraient désormais avec les
Freikorps pour former un gouvernement d’Etat provisoire.
Cela
dit, l’état d’esprit révolutionnaire des travailleurs n’était
pas complètement brisé. En avril, la ville fut paralysée par une
grève générale pour la libération des prisonniers de février.
Une nouvelle intervention militaire fut nécessaire pour y mettre un
terme, avec des combats de rues, des arrestations en masse, des
procès militaires et des condamnations pour
« pillage »
allant jusqu’à 15 ans de prison.
La Ruhr
Dans
la révolution, comme dans la guerre, le facteur temps peut être
déterminant. Quelques jours, ou même quelques heures, peuvent
décider de la victoire ou de la défaite. Si les sociaux-démocrates
et le Haut Commandement avaient dû faire face à une révolte contre
leur politique explosant de façon simultanée dans tout le pays,
ils n’auraient pas pu survivre. Mais leur organisation centralisée
leur permit de conserver l’initiative. Ils ne pouvaient pas
empêcher la révolte – mais ils pouvaient faire en sorte que les
travailleurs de différentes villes et régions se rebellent
séparément, et soient vaincus séparément.
C’était
particulièrement important en février. Alors que les Freikorps
allaient de Berlin à Brême, la Ruhr entra en ébullition. Ebert et
Noske risquaient de devoir livrer bataille sur deux fronts, ce qui
aurait pu facilement les engloutir. Il leur fallut toute leur science
des concessions verbales pour différer la confrontation dans la Ruhr
jusqu’à ce que Brême eut été écrasée.
La
Ruhr était le cœur industriel du capitalisme allemand. Ses mines et
ses aciéries formaient la base des grands trusts dirigés par Krupp,
Thyssen et Stinnes, qui avaient été la force motrice de la guerre,
qui devaient dominer la vie économique de la république de Weimar,
et qui financeraient l’accession d’Hitler au pouvoir.
Le
9 novembre, lorsque l’empire s’effondra, les travailleurs de la
région étaient déjà d’humeur maussade. Six ans plus tôt, une
grève des mineurs avait été écrasée par la police et la troupe,
et les ouvriers s’étaient retrouvés avec des salaires réduits et
de plus longues journées de travail. Leur organisation n’avait
jamais été traditionnellement forte – elle était divisée en
quatre, avec un syndicat « libre » social-démocrate,
un
syndicat chrétien qui était assez puissant dans la région d’Essen,
un syndicat libéral « apolitique », et une
organisation
spéciale pour les travailleurs immigrés polonais. Pendant la
guerre, l’organisation avait été encore affaiblie par
l’utilisation de prisonniers de guerre comme travailleurs privés
de droits. Malgré tout, il y avait eu de plus en plus de grèves en
1916, 1917 et 1918.
La
Révolution de Novembre s’était, en tant que telle, déroulée
paisiblement dans la Ruhr, où elle n’avait rencontré pratiquement
aucune opposition. Et, dans l’ensemble, les sociaux-démocrates
dominaient les conseils ouvriers fraîchement élus. Mais avant
longtemps les ouvriers commençaient à faire usage de leur liberté
nouvelle pour remettre à l’ordre du jour les revendications
économiques qui n’avaient pas abouti dans le passé.
Déjà,
en octobre, les employeurs s’étaient empressés, pour la première
fois, de reconnaître les syndicats. Ils avaient, pour essayer de
calmer les mineurs, accepté la journée de huit heures. Mais les
mineurs exigeaient déjà davantage – ils voulaient la journée de
six heures, faisant observer que la malnutrition rendait impossible
un travail de huit heures. Le nombre de grèves se multiplia. Au
sommet de la période de famine, la colère contre les employeurs,
qui avaient augmenté le prix du charbon de 50 % en décembre,
était latente.
Les
syndicats mettaient en garde contre les grèves sauvages, et les
travailleurs commencèrent à se retourner contre les bureaucrates,
d’abord dans le syndicat chrétien, puis dans la « Vieille
Ligue », le syndicat social-démocrates.11
Ils étaient aussi, inévitablement, déçus par ceux qui
contrôlaient les syndicats, les dignitaires sociaux-démocrates qui
dominaient les conseils ouvriers.
Les
conseils ouvriers dirigeaient dans la plupart des villes des « forces
de sécurité »
improvisées ou des « forces
du peuple »,
dont ils avaient purgé dès novembre les éléments
révolutionnaires. Désormais elles étaient utilisées contre les
grévistes : à Gladbach la force de sécurité tua trois
manifestants le 17 décembre, et deux autres le 13 janvier.
De
tels incidents amenèrent un nombre croissant de travailleurs à
exiger la réélection des conseils – et dans de nombreux endroits
ce furent en réalité les premières élections, les
sociaux-démocrates ayant simplement nommé leurs propres hommes aux
« conseils ouvriers » dans les premiers jours de la
révolution. A Gladbach, le SPD fut contraint, pour apaiser la colère
provoquée par la fusillade, d’accepter trois communistes dans le
conseil d’ouvriers et de soldats. A Oberhausen, un
« conseil »
mis en place par des représentants du SPD et des partis bourgeois
fut forcé, sous la pression d’éléments radicaux dans les forces
de sécurité locales, de se démettre au profit d’un autre,
constitué de communistes et d’Indépendants. Des développements
semblables menèrent à des changements dans les conseils de Hamborn,
Duisburg, Ickern et Hervest-Dorstein. A Buer, après de nouvelles
élections, un bureaucrate d’Etat qui avait été membre de
l’ancien conseil ouvrier persuada des soldats mécontents
d’assiéger l’hôtel de ville et d’ouvrir le feu sur la réunion
du nouveau conseil, tuant cinq personnes.
La
colère grandissante des mineurs trouva son expression dans la
revendication politique de « socialisation »
de l’industrie minière. Cette dernière avait toujours fait partie
du programme de la social-démocratie et n’avait fait que gagner en
popularité après la chute de l’empire. Cela ne semblait être
qu’une question de temps. Mais les mineurs ne se contentèrent pas
d’attendre que Berlin agisse. Le 10 janvier – alors que la gauche
était écrasée à Berlin et la « république
socialiste »
proclamée à Brême – une conférence d’ouvriers et de soldats
tenue à Essen élut une Commission de Contrôle de neuf personnes
pour occuper les bureaux des trusts miniers. Leur but était « la
préparation de la socialisation des mines »
en collaboration avec le ministère de la socialisation à Berlin.
La
décision fut approuvée par les sociaux-démocrates locaux aussi
bien que par les Indépendants et les communistes, et chacun des
trois partis était également représenté dans la commission de
neuf hommes. Comme un des dirigeants du mouvement le disait plus
tard, « Pendant
qu’à Berlin, Brême et ailleurs, des batailles de rues sanglantes
opposaient les troupes du « Commissaire du Peuple »
social-démocrate aux ouvriers révolutionnaires, à Essen les
dirigeants sociaux-démocrates, indépendants et spartakistes
siégeaient tranquillement ensemble, et votaient aux conseils des
puits ».12
Une
déclaration conjointe des trois partis déclara que la conférence
avait décidé « de
prendre en mains la socialisation des mines »
et qu’ainsi « la
révolution, de politique, devient sociale ».
Mais
les tentatives de superviser les bureaux miniers se heurta à des
sabotages de tous côtés. Les sociétés et la bureaucratie étatique
rendirent aussi malaisée que possible la tâche de la commission de
neuf membres, pendant que les dirigeants syndicaux trouvaient mille
raisons pour ne pas coopérer avec elle.
Au
début, le gouvernement semblait en accord avec le mouvement de
socialisation. Il nomma sa propre commission d’experts chargée
d’élaborer un plan de socialisation, qui bien évidemment laissa
s’écouler de nombreuses semaines avant de déposer son rapport.
Cela suffisait pour empêcher une éruption de colère dans la Ruhr
pendant les semaines cruciales où Berlin et Brême étaient
écrasées.
Mais
au début de février, même les plus chauds partisans du
gouvernement dans les bassins houillers commençaient à trouver
qu’il prenait son temps avec la socialisation. Une nouvelle
conférence des conseils d’ouvriers et de soldats nomma le
communiste Karski « conseiller économique et
journalistique »
de la commission de neuf membres, et présenta au gouvernement un
ultimatum d’une semaine : si la commission ne se voyait pas
investie des pleins pouvoirs pour mettre en œuvre la socialisation,
il y aurait une grève générale.
Le
jour suivant, la position des mineurs fut renforcée par une décision
du conseil des soldats du VIIème
Corps d’Armée basé à Münster, en Westphalie, juste au nord de
la Ruhr, d’ignorer le règlement gouvernemental du 19 janvier
restreignant leur pouvoir et de maintenir un droit de veto sur tous
les ordres militaires dans la région. Il semblait que tout refus du
gouvernement de poursuivre la socialisation rencontrerait une forte
opposition de tous les conseils et de tous les partis ouvriers de la
Ruhr.
Mais
le gouvernement, tout en prétendant mettre en œuvre ses propres
plans de socialisation, faisait de soigneux préparatifs avec le Haut
Commandement militaire. Des unités de Freikorps commencèrent à
faire mouvement de Brême vers la Ruhr, et le général Watter les
utilisa pour désarmer la force de sécurité locale de Munster et
pour arrêter le conseil de soldats. De Münster, les unités
passèrent dans la Ruhr elle-même, entrant dans le village minier
d’Hervest-Dorstein. Une centaine de mineurs armés tentèrent de
résister à leur entrée. Mais l’artillerie brisa bientôt toute
résistance et les villages de mineurs du district furent occupés,
avec les habituelles arrestations de masse. A la fin de la journée
40 mineurs avaient été tués, parmi lesquels Fest, le dirigeant du
conseil ouvrier, qui fut battu à mort alors qu’il se cachait dans
une église.
Des
actions d’une telle brutalité provoquèrent une grande colère
même là où l’influence du SPD était dominante. Une conférence
des conseils ouvriers convoquée à la hâte – mais non
représentative – appela à la grève générale immédiate. Alors
que le travail commençait à cesser, une réunion plus
représentative confirma la décision – mais pas avant que la
majorité des dirigeants sociaux-démocrates aient quitté la salle,
dénonçant un mouvement qu’ils avaient prétendu jusque là
soutenir. Un grand nombre de sociaux-démocrates se joignirent à la
grève, mais d’autres étaient encore suffisamment sous l’emprise
de leurs dirigeants pour les aider à tenter de « rétablir
l’ordre »
contre ceux que la presse sociale-démocrate appelait les
« bandits ».
Les détachements de sécurité sociaux-démocrates attaquèrent les
travailleurs dans un certain nombre d’endroits : à Elberfeld,
des patrouilles des chemins de fer tirèrent sur les ouvriers ;
à Dortmund, la force de sécurité arrêta des travailleurs qui
appelaient à la grève générale ; à Essen, une compagnie de
marins abattit deux ouvriers ; à Barbeck, « l’armée
du
peuple » locale tua encore deux personnes, et d’autres
affrontements à Elberfeld laissèrent 12 morts sur le pavé.
Mais
tout n’allait pas comme le voulaient les autorités. A Bottrop, des
ouvriers armés s’emparèrent de l’hôtel de ville et, après une
bataille acharnée dans laquelle périrent 72 travailleurs, firent
prisonniers les membres de la force de sécurité.
Ce
que l’on a parfois appelé la « première
Armée Rouge de la Ruhr »
exista pendant les quelques jours où les travailleurs armés
agissant au nom des divers conseils ouvriers combattirent l’avance
des Freikorps dans les villes minières et sidérurgiques de l’Ouest
de la Ruhr. Une étude détaillée a récemment conclu :
Le 19 février, les forces de
la gauche
étaient à leur zénith. Elles contrôlaient toute la région
occidentale à l’exception de Duisburg. En plus de Dusseldorf,
Remscheid, Mülheim et Hamborn, les conseils d’ouvriers et de
soldats radicaux contrôlaient Obershausen, les villes de la Wupper,
Dinslaken et Sterkrade. Leur force militaire était suffisante pour
stopper les troupes de Freikorps sur la rivière Boye, entre Gladbach
et Bottrop.13
La
participation à la grève fut massive. Le 20 février, 183 000
ouvriers avaient débrayé. Mais la combinaison de répression
militaire et de trahison social-démocrate commençait à porter ses
fruits ; le jour suivant, leur nombre était tombé à
154 000.
Le jour même, des renforts de Freikorps en provenance de Brême
commençaient à prendre Hamborn.
A
ce moment là, les dirigeants Indépendants décidèrent que la grève
avait échoué. Mais au lieu d’organiser une retraite en ordre, ils
firent la même erreur qu’à Berlin et tentèrent de négocier avec
leurs ennemis. Le noyau de la force armée des travailleurs était à
Bottrop. Mais le succès même des travailleurs était insupportable
pour certains dirigeants Indépendants.
Ils avaient parlé un langage
radical,
mais confrontés brusquement à la réalité de l’effusion de sang
ils perdirent courage. Le tour violent que prenait la grève était
trop pour Baade, le dirigeant pacifiste de l’USPD d’Essen ;
les reportages tendancieux sur la bataille de Bottrop durent aussi
décourager Wills (de l’USPD de Mülheim). Les deux hommes
commencèrent à négocier avec les autorités militaires à
Munster.14
Watter,
toujours dans l’attente de ses renforts de Brême, se montra fort
obligeant – mais revint deux jours plus tard sur ses engagements et
recommença sa marche de ville en ville, entrant dans Bottrop le 23
février avec le cortège habituel d’arrestations massives et
d’exécutions sommaires.
Les
premières secousses de la Ruhr avaient été réprimées – mais au
prix de la radicalisation d’une large couche de travailleurs, comme
le gouvernement aussi bien que le Haut Commandement devaient le
découvrir plus tard à leurs dépens. Avant la lutte, les bassins
houillers du centre et de l’est de la Ruhr étaient encore des
bastions sociaux-démocrates ; après, ce n’était plus le
cas.
L’Allemagne centrale
A
quelques jours de la défaite de la grève générale dans la Ruhr,
l’Allemagne centrale s’enflamma. La région était une des
principales zones minières et tenait, géographiquement, une
importante position stratégique, séparant Berlin du sud et du
sud-ouest du pays – de Munich, Francfort, Stuttgart et de la Ruhr.
Sous
l’empire, sa structure gouvernementale était complexe – et cela
continuait dans les premières années de la république de Weimar.
L’empire était constitué d’une multitude de petites
principautés, de royaumes, et « d’Etats libres ». En
Allemagne centrale, il y avait le royaume de Saxe, qui comprenait
Leipzig, Dresde et Chemnitz, une pléthore d’Etats libres qui
constituaient la Thuringe, comportant Weimar, Gotha et Erfurt, et la
province prussienne de Saxe, avec Halle et Magdebourg – elle-même
souvent appelée de façon à induire en erreur « l’Allemagne
moyenne ».
Au
début de 1919, cette géographie fracturée avait pour équivalent
une importante variété politique. A Halle, Leipzig, Magdebourg et
dans les villes et villages industriels de Thuringe, les
Sociaux-Démocrates Indépendants étaient fortement implantés avant
même la révolution. A l’inverse, à Dresde et Chemnitz le SPD
était au début majoritaire dans la classe ouvrière.
Là
où les Indépendants étaient dominants, l’appareil du
gouvernement local, y compris les pouvoirs de police des détachements
de sécurité, restaient entre les mains des conseils ouvriers, même
après les élections à l’Assemblée Nationale. Le gouvernement de
Berlin était résolu à mettre un terme à cette situation, mais en
faisant en sorte de ne pas attaquer les conseils d’Allemagne
centrale en même temps que Berlin, Brême ou la Ruhr. Le premier
problème était la Thuringe, pour la simple raison que l’Assemblée
Nationale s’était réfugiée à Weimar en vue de se soustraire à
la pression des travailleurs berlinois.
Noske
envoya une section de Freikorps à Weimar « pour
protéger l’Assemblée Nationale ».
Le conseil des soldats de Thuringe s’insurgea, au motif qu’il
était tout à fait capable de s’acquitter de la tâche lui-même,
et s’opposa à la présence de « troupes
extérieures » :
le général Märcher se fit un devoir de dissoudre le conseil au
début de février et décréta une zone close de 10 kilomètres
autour de Weimar. Puis il dirigea son attention vers les autres
villes, à commencer par Gotha, où il occupa les bâtiments
gouvernementaux, les Freikorps faisant feu sur les manifestants qui
protestaient.
Pendant
ce temps des travailleurs, dans une autre partie de l’Allemagne
centrale, passaient à l’action sur une question complètement
différente. Il y avait de plus en plus d’agitation, en particulier
dans les bassins houillers, sur le pouvoir des conseils d’usine et
de puits, que les Sociaux-Démocrates Indépendants présentaient
comme « le
premier pas vers la socialisation ».
Le gouvernement faisait de son mieux pour noyer le poisson par des
négociations : c’était la troisième semaine de février et,
avec les problèmes qu’il avait dans la Ruhr, il ne voulait pas
devoir lutter sur deux fronts.
Le
23 février, il n’était plus possible d’atermoyer, surtout après
que Märcher ait dissous le gouvernement des conseils de Gotha. Une
conférence des délégués des conseils d’ouvriers et de soldats
d’Erfurt et de Merseberg, des puits, des travailleurs de
l’électricité, de la chimie et des chemins de fer vota pour une
action gréviste totale. La moitié des délégués étaient des
Indépendants et le quart des communistes. Mais – détail important
– le reste était constitué de sociaux-démocrates majoritaires.
L’appel à la grève provenait de la direction de la totalité de
la classe ouvrière de la région.
La
grève fut une réussite totale, extraordinaire. Non seulement elle
mit au point mort l’industrie de toute la région, elle stoppa
aussi l’approvisionnement en énergie de Berlin et coupa les liens
ferroviaires entre la capitale et le sud du pays. Les députés de
l’Assemblée Nationale, à Weimar, étaient sans lien avec les
ministères de Berlin. « L’Assemblée
Nationale qui s’était réfugiée à Weimar pour échapper à
« l’influence de la rue » était maintenant au milieu
d'un territoire en grève ».15
Les
Freikorps n’étaient pas adaptés à la résolution d’une telle
crise. Seuls les « certificats de socialisme » dont
pouvaient encore se prévaloir les ministres SPD étaient à même de
calmer la colère des travailleurs. Le gouvernement eut recours à
une manœuvre destinée à diviser les grévistes. Il distribua un
tract ruisselant de phraséologie « de
gauche » :
« Nous
sommes sur
le point fonder les statuts de la démocratie économique. Nous
allons développer les organes de la démocratie économique :
les conseils d’usine ».
Une première page proclamait : « La
socialisation est en marche, avant tout dans les mines ».
Mais, avertissait le texte gouvernemental, tout cela était compromis
par des « terroristes
qui voulaient éliminer l’Assemblée Nationale et détruire le
Reich par l'anarchie politique et économique ».16
Pendant
que ce tract agissait sur ceux des travailleurs qui croyaient encore
aux intentions socialistes du gouvernement, Noske ordonnait aux
Freikorps de marcher de Gotha sur Halle. Cette ville, proche des
chantiers de la Leuna, la plus grande usine d’Allemagne, était
dirigée par un conseil ouvrier Indépendant de gauche, avec un
détachement de sécurité sous l’influence des communistes. Face à
des tentatives de la classe moyenne locale d’affamer les
travailleurs par une « contre-grève », le conseil
ouvrier avait censuré, puis interdit la presse bourgeoise.
Le
conseil ouvrier décida qu’une résistance efficace contre les
Freikorps, lorsque ceux-ci investirent la ville le 1er
mars, avait peu de chances de succès, mais le comportement ignoble
des troupes déclencha bientôt des combats acharnés dans lesquels
27 ouvriers et sept Freikorps furent tués. Märcher mit ensuite sur
pied une version locale des Freikorps, un « Régiment
de Garde » formé
de petits bourgeois et d’étudiants, pour tenir en respect les
travailleurs lorsque ses propres troupes auraient quitté la ville.
Pourtant
le gouvernement essayait encore de présenter une visage « de
gauche » aux grévistes. Dans des négociations, il accepta de
légiférer dans le sens d’un « ancrage » des conseils
d’usine dans la constitution. Même si l’accord réduisait
soigneusement le pouvoir des conseils d’usine, limité à une
fonction de « participation »
indolore aux décisions des employeurs, les délégués d’usine,
influencés par les Indépendants, considéraient que suffisamment de
concessions avaient été faites. Ils appelèrent à la reprise le 6
mars – au moment même où les Freikorps retournaient à Berlin
pour faire face à un mouvement qui avait en partie commencé par un
appel à la solidarité avec les travailleurs d’Allemagne centrale.
A nouveau Berlin
Le
soulèvement berlinois de janvier avait été écrasé parce que ses
participants constituaient une minorité de la classe ouvrière. Ils
avaient été en grande partie désarmés par des soldats qui
subissaient l’influence des sociaux-démocrates avant que les
Freikorps n’entrent dans la ville. Mais les buts des Freikorps et
ceux des soldats qui voulaient une « marche pacifique vers le
socialisme » étaient diamétralement opposés. Il y eut très
rapidement un antagonisme déclaré entre les deux groupes armés qui
avaient vaincu les « spartakistes ». Selon le
commandant
des Corps de Soldats Républicains Sociaux-Démocrates :
Parmi les troupes de Noske
une
propagande constante était organisée contre « Berlin
la rebelle’ » et ses défenseurs socialistes.
(...)
Lorsqu’ils entrèrent à Berlin, ils n’avaient rien de mieux à
faire qu’arracher les brassards des membres du Corps de Soldats
Républicains et de les insulter à tout propos.17
Le
comportement des Freikorps inquiéta même un de leurs généraux.
Märcher écrivit à son supérieur Lüttwitz le 25 janvier :
Il est avéré que la population
de
Berlin a été maintenue pendant dix jours dans une terreur mortelle
par des éléments irresponsables des Freikorps. Ceux-ci deviennent
un danger pour la capitale, et je considère comme très probable que
tôt ou tard des combats opposeront les différents korps.18
Un
historien a soutenu, par ailleurs, que des sections de Freikorps
commençaient à hésiter à accomplir leurs tâches :
Le fait de tirer sur des
travailleurs
allemands, de fouiller leurs appartements à la recherche d’armes
et de faire face aux regards haineux des gens dans les rues devenait
trop ; même pour les Freikorps. Les officiers s’alarmèrent
du changement d’attitude des troupes et les retirèrent à la hâte
de la capitale.19
Il
y avait, en fait, une raison de plus pour retirer la plupart des
Freikorps de Berlin après une quinzaine de jours – on avait besoin
d’eux pour réprimer les travailleurs dans une autre partie de
l’Allemagne. Mais parmi les travailleurs qui s’étaient tenus à
l’écart des combats de janvier il y avait certainement une
hostilité croissante envers les soudards de Noske. Les Indépendants
lui donnèrent une expression en appelant à une grève de
protestation après le meurtre de Luxemburg et de Liebknecht,
s’adressant à « tous
les travailleurs, hommes et femmes, même s’ils n’étaient pas
d’accord avec Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht ».20
D’après un dirigeant des Indépendants de droite, « L’enterrement
(...)
fut la plus impressionnante manifestation de masse que Berlin ait
jamais vue ».21
Les
grandes grèves combatives de la Ruhr et de l’Allemagne centrale en
février bénéficièrent de la sympathie des travailleurs de Berlin.
Six semaines d’occupation militaire n’avaient pas détruit leur
moral, et un mouvement se développa, qui devait mettre à nouveau le
feu aux poudres.
Le
27 février, les ouvriers des entreprises d’Etat de Spandau
appelèrent à une grève, en solidarité avec l’Allemagne centrale
aussi bien que pour une liste de revendications qui leur étaient
propres, allant des augmentations de salaire à l’élection de
conseils d’usine et à la mise en place de tribunaux
révolutionnaires pour juger les anciens chefs militaires. Le
lendemain, la question fut discutée dans une assemblée générale
des conseils de Berlin. Mille cinq cent délégués étaient
présents, chacun représentant 1 000 travailleurs. La
réélection de l’Exécutif des conseils de Berlin révéla un
déplacement politique dans la classe ouvrière : les
Indépendants eurent 205 voix, les Sociaux-Démocrates 271, les
communistes 99 et les Démocrates (le plus « à
gauche »
des partis bourgeois) 95. Le nouvel Exécutif comportait sept membres
SPD, sept USPD, deux communistes et un Démocrate ; pour la
première fois « l’organe de la révolution » de Berlin
pouvait être dominé par la gauche si les communistes et les
Indépendants votaient ensemble.
L’assemblée
générale se réunit à nouveau le 4 mars et cette fois, après une
préparation vigoureuse de la part de travailleurs de Spandau,
Siemens et Schwartzkopf, appela à la grève générale à une large
majorité, comportant les voix des délégués qui soutenaient le
SPD. Les revendications étaient, entre autres, la reconnaissance des
conseils, la libération des prisonniers politiques, l’organisation
d’une garde ouvrière et la dissolution des Freikorps.
Les
spartakistes refusèrent de siéger au comité de grève parce qu’il
comptait des membres du SPD : ils disaient que c’était
contradictoire avec les revendications de la grève, qui étaient en
opposition à la politique du gouvernement social-démocrate.
La
grève fut beaucoup plus suivie que celle de janvier. Toute
l’activité industrielle de Berlin était paralysée, l’électricité
coupée, les bus, les tramways et les trains arrêtés. Ce n’était
pas l’action d’une minorité impatiente de la classe ouvrière,
voulant la révolution socialiste immédiate. C’était une grève à
laquelle participaient un grand nombre de travailleurs qui se
considéraient toujours comme de loyaux sociaux-démocrates, mais qui
étaient perturbés par le résultat des élections (qui avaient
donné la majorité aux partis bourgeois), d’autres qui craignaient
que leur contrôle virtuel des usines ne soit supprimé, ou qui
protestaient contre la répression par les Freikorps, d’autres
encore qui désiraient protéger leur niveau de vie.
Il
y avait aussi une différence marquante dans la façon dont le Parti
Communiste était considéré par comparaison avec janvier. Comme
nous l’avons vu, en janvier la direction était partisane d’une
action défensive
– mais le ton des publications du parti était
« offensif »
et fit peu pour neutraliser l’agitation insurrectionnelle menée
par Liebknecht. Là, le quotidien communiste, Die
Rote Fahne, insistait
fortement et clairement sur le fait que la grève n’était pas une
insurrection. Elle commençait par appeler à une action gréviste
massive :
Travailleurs !
Prolétaires !
Les morts se lèvent à nouveau. A nouveau, ceux qui étaient
piétinés partent en cavalcades. (...) Le gouvernement
« socialiste » d’Ebert-Scheidemann-Noske est devenu
le
bourreau du prolétariat allemand. Aujourd’hui ils ne font que
guetter une occasion de « défendre l’ordre ». Partout
où des prolétaires se dressent, Noske a envoyé ses sbires. Berlin,
Brême, Wilhelshaven, Cuxhaven, Rhénanie-Westphalie, Gotha, Erfurt,
Halle, Düsseldorf : ce sont là les étapes sanglantes de la
croisade de Noske contre le prolétariat allemand.
Elle
continuait en mettant en garde contre la provocation :
Travailleurs !
Camarades du parti !
(...) Que le travail s’arrête ! Restez constamment dans les
usines, pour que les usines ne puissent vous être enlevées.
Rassemblez-vous dans les usines ! Expliquez les choses à ceux
qui hésitent et qui sont restés en arrière. Ne vous laissez pas
pousser à ouvrir le feu sans raison. Noske n’attend que cela pour
avoir une raison de répandre encore plus de sang. (...)
La plus grande
discipline ! La plus
grande attention ! Un calme de fer ! Mais aussi une
volonté
de fer ! Vous tenez le sort du monde entre vos mains.22
Malheureusement,
le parti était encore trop petit pour contrôler la situation comme
il le souhaitait. Ses dirigeants avaient appris les leçons de
janvier, mais un grand nombre d’ouvriers et de soldats qui étaient
jusque là passifs ou du côté du gouvernement étaient attirés par
la lutte. Beaucoup avaient ressenti une profonde déception dans les
semaines qui avaient suivi janvier. Ils détestaient le gouvernement
et les Freikorps, mais ne considéraient pas le petit Parti
Communiste comme le dirigeant naturel de leurs luttes.
Le
gouvernement se préparait à renouveler sa tactique de janvier.
Malgré la grande popularité de la grève parmi les travailleurs
sociaux-démocrates, le gouvernement SPD de Prusse proclama l’état
de siège « pour
protéger le grand Berlin des attaques terroristes d’une
minorité ».
Noske stationna à nouveau des unités de Freikorps dans la ville.
Dès le second jour de la grève, malgré les appels à l’action
non violente, « Berlin
était ébranlée par les tirs d’artillerie, des obus s’écrasaient
sur les maisons des quartiers ouvriers, et les mitrailleuses
crépitaient ».23
Il
y a différentes versions de la façon dont les combats furent
déclenchés – étant donné la grande quantité de travailleurs
engagés dans la grève, il n’est pas surprenant qu’il soit
malaisé d’établir avec précision le déroulement exact des
évènements. L’historien marxiste français Pierre Broué, par
exemple, décrit comment
Dans la nuit du 3 au 4 mars,
des
incidents éclatent dans plusieurs quartiers de Berlin entre
policiers et ouvriers. Plusieurs pillages de magasins se produisent,
dans lesquels les révolutionnaires et les grévistes vont dénoncer
l'oeuvre de provocateurs. Au matin du 4, tenant un prétexte, Noske
donne aux corps francs l'ordre de marcher sur Berlin.
Le 4, une foule énorme se
rassemble au
début de l'après-midi sur la place Alexandre à proximité de la
préfecture de police : la colère y monte rapidement quand
parviennent les nouvelles des Incidents de Spandau : les corps
francs ont désarmé les soldats qui gardaient le dépôt de
mitrailleuses et des fusillades se sont produites. Un détachement
des corps francs de von Lüttwitz tente de pénétrer dans la
foule :
l'officier qui le commande est malmené, et les chars d'assaut
interviennent, tirant sur la foule pour faire évacuer la
place :
c'est « une effroyable boucherie ». (...)
Le
jour suivant, les Freikorps
firent mouvement contre un détachement des marins de la Division du
Peuple – qui étaient restés neutres en janvier. L’incident fut
décisif : les marins, dans leur majorité, se retournèrent
contre les Freikorps, distribuant à la foule les stocks d’armes à
leur disposition.24
L’historien
américain R M Watt, lui, met le déclenchement des combats sur le
compte d’une action concertée d’un partie des
révolutionnaires :
La grève n’avait pas été sitôt
proclamée que des révolutionnaires armés attaquaient et prenaient
32 postes de police berlinois. Les matelots de la Division de Marine
du Peuple marchèrent dans les rues et assiégèrent les plus
importants commissariats.25
Aussi
bien M Phillips Price que Heinrich Ströbel – qui étaient en
Allemagne à l’époque – avancent des versions plus proches de
Broué que de Watt. Phillips Price écrit :
Il s’avéra bientôt que le
combat
n’opposait pas le corps de volontaires de l’ancienne armée aux
forces spartakistes, mais les premiers, d’une part, à la Division
de Marine du Peuple et aux Corps de Soldats Républicains, qui
avaient toujours été considérés comme une force loyale envers le
gouvernement.26
Et
Ströbel écrit :
Les combats de mars a Berlin
n'avait pour
origine rien d'autre que les jalousies et la méfiance des gardes de
Noske envers les pauvres restes des troupes révolutionnaires des
journées de novembre, la Division Populaire de Marine et la Garde
Républicaine. Ces troupes étaient une épine dans le pied des
officiers et des généraux qui commandaient les Corps Francs de
Noske, et elles devaient être dispersées à tout prix. (...) Ces
combats étaient donc issus aussi de conflits entre ces deux corps de
troupe. Les communistes avaient aussi peu à voir là dedans que les
Indépendants.27
Le 5 mars une foule se
rassembla sur
l’Alexanderplatz, face au quartier général de la police, et des
voyous commencèrent à piller un entrepôt. La Division Populaire de
Marine (...) envoya 800 hommes et deux camions en réponse à un
appel téléphonique du quartier général de la Police leur
demandant de rétablir l’ordre. Ce détachement arrêta 20 pillards
et plaça un garde devant l’entrepôt.
Alors qu’une députation de la
Division
de Marine quittait le quartier général de la police (dirigé par la
droite depuis janvier) le chef de la députation fut blessé par un
coup de feu. (...) En un clin d’œil, des tirs étaient échangés
entre la Division de Marine et le bâtiment de la police. Et les
évènements de la semaine Spartakus se répétèrent, avec de
légères variations. Une section de la Division de Marine et les
Gardes Républicains, renforcés par des civils en armes, se
retranchèrent dans le quartier est de Berlin, pendant que les
troupes de Noske occupaient le centre et les autres parties de la
ville.28
Le
commandant du Corps de Soldats Républicains, Fischer, donne une
version à peu près identique.29
Le
Parti Communiste continuait à se dissocier complètement du combat.
Il distribua un tract qui expliquait que les affrontements étaient
le fait des sections de la Division de Marine du Peuple et du Corps
de Soldats Républicains, qui avaient été contre les travailleurs
en janvier :
Nous
luttons pour le socialisme et contre le capitalisme, et leurs chefs
luttent pour leurs postes militaires contre leurs employeurs avec qui
ils se sont brouillés. C'est tout cela et plus encore qui nous
sépare d'eux. Entre eux et nous n'existe aucune solidarité
politique30
Le
moins qu’on puisse dire, c’est que les dirigeants communistes
avaient vis à vis du combat une attitude trop abstentionniste. Le
fait que les marins et les sociaux-démocrates de base du Corps
Républicain aient été du mauvais côté en janvier ne signifiait
pas qu’ils étaient incapables de comprendre – à la dure –
leurs erreurs passées.
Mais
les déclarations du Parti Communiste avaient de toute façon peu
d’effets. Les dirigeants syndicaux sociaux-démocrates de Berlin,
qui s’étaient sentis obligés de soutenir la grève du fait de la
pression de leur base, prirent alors prétexte des combats pour
changer de camp. Le 6 mars, ils appelèrent à la reprise. Lorsqu’ils
se trouvèrent en minorité dans l’assemblée des conseils
ouvriers, ils se retirèrent purement et simplement, faisant
distribuer des tracts et coller des affiches appelant à reprendre le
travail.
Les
Freikorps profitèrent immédiatement de cette trahison et des
divisions dans les rangs des travailleurs. Ils commencèrent par
briser la grève, assurant la distribution du ravitaillement dans la
partie bourgeoise de la ville. Au but de deux jours, la grève
n’avait plus aucun effet, et le comité de grève fut obligé à
appeler à une reprise sans conditions. Le 9 mars, la grève et les
combats étaient terminés.
Mais
Noske et ses amis ne s’estimaient pas satisfaits. Ils voulaient
gagner la guerre, et pas seulement une bataille. Et ils pensaient que
ni la gauche révolutionnaire ni le mouvement ouvrier n’étaient
alors en mesure de se défendre. L’attaque qui suivit
dépassait
de loin en horreur sanglante tout ce que Berlin avait connu en
janvier lors de la « semaine spartakiste ». Pendant
des
jours, la Reichswehr a combattu dans les quartiers prolétariens de
Berlin avec toutes les ressources de la guerre moderne – des
canons, des lance-mines et des avions. D’innombrables maisons
furent endommagées, certaines complètement détruites par des
grenades et des bombes. (...) Dans de nombreux cas, les travailleurs
chez lesquels on trouvait une arme à feu étaient même exécutés
sur place.31
Le
nombre de morts a été estimé à entre 1 500 et 2 000,
avec 20 000 blessés. Le nombre des tués, à gauche, était dix
fois supérieur à ceux du camp gouvernemental.
Noske
eut recours à des mensonges éhontés – auxquels la presse,
social-démocrate et bourgeoise, emboîta le pas sans sourciller –
pour justifier un tel bain de sang. On proclama que les spartakistes
étaient à l’origine des combats et qu’ils avaient massacré 70
policiers du poste de Lichtenberg. « C’était
faux et Noske le savait »,
a conclu récemment un historien qui n’est pas suspect de
sentiments de gauche, « mais
il était commode qu’il y eût une « atrocité » à
venger : cela fournissait une excuse pour des représailles ».32
Noske
édicta un décret selon lequel tout individu trouvé les armes à la
main serait exécuté sommairement. Vorwärts,
le quotidien social-démocrate, estima que c’était la seule
réponse possible aux « atrocités
de Lichtenberg ».
De nombreux travailleurs et soldats loyaux envers le SPD furent ainsi
assassinés. Exemplaire fut le sort de certains membres de la
Division de Marine du Peuple qui n’avaient pas pris part aux
combats. Ils furent attirés dans un bâtiment où, leur avait-on
dit, ils allaient toucher leur solde. A leur arrivée, 29 d’entre
eux reçurent l’ordre de se rendre derrière le bâtiment, où ils
furent abattus sur le champ.
Dans
les districts ouvriers, des centaines de personnes connurent un sort
semblable – parmi lesquels Leo Jogiches, le collègue de toute une
vie de Rosa Luxemburg et le dernier des dirigeants les plus
expérimentés du Parti Communiste.
A nouveau La Ruhr
Les
premières expéditions des Freikorps, en janvier et février,
étaient rarement suffisantes pour en finir une fois pour toutes avec
la résistance armée des travailleurs. Max Hoeltz – qui devint une
vedette nationale comme une espèce de Robin des Bois communiste ou
de Che Guevara – a décrit dans ses mémoires la situation dans le
Vogtland, la région proche de la frontière tchèque. Les Freikorps
pénétraient dans une ville le matin ; les travailleurs armés
se cachaient dans les forêts environnantes ; les Freikorps
partaient à midi ; les travailleurs armés entraient à nouveau
dans la ville et tenaient un meeting pour les milliers de chômeurs.33
Cela
devait être la situation de nombreuses villes industrielles où les
Freikorps n’avaient pas suffisamment de soldats pour conserver une
garnison permanente – même si cela ne prenait pas toujours une
forme aussi dramatique. La force armée pouvait briser une minorité
isolée de travailleurs, comme les révolutionnaires de Berlin en
janvier ; elle pouvait empêcher la classe ouvrière dans son
ensemble de prendre le pouvoir dans une localité
particulière ;
mais elle ne pouvait pas annihiler toute résistance.
Cela
fut démontré de façon éclatante dans la Ruhr. A la fin mars, il
s’y développa un nouveau mouvement qui avait beaucoup moins
d’illusions sur le gouvernement. Les ouvriers en avaient assez des
vagues discours sur la « socialisation ». Au lieu de
cela, ils se tournèrent vers des questions qui étaient en rapport
avec la substance de leur vie quotidienne – la journée de six
heures. Comme Rosa Luxemburg l’avait prédit en décembre, la
révolution s’approfondissait dans la lutte sur le lieu de travail.
Le
soutien à la revendication de la journée de six heures grandit au
cours du mois de mars, de telle sorte que les bureaucrates qui
dirigeaient les syndicats de mineurs durent la soutenir verbalement –
même s’ils parlaient d’en répartir l’application sur une
période de deux ans. Les mineurs n’avaient pas envie d’attendre.
Le 27 mars, 32 puits imposèrent la journée de six heures de la
façon la plus simple : en débauchant deux heures plus tôt.
Une conférence sur ce thème à la fin du mois réunit 475 délégués
de 195 puits. Une tentative de la part du syndicat contrôlé par les
sociaux-démocrates de mettre un terme à la lutte ne servit qu’à
mettre en colère les délégués, qui votèrent pour la formation
d’un « Syndicat Général des Travailleurs des Mines »
révolutionnaire, avec une direction conjointe KPD-USPD – une
décision contre laquelle le dirigeant communiste Karski mit en
garde.
La
lutte qui suivit fut acharnée. Huit travailleurs furent abattus par
les « forces de l’ordre » à Castrop le 31 mars. Le 1er
avril, le mouvement parti des mines gagna l’industrie lourde, où
les ateliers de martelage Krupp se mirent en grève. Le 4 avril, des
délégués de 211 puits appelèrent à une grève conjointe avec
l’Allemagne centrale et la Haute Silésie – les deux autres
régions houillères d’Allemagne. Le gouvernement coupa alors
l’approvisionnement en vivres des deux zones en grève, et envoya
les Freikorps occuper les centres principaux.
Les
troupes eurent recours aux méthodes les plus brutales pour tenter de
briser la grève. Ce n’était plus seulement les manifestants et
les piquets qui étaient attaqués : les soldats ouvrirent le
feu sur une réunion syndicaliste, tuant quatre personnes, et à
nouveau quelques jours plus tard sur une réunion de plusieurs
centaines de délégués des grévistes, dont quatre cents furent
conduits en prison.
La
grève, confrontée à une telle provocation, ne fit que monter en
puissance : 160 000 grévistes le 1er
avril, 300 000 le 10 ; selon une étude historique le
nombre total aurait atteint 800 000.34
Le nombre de mineurs grévistes fut dépassé par celui des autres
travailleurs en grève de solidarité, avec également des arrêts de
travail de sympathie dans d’autres régions d’Allemagne – à
Württemburg, à Berlin, à Francfort, à Dantzig.
Le
gouvernement perdait de plus en plus le contrôle de la situation.
Les dirigeants syndicaux lui disaient qu’une seule chose pouvait
arrêter la grève : « Seule la mise en place
de la
journée de six heures peut ramener les mineurs sous le contrôle des
organisations ».
Noske
avait nommé le politicien social-démocrate Severing commissaire
spécial pour la Ruhr, avec des pouvoirs quasi-dictatoriaux. C’est
lui qui avait supervisé la plupart des mesures répressives. Mais il
devint rapidement clair que seules des concessions pouvaient mettre
fin à la grève. Les mineurs se virent finalement offrir la journée
de sept heures – à condition qu’ils fassent des heures
supplémentaires lorsque c’était « essentiel ». La
proposition était enrobée de nouvelles menaces – des décrets
prévoyaient des amendes de 500 marks ou des sentences de 12 mois de
prison pour quiconque continuerait la grève. Cette combinaison –
en plus de la faim très réelle dont souffraient la plupart des
familles de mineurs – commença à porter ses fruits. Dès le 24
avril, le nombre des mineurs grévistes était descendu à
130 000.
En même temps que la grève donnait des signes de fatigue, la
répression s’intensifia, jusqu’à ce que la majorité des
dirigeants élus des travailleurs de la région fussent les
prisonniers du gouvernements et de ses chiens de chasse militaires.35
Le retour de l’ordre ancien
La
marche des Freikorps à travers l’Allemagne annihila les conseils
d’ouvriers et de soldats naguère si puissants. Le pouvoir des
conseils – en particulier celui des conseils de soldats en armes et
les sections de gauche des détachements de sécurité – fut
remplacé par la vieille structure étatique de l’Allemagne du
Kaiser, avec ses bureaucrates, ses officiers, ses juges et ses
commissaires de police qui, dans l’ensemble, avaient les mêmes
opinions que les membres des Freikorps qui avaient restauré leur
pouvoir – ils soutenaient les partis bourgeois les plus à droite.
Comme le personnel des Freikorps, ils devaient finalement devenir des
supporters enthousiastes du IIIème Reich nazi.
Mais, pour
l’instant, la bourgeoisie ne se sentait pas encore suffisamment en
sécurité pour permettre à l’extrême droite de se pousser au
centre de la scène politique : elle avait encore besoin des
dirigeants sociaux-démocrates.
Comme
le formulait Stresemann, dirigeant du parti des grands milieux
d’affaires, le Parti National du Peuple Allemand :
Un
gouvernement sans ministres sociaux-démocrates me paraît tout à
fait impossible dans les deux ou trois prochaines années, sinon nous
allons avoir grève générale sur grève générale.36
Un
signe que le mouvement ouvrier était loin d’être définitivement
brisé fut l’entrée dans la lutte, au cours de l’été 1919, des
éléments les plus attardés de la classe ouvrière. Des centaines
de milliers de salariés agricoles adhérèrent à un syndicat pour
la première fois en été 1919 (après
la marche des Freikorps en Allemagne), portant ses effectifs à
700 000. Ils défiaient les grands propriétaires jadis
tout-puissants, les Junkers, exigeant des augmentations de salaire et
la fin des restrictions imposées à leurs vies personnelles.
Dans
un tel contexte, les sociaux-démocrates eux-mêmes ne pouvaient
survivre s’ils permettaient à l’opinion de les considérer comme
une simple façade des Freikorps. Il leur fallait encore faire des
phrases sur la « socialisation », la
« démocratie
industrielle », même s’ils y mettaient moins de conviction.
Et il leur fallait faire semblant de croire que les conseils ouvriers
existaient encore. Ils convoquèrent un Second Congrès National des
Conseils Ouvriers à la mi-avril. C’était un exemple, s’il en
fut, dont la façon dont l’histoire se répète, la première fois
comme une tragédie, la seconde comme une farce.
Les
délégués du Premier Congrès avaient le pouvoir, et
l’abandonnèrent tragiquement. Le Second Congrès, lui, fut réuni
après que le pouvoir des conseils ait été détruit à peu près
partout. Ses 219 délégués n’étaient plus élus par des conseils
locaux, basés dans les usines et les casernes, mais par des scrutins
de district ouverts à tous ceux qui avaient un revenu inférieur à
10 000 marks, ce qui assurait au SPD une majorité des trois
quarts. Les communistes boycottèrent le congrès qualifié de
« parent pauvre de l’Assemblée Nationale ». Après que
le congrès eut entériné la reconstitution du pouvoir bourgeois, on
n’entendit plus parler de lui.
Cela
dit, pour le gouvernement le « nettoyage » n’était
pas
terminé. Non seulement il y avait le royaume de Bavière, autrefois
autonome, où le mouvement des conseils connaissait son zénith au
moment même où le Second Congrès l’enterrait partout ailleurs,
mais il y avait d’autres districts où le pouvoir était toujours
entre les mains d’élus de la classe ouvrière.
L’écrasement
définitif de l’Allemagne centrale avait été remis à plus tard,
les Freikorps étant absorbés par des troubles à Berlin, puis par
un regain des luttes dans la Ruhr.
Magdebourg
était toujours administrée par un conseil d’ouvriers et de
soldats dirigé par les Indépendants. La région était tranquille
depuis la révolution et ne s’était pas associée à la grève de
février. Mais cela n’empêcha pas Noske de donner à un fabricant
local de spiritueux (un futur nazi) tout pouvoir pour constituer une
« Garde locale » petite-bourgeoise afin de
« rétablir
l’ordre », ni de traîner trois dirigeants des conseils
ouvriers (dont un SPD) à Berlin sous mandat d’arrêt. Le 9 avril,
les Freikorps entrèrent dans la ville, tirèrent sur des
manifestants, en tuant sept, arrêtèrent le conseil ouvrier et
armèrent les forces de la classe moyenne, la Garde locale et le
« Régiment de Magdebourg ».
Puis
ce fut le tour de la ville de Braunschweig, où les travailleurs
s’étaient joints en avril à une grève générale de toute
l’Allemagne en solidarité avec la Ruhr. Les dirigeants de la grève
étaient en fait le pouvoir de la ville depuis plusieurs jours,
contrôlant la distribution du ravitaillement et faisant respecter un
couvre-feu. Le 11 avril, 10 000 Freikorps pénétraient dans la
ville. Ils rencontrèrent au début une résistance armée, et 11
travailleurs furent tués dans des escarmouches. Puis les chefs
grévistes décidèrent que toute résistance était devenue inutile
– ce qui n’empêcha pas les Freikorps de satisfaire pleinement
leur appétit de meurtre habituel.
Finalement,
des mouvements furent opérés contre Leipzig – un point sensible
non seulement pour les autorités d’Allemagne centrale, mais aussi
pour le gouvernement national. En même temps que le reste de la Saxe
– en particulier Chemnitz – restait un bastion du SPD, Leipzig
subissait fortement l’influence de conseils d’ouvriers et de
soldats à majorité Indépendante. Ses travailleurs avaient pris
part à la grève générale de février, et le journal communiste
Rote Fahne se réfugia
à Leipzig lorsqu’il fut interdit à Berlin. Le 11 mai, 20 000
Freikorps occupaient la ville sans rencontrer de résistance,
dissolvaient les conseils, interdisaient la presse de gauche et
mettaient en place une « Garde locale » à composition
petite bourgeoise pour maintenir l’ordre.37
Hambourg,
la deuxième ville allemande, était un bastion traditionnel de la
social-démocratie. En 1913, le parti y comptait 40 000 membres
et les « syndicats libres » 140 000, sur une
population d’un million d’habitants. Il tenait tous les sièges
de la ville au parlement national, même si le mode de scrutin peu
démocratique « à trois classes » le maintenait en
minorité au Sénat et à la Burgerschaft qui gouvernaient la ville.
Avant
la guerre, Hambourg était aussi un des rares centres industriels
dans lesquels l’activisme syndical tendait à échapper au contrôle
du mouvement ouvrier « officiel ». Il y eut des
grèves
dures en 1896-97, en 1906 et en 1912. « Il y avait (...) dans
le mouvement ouvrier de Hambourg un élément qui grandissait
rapidement. (...) Un groupe de travailleurs relativement important,
d’abord dans le port puis aussi dans d’autres zones, qui n’était
pas vraiment représenté dans les syndicats, les coopératives ou
les organisations du parti ». Dans les années de l’immédiat
avant-guerre, « les grèves sauvages se suivaient de
près ».38
La
ville aurait dû être idéale pour devenir un centre de l’extrême
gauche en 1918-19, et au début c’était la direction que
semblaient prendre les choses. Elle avait été, comme nous l’avons
vu, la première ville à suivre l’exemple de Kiel et à renverser
l’ordre ancien, le 5 novembre. Les sociaux-démocrates majoritaires
locaux furent complètement dépassés par les évènements. Les
conseils ouvriers, élus par des délégués des usines dans les
premiers jours de la révolution, avaient une claire majorité à
gauche du SPD, et élurent comme président et dirigeant réel de la
ville le Radical de Gauche Heinrich Laufenberg.
Laufenberg
était un ancien social-démocrate de droite qui était passé à
gauche en réaction à la guerre et qui avait établi des liens avec
les « Radicaux de Gauche » de Brême. Il avait acquis
une
énorme popularité dans de larges couches de travailleurs lorsque la
lassitude de la guerre s’était répandue. Cela lui permettait de
dominer le conseil ouvrier, même si la « majorité de
gauche »
était essentiellement composée d’Indépendants.
Mais
les sociaux-démocrates, ainsi que les banquiers et les négociants
qui naguère dominaient la ville, passèrent bientôt à la
contre-attaque. Les sociaux-démocrates s’empressèrent de se
constituer une majorité dans les conseils de soldats, pendant que
les banquiers menaçaient de couper tout crédit au gouvernement
local.
Laufenberg
se fit plus tard une réputation comme
« ultra-gauche ».
Cela dit, à cette époque son comportement était du genre
normalement associé avec l’USPD. Il subordonnait tout à des
manœuvres destinées à lui conserver le contrôle des conseils, son
gouvernement « de gauche » bien installé aux
commandes.
Il accepta l’argument des sociaux-démocrates sur la nécessité
des élections à l’Assemblée Nationale39,
et, après avoir dissout le Sénat municipal le 10 novembre, le
rétablissait le 18 pour obtenir des crédits bancaires.
Laufenberg
continuait à faire usage des ministères et de leurs équipes de
fonctionnaires. (...) A Hambourg, le véritable pouvoir résidait
exactement là où il avait toujours été – entre les mains de la
grande bourgeoisie des affaires et de la finance, et de la
bureaucratie d’Etat.40
Laufenberg
ne se préoccupa même pas d’assurer l’existence d’une presse
révolutionnaire indépendante – au lieu de cela, il négocia avec
les sociaux-démocrates le contrôle conjoint d’un journal imprimé
sur leurs presses.
Un
gouvernement basé sur la conciliation avec les banquiers et les
sociaux-démocrates pouvait difficilement passer à l’action face
au chômage et à la pénurie de denrées alimentaires. Il était
facile pour les sociaux-démocrates de mettre tous les problèmes de
la classe ouvrière sur le compte du gauchiste Laufenberg. Au début
de janvier, ils furent en mesure de contrer les grandes
manifestations pro-Laufenberg par des manifestations encore plus
importantes. Un signe du manque de soutien réel pour la politique de
Laufenberg dans la majorité de la classe ouvrière fut donné par
les résultats des élections à l’Assemblée Nationale de la
mi-janvier : le SPD obtenait 51 % des voix à
Hambourg,
l’USPD 7 % seulement. Un autre signe était que le conseil
ouvrier n’exerçait aucun contrôle sur des troupes qui avaient été
constituées en « armée du peuple » :
celle-ci
arrêta même une fois Laufenberg.
Finalement,
le 19 janvier, Laufenberg fut contraint de reconnaître que les
manœuvres politiques n’étaient pas un substitut satisfaisant à
l’organisation sur le terrain. Il démissionna de son poste de
président des conseils, permettant une nouvelle élection qui donna
la majorité au SPD. Cette majorité devait bientôt transmettre le
pouvoir à un nouveau Sénat dirigé conjointement par les vieux
oligarques de la ville et la majorité électorale social-démocrate.
Cela
dit, le SPD avait encore une crise majeure à surmonter. L’invasion
de la voisine Brême par les Freikorps à la fin de janvier provoqua
à Hambourg une colère profonde, et Laufenberg n’eut aucun mal à
faire voter au conseil ouvrier une résolution selon laquelle une
assistance armée devait être dépêchée à Brême.
Mais
Laufenberg n’avait pas encore appris que le succès de ses discours
et de ses résolutions n’était pas égal à l’action. Le manque
d’organisation de la gauche révolutionnaire, qu’il avait refusé
de construire, était désormais une faiblesse fatale. Des
travailleurs armés s’assemblèrent pour partir pour Brême – et
s’aperçurent que les fonctionnaires des chemins de fer et les
bureaucrates syndicaux sociaux-démocrates avaient saboté les moyens
de transports.41
De violentes manifestations suivirent, mais les sociaux-démocrates
de Hambourg montrèrent qu’ils pouvaient y maintenir l’ordre avec
leur propre force armée et n’avaient pas besoin des Freikorps de
Brême – dont la présence, d’ailleurs, était requise d’extrême
urgence dans la Ruhr.
Malgré
tout, une fois que les sociaux-démocrates furent de façon visible
la force politique dominante à Hambourg, ils ne pouvaient plus
accuser les autres de la misère endémique et commencèrent à voir
s’effriter leur popularité parmi les travailleurs. Il y eut à la
mi-avril de violentes manifestations contre le chômage, et –
mauvais présage – l’armée du peuple témoigna d’une grande
sympathie envers les manifestants.
L’hostilité
pour le nouveau pouvoir s’exacerba à la fin de juin. A l’occasion
d’une manifestation apparemment spontanée, des travailleurs, des
soldats et des marins dirigèrent une procession de brouettes partant
d’une conserverie locale de viande où était fabriquée la Sülze
(viande en gelée). La première brouette transportait le
propriétaire de l’usine, suivie par d’autres portant des
travailleuses de l’usine qui agitaient des têtes de chien et des
rats morts qui, semble-t-il, entraient dans la composition de la
viande en gelée. La manifestation bon enfant fut conclue par
l’immersion du propriétaire dans les eaux de l’Alster.
Les
autorités étaient profondément perturbées par ces événements.
Une fois de plus, l’armée du peuple s’était rangée du côté
des manifestants. Le commandant de la ville décida que le moment
était venu de montrer où était le vrai pouvoir – il envoya 300
hommes des Bahrenfelder, une version locale des Freikorps, prendre le
contrôle de l’hôtel de ville. Mais il sous-estimait les capacités
combattantes des ouvriers hambourgeois. Une véritable guerre civile
fit rage cette nuit là, et, au matin, les Bahrenfelder avaient été
expulsés de l’hôtel de ville et désarmés. Dix-neuf des soldats
de droite furent tués dans les combats pendant que la gauche perdait
seize hommes – six sociaux-démocrates, cinq Indépendants et cinq
communistes.
La
paix régna bientôt. La gauche avait assimilé l’amère leçon de
Berlin et de Brême, et ne fit aucune tentative pour prendre le
pouvoir. Une fois les Bahrenfelder désarmés, elle exhorta les
travailleurs à ne pas rester dans les rues. Mais cet
« ordre »
ne valait rien pour Noske à Berlin. L’armée du peuple de Hambourg
avait montré qu’elle ne pouvait pas protéger les profiteurs de
l’humiliation – elle devait donc être remplacée par une force
« sûre’. Le 30 juin, 10 000 Freikorps entrèrent dans
la ville avec auto-mitrailleuses, torpilleurs et artillerie. Il
s’ensuivit une occupation militaire qui devait durer jusqu’en
décembre.
A
Chemnitz, de l’autre côté de l’Allemagne, les évènements
furent, en août, très semblables à ceux de juin à Hambourg. La
ville était aussi, et depuis longtemps, un bastion social-démocrate.
La gauche révolutionnaire, qui avait joué un rôle important en
novembre, n’avait pas fait l’erreur de s’accrocher au pouvoir
en l’absence d’un soutien de la majorité de la classe ouvrière.
La ville était dirigée par les sociaux-démocrates, qui
maintenaient l’ordre au moyen de leurs propres forces de sécurité.
Les
sociaux-démocrates au pouvoir perdaient rapidement leur soutien
populaire. En août, il y eut des troubles – liés en particulier à
la pénurie de produits alimentaires. Il y eut au début du mois une
semaine de manifestations pacifiques. Les militaires s’employèrent
alors à créer des désordres. Des tracts antisémites incitaient
les foules à la violence. Puis, le 7 août, des troupes locales
tirèrent sur la foule. L’ensemble de la classe ouvrière de la
ville se souleva contre la provocation militaire. Alors que les
sociaux-démocrates du gouvernement saxon décrétaient que tout
travailleur qui prendrait les armes contre les troupes serait
fusillé, le SPD local était contraint de se joindre aux
protestations contre les soldats.
Cette
première attaque des militaires fut rapidement maîtrisée – 14
soldats et 15 travailleurs avaient été tués – mais Noske
disposait désormais de l’excuse dont il avait besoin. Dix jours
plus tard, un large contingent de troupes entra dans la ville,
interdit la presse communiste, et commença à constituer une force
de police « sûre ».42
Hambourg
et Chemnitz prouvèrent de façon définitive que la marche des
Freikorps n’était pas seulement dirigée contre la gauche, mais
contre toute force armée indépendante basée dans le mouvement
ouvrier. Dans les deux cas, l’intervention armée provoqua une
grande colère contre les sociaux-démocrates, mais il y avait des
différences – différences qui devaient s’avérer vitales dans
le cours suivant de la révolution.
A
Hambourg, il n’y avait personne pour former une organisation
révolutionnaire substantielle à la gauche des Indépendants.
C’était la conséquence inévitable du jeu de Laufenberg avec le
pouvoir et la confiance illimitée qu’il avait dans les
résolutions. C’est l’USPD qui recueillit en termes de croissance
les fruits du mécontentement des travailleurs, et non le parti
communiste. Mais l’USPD était incapable de fournir une ligne
claire dans les moments décisifs. Lorsque la grande crise suivante
de la révolution éclata en mars, l’USPD était un salmigondis de
tendances rivales incapables de donner la moindre orientation au
mouvement des travailleurs.
On
parla beaucoup, plus tard, de « Hambourg la Rouge ».
Pourtant, le fait est que les échecs organisationnels de 1919
devaient hanter la ville tout au long de l’histoire de la
République de Weimar : les sociaux-démocrates restèrent plus
forts que les communistes dans le mouvement ouvrier local.
A
Chemnitz, au contraire, la gauche révolutionnaire avait commencé,
dès après la Révolution de Novembre, par faire une évaluation
honnête de ses forces. Sous le leadership du travailleur du bâtiment
Heinrich Brandler, elle avait évité tout insurrectionnisme
prématuré ou toute tentative de s’accrocher au pouvoir à l’aide
de subterfuges. Au lieu de cela, elle avait soigneusement construit
ses forces, servant de point de ralliement à tous ceux qui perdaient
leurs illusions dans le SPD, et empêcha l’USPD de s’enraciner
profondément. Au printemps 1920, elle était en position de conduire
tout le mouvement ouvrier de la ville à la bataille.