1922 |
Entre l'impérialisme et la révolution
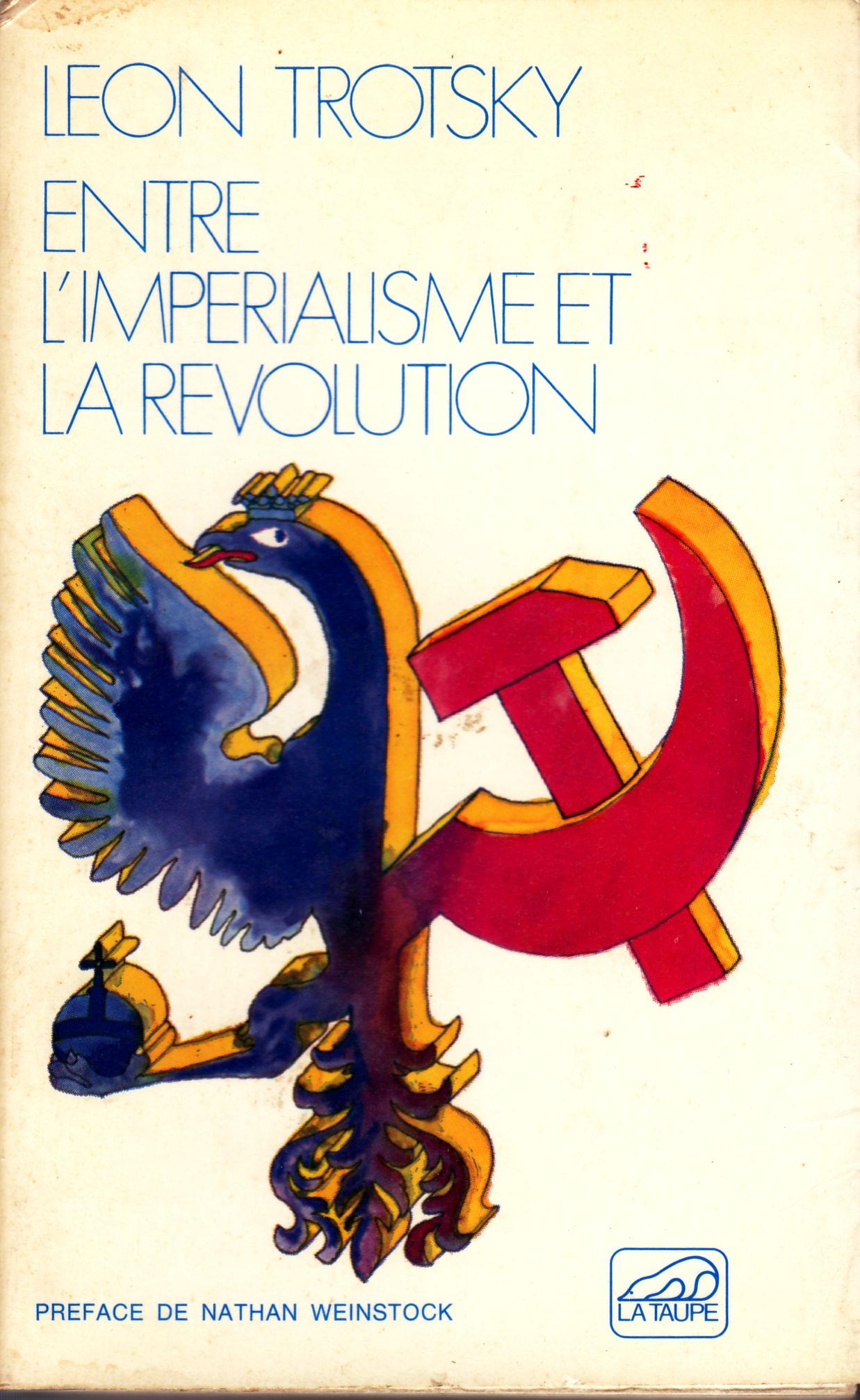
chapitre I.
Comment les mencheviks renversés du pouvoir représentent-ils le sort de la Géorgie ? Il s’est formé sur ce pays toute une légende destinée à empaumer les simples d'esprit. Or, les simples d’esprit ne manquent pas ici-bas.
De son plein gré, le peuple géorgien décida de se séparer en bonne amitié de la Russie. Ainsi commence la légende. Cette décision, le peuple géorgien-l’exprima par un vote démocratique. En même temps, il inscrivit sur son drapeau un programme de neutralité absolue dans les relations internationales. Ni en action ni en pensée, la Géorgie ne s’immisça dans la guerre civile russe. Ni les empires centraux, ni l’Entente ne purent la faire dévier de la voie de la neutralité. Sa devise était : Vis à ta guise et laisse les autres en paix. Ayant appris l’existence de cette terre bénie, quelques vieux pèlerins (Vandervelde, Renaudel, Mrs Snowden) prirent immédiatement des billets directs pour la Géorgie. Courbé sous le faix des ans et de la sagesse, le vénérable Kautsky ne tarda pas à les suivre. Tous, semblables aux premiers apôtres, ils conversèrent en des langues qu’ils ne connaissaient point et eurent des visions qu’ils relatèrent ensuite dans des articles et des livres. Chemin faisant, de Tiflis à Vienne, Kautsky ne cessa de chanter de Nunc dimittis…
Mais les bons pasteurs n’avaient pas encore eu le temps d’apporter à leurs ouailles la bienheureuse nouvelle qu’une chose horrible se produisait : Sans motif aucun, la Russie soviétique lança son armée sur la Géorgie démocratique, qui prospérait dans une neutralité pacifique, et écrasa impitoyablement la République démocratique, objet de l’amour des masses populaires. C’est dans l’impérialisme effréné du pouvoir soviétique et, en particulier, dans sa jalousie pour les succès démocratiques des mencheviks géorgiens qu’il faut chercher la raison de ce monstrueux forfait. Là, en somme, finit la légende. Ce sont ensuite des prophéties apocalyptiques sur la chute inévitable des bolcheviks et sur la restauration des mencheviks dans leur splendeur première.
C’est à la démonstration de cette légende qu’est consacré l’édifiant opuscule de Kautsky.[1] C’est sur cette légende également que sont basés les résolutions de la IIe Internationale sur la Géorgie, les articles du Times, les discours de Vandervelde, les sympathies avouées de la reine de Belgique et les écrits des Hervé et des Merrheim. S’il n’a pas encore été publié d’encyclique papale là-dessus, c’est uniquement à la fin prématurée de Benoît XV qu’il faut l’attribuer. Son successeur, espérons-le, comblera cette lacune.
Pourtant, si, semblable à beaucoup d’autres, la légende sur la Géorgie n’est pas dénuée de poésie, elle s’écarte, comme toutes les légendes, de la réalité. Ou, pour parler plus exactement, elle n’est, d’un bout à l’autre, qu’un mensonge, produit non pas de l’imagination populaire, mais de la presse capitaliste qui l’a fabriqué de toutes pièces. Le mensonge et seulement le mensonge : voilà la base de la furieuse campagne antisoviétique dans laquelle les leaders de la IIe Internationale jouent le rôle dominant. C’est ce qui, pas à pas, nous allons démontrer.
L’existence de la Géorgie fut révélée à M. Henderson par Mrs Snowden qui, elle-même, avait vu Jordania et Tsérételli à l’œuvre pendant son voyage d’études à Batoum et à Tiflis. Quant à nous, nous avons connu ces messieurs bien avant leur dictature sur la Géorgie démocratique indépendante — à laquelle ils n’avaient d’ailleurs jamais songé —, nous les avons connus comme politiciens russes à Petrograd et à Moscou. Tchkéidzé fut à la tête du soviet de Petrograd, puis du Comité Exécutif Central des Soviets à l’époque de Kérensky, alors que les socialistes-révolutionnaires et les mencheviks faisaient la loi dans les soviets. Tsérételli fut ministre du gouvernement de Kérensky ; il fut l’inspirateur de la politique de conciliation.[2] Avec Dan et d’autres, Tchkéidzé servit d’intermédiaire entre le soviet menchevique et le gouvernement de coalition. Guéguetchkori et Tchkenkéli remplirent des missions de confiance pour le gouvernement provisoire, Tchkenkéli reçut le poste de commissaire général pour la Transcaucasie.
La position adoptée par les mencheviks était en substance la suivante : la révolution devait conserver son caractère bourgeois et, par suite, continuer à être dirigée par la bourgeoisie ; la coalition des socialistes avec la bourgeoisie devait avoir pour but d’habituer les masses populaires à la domination de la bourgeoisie ; l’aspiration du prolétariat à la conquête du pouvoir était néfaste pour La révolution ; il fallait déclarer une guerre impitoyable aux bolcheviks. Comme idéologues de la république bourgeoise, Tsérételli et Tchkéidzé, de même que leurs adeptes, défendaient sans réserve l’unité et l’indivisibilité de la République dans les limites de l’ancien Empire tsariste. Les prétentions de la Finlande à l’élargissement de son autonomie, les revendications analogues de la démocratie nationale ukrainienne furent impitoyablement combattues par Tsérételli et Tchkéidzé. Au Congrès des soviets, Tchkenkéli repoussa avec acharnement les tendances séparatistes de quelques régions frontières, quoique, à cette époque, la Finlande même ne réclamât pas l’autonomie complète. Pour réprimer ces tendances autonomistes, Tsérételli et Tchkéidzé organisèrent une force armée spéciale. Ils l’eussent employée si l’histoire leur en eût laissé le temps.
Mais c’est à la lutte contre les bolcheviks qu’ils consacrèrent surtout leurs forces.
L’histoire ne connaît peut-être pas une seule campagne de fureur, de haine et de diffamation analogue à celle qui fut menée contre nous à l’époque de Kérensky. Dans tous leurs articles et rubriques, en prose et en vers, par la parole et par le dessin, les journaux de toutes les nuances et de toutes les tendances vilipendèrent, anathématisèrent, flétrirent les bolcheviks. Il n’y eut pas d’infamie que Ton ne nous attribuât à tous en général et à chacun en particulier. Lorsqu’il semblait que la campagne avait atteint son point culminant, un épisode quelconque, parfois infime, lui redonnait une nouvelle énergie, et elle continuait avec un redoublement de fureur. La bourgeoisie sentait planer sur elle un danger mortel. Sa terreur folle s’exprimait par une rage stupide. Comme toujours, les mencheviks reflétaient l’état d’esprit de la bourgeoisie. Au fort de cette campagne, M. Henderson rendit visite au Gouvernement Provisoire et constata avec soulagement que sir Buchanan représentait avec dignité et succès l’idéal de la démocratie britannique auprès de la démocratie de Kérensky-Tsérételli
La police et le contre-espionnage tsaristes, qui, par crainte des faux pas, étaient restés temporairement inactifs, ne cherchaient qu’à prouver leur dévouement aux nouveaux maîtres. Tous les partis de la société cultivée leur montrèrent ce qui devait être l’objet de leur sollicitude : les bolcheviks. Des fables stupides sur notre liaison avec l’état-major des Hohenzollern, fables auxquelles, en réalité, personne ne croyait, sauf peut-être des espions de bas étage et des marchandes moscovites, furent colportées, amplifiées, délayées, développées sur tous les tons. Mieux que personne les leaders des mencheviks savaient ce que valaient ces accusations. Mais Tsérételli et sa séquelle, pour des motifs politiques, jugeaient utile de les soutenir. Tsérételli donne le ton et, de tous les côtés, les contre-révolutionnaires de la bande noire lui font écho de leurs aboiements. On accuse formellement le parti communiste de trahir l’État, d’être au service du militarisme allemand. La racaille bourgeoise, dirigée par les officiers patriotes, pille nos typographies et nos magasins, Kérensky ferme nos journaux, des milliers de communistes sont arrêtés à Petrograd et sur tous les points du pays.
Les mencheviks et leurs alliés, les socialistes-révolutionnaires, avaient reçu le pouvoir des mains des soviets d’ouvriers et de soldats, mais ils sentirent bientôt que le terrain allait leur manquer. Ce qu’ils voulaient, c’était faire contrepoids aux soviets d’ouvriers et de soldats, en aidant les éléments petits bourgeois et bourgeois du pays à s’organiser politiquement au moyen des municipalités et des zemstvos démocratiques. Mais, comme les soviets évoluent trop rapidement à gauche, les mencheviks ne se contentent plus de travailler à consolider les classes bourgeoises ; ils s’efforcent d’affaiblir et de désorganiser les soviets. Les réélections sont intentionnellement ajournées, le deuxième congrès des soviets est ouvertement saboté. Tsérételli est l’inspirateur de cette politique à laquelle Tchkéidzé donne des formes organiques. Déjà, en août et en septembre 1917, on cherche dans l’organe central des soviets à prouver que les soviets ont fait leur temps, qu’ils « se décomposent ». Plus les masses ouvrières et paysannes deviennent révolutionnaires, pressantes dans leurs revendications, impatientes, plus la dépendance des mencheviks à l’égard des classes possédantes revêt un caractère brutal, déclaré. Les municipalités et les zemstvos bourgeois-démocratiques n’arrivent pas à sauver la situation : la vague révolutionnaire balaye cette faible digue. Le deuxième congrès pan-russe des soviets, que, sous notre pression, les mencheviks se décident cependant à convoquer, s’empare du pouvoir, avec l’appui de la garnison de Petrograd, presque sans combat, sans effusion de sang. Alors les mencheviks, coalisés avec les socialistes-révolutionnaires et les cadets, entreprennent une lutte acharnée et, où ils le peuvent, armée contre les soviets, c’est-à-dire contre les ouvriers et les paysans. Et ainsi sont jetées les bases des fronts futurs des gardes-blancs Durant les neuf premiers mois de la révolution, les mencheviks franchissent donc trois étapes : au printemps de l’année 1917, ils sont les maîtres incontestés des soviets ; en été, ils tentent d’occuper une position « neutre » entre les soviets et la bourgeoisie ; en automne, de concert avec la bourgeoisie, ils déclarent la guerre civile aux soviets. Cette succession d’étapes caractérise essentiellement le menchevisme et, comme nous le verrons plus loin, toute l’histoire de la Géorgie menchevique.
Avant même la révolution du 7 novembre, Tchkéidzé file au Caucase. La prudence avait toujours été la plus remarquable de ses qualités civiques. Bientôt il est élu président du seïm de coalition transcaucasien : ainsi, il remplit au Caucase, sur une plus petite échelle, le rôle qu’il avait joué en grand à Petrograd.
En union avec les socialistes-révolutionnaires et les cadets, les mencheviks deviennent les inspirateurs du Comité contre-révolutionnaire du Salut de la Patrie et de la Révolution. Ce comité entre immédiatement en liaison avec la cavalerie cosaque de Krasnov qui marchait alors sur Petrograd et fomente une tentative d’insurrection armée parmi les élèves des écoles militaires. Les leaders des mencheviks, auxquels Kautsky confère le monopole de l’organisation pacifique des démocraties, sont les initiateurs et les organisateurs réels de la guerre civile en Russie. Le Comité du Salut de la Patrie et de la Révolution qui fonctionne à Petrograd et dans lequel les mencheviks travaillent avec les organisations des gardes-blancs, est lié directement à tous les complots, insurrections et attentats ultérieurs contre-révolutionnaires : avec les Tchéco-Slovaques sur la Volga, avec le comité de l’Assemblée Constituante de Samara et avec Koltchak, avec le gouvernement de Tchaïkovsky et le général Miller au Nord, avec Dénikine et Wrangel au Sud, avec les états-majors des républiques bourgeoises des confins de la Russie, avec les clans d’émigrés à l’étranger et les agents secrets de l’Entente qui lui dispensent des fonds. Les leaders des mencheviks, et parmi eux les leaders géorgiens, trempent dans toutes ces machinations, non pas au nom de la défense de la Géorgie indépendante dont il n’est pas encore question, mais comme chefs de l’un des partis antisoviétiques ayant des points d’appui dans tout le pays. A la Constituante, le chef du bloc antisoviétique n’est autre que Tsérételli lui-même.
Avec toute la contre-révolution, les mencheviks reculaient du centre industriel à la périphérie retardataire. Ils s’arrêtèrent naturellement à la Transcaucasie comme à l’un de leurs derniers refuges. Si, à Samara, ils se retranchaient derrière le mot d’ordre de l’Assemblée Constituante, à Tiflis ils tentèrent, à un certain moment, de lever le drapeau de la république indépendante. Mais ils ne le firent pas du premier coup. Leur évolution du centralisme bourgeois au séparatisme petit-bourgeois, évolution déterminée non par les revendications nationales des masses géorgiennes, mais par la guerre civile qui sévissait dans toute la Russie, s’effectua en plusieurs étapes.
Trois jours après la révolution du 7 novembre, à Petrograd, Jordania déclara, à une séance du conseil municipal de Tiflis : « L'insurrection à Petrograd vit ses derniers jours. Dès le début d’ailleurs, elle était condamnée à l’insuccès. » L’on ne pouvait raisonnablement exiger que Jordania montrât à Tiflis plus de clairvoyance que les bons bourgeois de tous les points du monde. La seule différence, c’est que Tiflis est un des points de la révolution russe et que Jordania est l’un des principaux acteurs de la lutte qui devait, soi-disant, mettre fin à l’insurrection bolchevique. Pourtant, les « derniers jours » étaient depuis longtemps passés et la prédiction de Jordania ne se réalisait toujours pas. Dès novembre, il fallut créer à la hâte un commissariat transcaucasien autonome ; non pas un État, mais une place d’armes contre-révolutionnaire provisoire, d’où les mencheviks géorgiens espéraient fournir un concours décisif à la restauration de l’ordre « démocratique » dans toute la Russie. Cet espoir avait quelques raisons d’être : l’état économique arriéré du pays, la faiblesse extrême du prolétariat industriel, l’éloignement du centre de la Russie, la différence des conditions sociales, des coutumes et des religions des nations multiples, se méfiant l’une de l’autre et séparées par des antagonismes de race, enfin le voisinage du Don et du Kouban, toutes choses éminemment favorables à l’opposition à la révolution ouvrière et qui firent que, pour une longue période de temps, la Ciscaucasie et le Caucase devinrent une Vendée et une Gironde liées par la communauté de lutte contre les soviets.
A cette époque, les innombrables troupes tsaristes qui opéraient sur le front turc se trouvaient encore en Transcaucasie. La nouvelle de la proposition de paix faite par le gouvernement soviétique et de la réforme agraire émut non seulement les masses des soldats, mais aussi la population laborieuse de la Transcaucasie. C’est alors que commence pour les contre-révolutionnaires embusqués en Transcaucasie le temps des alarmes. Ils organisent immédiatement un bloc de l’« ordre » dans lequel entrent tous les partis sauf, bien entendu, celui des bolcheviks. Les mencheviks, qui y jouent le rôle dominant, contribuent de tout leur pouvoir à l’union des seigneurs terriens et des petits bourgeois géorgiens, des boutiquiers et des propriétaires de mines de naphte arméniens, des beks et des khans tartares. Les officiers réactionnaires russes se mettent entièrement à la disposition du bloc anti-bolchevique
A la fin du mois de décembre eut lieu le congrès des délégués du front transcaucasien, convoqué sous les auspices des mencheviks eux-mêmes. La majorité se trouva être pour la gauche. Les mencheviks alors, avec la droite du congrès, firent un coup d’État et créèrent sans les gauches, c’est-à-dire sans la majorité, un soviet des troupes transcaucasiennes. En accord avec ce conseil, le Commissariat Transcaucasien décide, en janvier 1918, de « reconnaître comme désirable l'envoi de troupes cosaques dans les localités où il se produit actuellement des désordres… ». Comme méthode l’usurpation, comme force armée les cosaques de Kornilov : tels sont les points de départ véritables de la démocratie transcaucasienne.
Le coup d’État menchevique en Transcaucasie n’est pas une exception. Lorsqu’il apparut que les bolcheviks, au deuxième congrès pan-russe des soviets (novembre 1917), formaient l’écrasante majorité, l’ancien Comité Exécutif (composé de mencheviks et de socialistes-révolutionnaires) qui avait convoqué le congrès se refusa à céder la place et à transmettre les affaires au Comité Exécutif élu par le congrès. Par bonheur, nous avions pour nous non seulement la majorité formelle du congrès, mais toute la garnison de la capitale. C’est ce qui empêcha les mencheviks de nous disperser et nous permit de leur donner une leçon pratique de démocratie soviétique…
Pourtant, même après le coup d’État des mencheviks, les troupes de Transcaucasie constituaient une menace permanente pour l’« ordre ». Se sentant soutenus par les soldats dont l’esprit était nettement révolutionnaire, les masses ouvrières et paysannes de la Transcaucasie manifestaient l’intention non équivoque de suivre l’exemple de leurs frères du Nord. Pour sauver la situation il fallait désarmer et émietter les troupes révolutionnaires.
Le plan de désarmement de l’armée fut élaboré en secret par le gouvernement de Transcaucasie et les généraux tsaristes. Au complot prirent part le général Prjévalsky, le colonel Chatilov, qui fut plus tard le compagnon d’armes de Wrangel, le futur ministre de l’Intérieur de Géorgie, Ramichvili, etc. En même temps que l’on prenait des mesures pour désarmer les unités révolutionnaires, l’on décidait de ne pas désarmer les régiments cosaques, soutiens de Kornilov et de Krasnov. La collaboration de la Gironde menchevique et de la Vendée cosaque revêt id un caractère militaire.
Sous prétexte de désarmement l’on fit dépouiller, et souvent même massacrer, par des détachements contre-révolutionnaires spéciaux, les soldats qui regagnaient leurs foyers. A plusieurs stations, de violents combats eurent lieu où l’on fit donner l’artillerie lourde et les trains blindés. Des milliers d’hommes périrent dans cette boucherie dont les mencheviks géorgiens étaient les organisateurs.
Kautsky représente les troupes transcaucasiennes favorables aux bolcheviks comme des bandes indisciplinées, pillardes, massacrant et dévastant tout sur leur passage. C’est ainsi que les représentait également, autrefois, toute la racaille contre-révolutionnaire. Le procédé est naturel, car ce qu’il faut à Kautsky c’est que les initiateurs du désarmement, les mencheviks géorgiens, nous apparaissent comme «des chevaliers au sens le plus noble du mot». Mais nous avons à notre disposition d’autres témoignages émanant des mencheviks eux-mêmes. Ces derniers, lorsque le désarmement prit des formes sanglantes et un caractère de banditisme déclaré, eurent peur eux-mêmes de leur œuvre. Le 14 janvier 1918, un menchevik en vue, Dioughéli, déclarait : « Sous prétexte de désarmer les soldats, on les pillait littéralement. Exténués, à bout de forces, ces malheureux qui avaient tant souffert et qui n'avaient qu’un désir : rentrer chez eux, se voyaient enlever jusqu'à leurs chaussures. Tout était mis à l’encan. Des bandes de brigands vendaient l'armement et l’équipement militaire. C’était quelque chose de révoltant. » (Slovo, n° 10.)
Quelques jours plus tard, Djoughéli qui avait lui-même participé au désarmement de la garnison de Tiflis (nous aurons encore l’occasion de parler de ce monsieur), accusait Ramichvili d’avoir embauché une des bandes les plus pillardes de la contre-révolution transcaucasienne pour opérer le désarmement des soldats. A ce sujet, ces deux messieurs eurent publiquement un « échange de vues » que nous nous devons de reproduire ici :
« N. Ramichvili. — Djoughéli est un calomniateur.
» Djoughéli — Noé Ramichvili est un menteur.
» N. Ramichvili (répétant). — Djoughéli est un calomniateur.
» Djoughéli. — Cessez d’employer des expressions injurieuses à mon égard,
»N. Ramichvili. — Je déclare que tout ce qu’a dit Djoughéli est une basse insinuation et que Djoughéli est un calomniateur.
» Djoughéli. — Et vous, vous êtes un lâche et une canaille, et j’agirai envers vous en conséquence. » {Slovo, n° 22.)
Comme on le voit, le désarmement n’était pas une œuvre aussi chevaleresque que veut bien le dire Kautsky, puisque deux hommes de même tendance qui ont participé activement à cette affaire s’efforcent, d’une façon aussi chevaleresque, de s’en rejeter mutuellement la responsabilité.
Mais l’on ne saurait s’empêcher de plaindre Kautsky : voilà ce qui c’est que l’excès de zèle et le manque de retenue ! Par son ton d’apologie emphatique, tout l’opuscule de Kautsky, soit dit en passant, rappelle extraordinairement les écrits de quelques antiques académiciens français sur la mission civilisatrice de la principauté de Monaco ou le rôle bienfaisant des Karageorgévitch. Mis au rancart dans leur patrie, des académiciens fossiles recevaient des décorations et des pensions du gouvernement reconnaissant de la bienheureuse Arcadie dont ils avaient révélé au monde l’existence. Kautsky, lui, autant que nous le sachions, n’a été incorporé que dans les membres honoraires de la garde populaire géorgienne. Cela prouve qu’il est plus désintéressé que les académiciens français. Mais s’il les égale par la profondeur de ses généralisations historiques, il leur est considérablement inférieur sous le rapport de l’élégance du style laudatif.
La paix de Brest-Litovsk est sortie de la décomposition de l’ancienne armée. Cette armée avait été cruellement éprouvée par une longue série de défaites. Le fait même de la Révolution de Mars avait porté un coup terrible à son organisation intérieure. Il fallait la refondre complètement, changer sa base sociale, lui donner de nouveaux buts et de nouveaux rapports internes. Mais l’écart entre la parole et l’action, la creuse phraséologie révolutionnaire, sans volonté déterminée de changement de Kérensky-Tsérételli, la tuaient définitivement. Le ministre de la guerre du gouvernement de Kérensky, le général Verkhovsky, ne cessait de répéter que l’armée était complètement incapable de continuer la guerre et qu’il fallait conclure la paix à tout prix. Pourtant, l’on continuait à espérer un miracle, et cet espoir et ces hésitations qui revêtaient la forme d’un patriotisme frénétique ne faisaient que montrer combien la situation était désespérée. C’est de là qu’est sorti Brest-Litovsk. Les mencheviks exigeaient de nous la continuation de la guerre avec l’Allemagne, espérant que nous nous casserions ainsi plus sûrement le cou. Sous le drapeau anti-germanique ils s’unirent avec toutes les forces de la réaction. Ils tentèrent d’utiliser contre nous les derniers restes de l’inertie militaire du peuple. Comme toujours, les leaders géorgiens étaient au premier rang.
La conclusion de la paix de Brest-Litovsk servit de prétexte pour la proclamation de l’indépendance de la Transcaucasie (22 avril 1918). A en juger par la rhétorique patriotarde antérieure, on eût pu croire que cette proclamation avait pour but la continuation de la guerre contre la Turquie et l’Allemagne. Au contraire, la séparation officielle de la Transcaucasie d’avec la Russie était motivée par le désir de créer une base juridique plus ferme pour l’intervention étrangère. Avec le concours de cette dernière, les mencheviks espéraient, non sans raison, maintenir en Transcaucasie le régime bourgeois-démocratique et porter ensuite un coup au Nord soviétique.
Non seulement les partis de la bourgeoisie et des grands propriétaires fonciers alliés aux mencheviks, mais aussi les chefs eux-mêmes du menchevisme géorgien parlaient ouvertement, dans leurs discours et dans leurs écrits, de la lutte contre le bolchevisme russe comme de la raison principale de la séparation de la Transcaucasie. Le 26 avril, Tsérételli disait au Seïm transcaucasien : « Lorsque le bolchevisme a surgi en Russie, lorsqu’il a levé la main pour attenter à la vie de l’État, nous avons lutté contre lui avec toutes les forces dont nous disposions… Nous avons combattu, en Russie, les assassins de l’État et les assassins de la nation et, AVEC LA MÊME ABNËGATION, NOUS COMBATTRONS ICI LES ASSASSINS DE LA NATION. » (Applaudissements prolongés.) Avec la même abnégation et… avec le même succès.
Ces paroles laissent-elles l’ombre d’un doute sur la nature de la tâche que les mencheviks assignaient à la Transcaucasie indépendante ? Cette tâche ne consistait pas dans la création entre la mer Noire et la Caspienne d’une république social-démocrate idéale, neutre, mais dans la lutte contre les assassins de l’État (bourgeois), contre les bolcheviks, pour la restauration de la « nation » bourgeoise et démocratique dans les anciennes formes étatiques. Tous le discours de Tsérételli, dont nous venons de citer un passage, n’est que la répétition des lieux communs pathétiques que nous avons tant de fois entendu développer par cet orateur à Petrograd. Cette séance « historique » du Seïm transcaucasien était présidée par ce même Tchkéidzé qui, président en quelque sorte inamovible, avait naguère maintes fois fermé la bouche aux bolcheviks à Petrograd. Seulement, ce que ces messieurs avaient fait autrefois à Petrograd en grand, ils le faisaient maintenant en petit au Caucase. Avec la même abnégation et avec le même succès.
En fait, la non-reconnaissance de Brest-Litovsk mit du coup la Transcaucasie en tant qu’« État », dans une situation sans issue,’car elle donna toute liberté d’action aux Turcs et à leurs alliés. A peine quelques semaines s’étaient-elles écoulées que le gouvernement transcaucasien et le Seïm imploraient la Turquie de se conformer au traité de Brest-Litovsk. Mais les Turcs ne voulaient rien entendre. Les pachas et les généraux allemands devinrent les maîtres incontestés de la situation en Transcaucasie. Néanmoins, le but principal était atteint : au moyen des troupes étrangères, la révolution était temporairement écrasée, la chute du régime bourgeois ajournée.
Lorsque, sans consulter aucunement la population, ils proclamèrent l’indépendance de la Transcaucasie ( 22 avril 1918), les mencheviks géorgiens, il va de soi, annoncèrent aux nationalités hétérogènes du Caucase l’avènement d’une nouvelle ère de fraternité sur les bases de la démocratie. Mais, à peine surgie, la nouvelle république se désagrégeait déjà. L’Azerbaïdjan cherchait son salut dans la Turquie, l’Arménie plus que tout craignait les Turcs, la Géorgie se réfugiait sous la protection de l’Allemagne. Cinq semaines après sa proclamation solennelle, la république transcaucasienne était liquidée. De même que sa naissance, ses funérailles furent célébrées par de pompeuses déclarations démocratiques. Mais cela ne changeait rien au fond de l’affaire : la démocratie petite-bourgeoise avait montré son impuissance complète à éviter les collisions nationales et à accorder les intérêts nationaux. Le 26 mai 1918, de nouveau sans consultation aucune de la population, la Géorgie, fragment du Caucase, est érigée en État indépendant. Ce sont de nouveau des torrents d’éloquence démocratique. Cinq mois seulement se passent et, pour une parcelle de territoire, une guerre éclate entre la Géorgie démocratique et l’Arménie non moins démocratique. De part et d’autre ce sont de grands discours sur les intérêts supérieurs de la civilisation et la perfidie de l’agresseur. Kautsky ne souffle mot de la guerre « démocratique » arméno-géorgienne. Sous la direction de Jordania, de Tsérételli et de leurs sosies arméniens et tartares, la Transcaucasie se transforme immédiatement en une péninsule des Balkans où les sanglantes rivalités nationales s’allient au plus pur charlatanisme démocratique. A travers tous ses errements et ses chutes sanglantes, le menchevisme géorgien n’en poursuit pas moins la réalisation de son idée première : la lutte implacable contre l’« anarchie » bolchevique.
L’indépendance de la Géorgie donne aux mencheviks la possibilité — ou plutôt les met dans la nécessité — de prendre ouvertement position dans la lutte de la République soviétique contre l’impérialisme. La déclaration de Jordania sur ce point est on ne peut plus claire.
« Le gouvernement géorgien porte à la connaissance de la population — est-il dit dans la communication gouvernementale du 13 juin 1918 — que les troupes allemandes arrivées à Tiflis ont été appelées par le gouvernement géorgien lui-même et ont pour tâche de défendre, en plein accord avec le gouvernement et selon ses indications, les frontières de la république démocratique géorgienne. Une partie de ces troupes a déjà été envoyée dans l’arrondissement de Bortchalino pour le purger des bandes de brigands qui l’infestent. » (En réalité, pour mener une guerre non officielle contre l’Azerbeïdjan démocratique, et cela pour une parcelle de territoire en litige.)
D’après Kautsky, les troupes allemandes avaient été appelées exclusivement pour combattre les Turcs et, sauf dans le domaine militaire, la Géorgie conservait une indépendance complète. Que nos bons démocrates aient invité le général von Kress en qualité de simple sentinelle chargée de veiller sur la démocratie géorgienne, la chose est difficilement admissible ; toujours est-il que ce général était bien peu préparé pour ce rôle. Mais il ne faudrait pas s’exagérer la naïveté de nos démocrates. A cette époque, le rôle joué par les troupes allemandes, durant l’année 1918, dans les États frontières russes, ne pouvait faire de doute. En Finlande, les Allemands avaient été les bourreaux de la révolution ouvrière. Dans les provinces baltiques, il en avait été de même. Ils avaient traversé toute l’Ukraine, dispersant les soviets, massacrant les communistes, écrasant les ouvriers et les paysans. Jordania n’avait aucune raison de s’attendre à ce qu’ils vinssent en Géorgie avec d’autres intentions. Aussi est-ce en parfaite connaissance de cause que le gouvernement menchevique fit appel aux troupes victorieuses des Hohenzollern. Ces troupes avaient, sur les Turcs, l’avantage de la discipline. « Il resterait encore à savoir quel est pour nous le pire danger, le danger bolchevique ou le danger turc », déclarait, le 28 avril 1918, le rapporteur officiel du Seïm transcaucasien, le menchevik Inirchvili. Que le danger bolchevique fût bien pire que le danger allemand, les mencheviks n’en doutaient nullement. Ils ne le cachaient pas dans leurs discours et le démontrèrent dans la pratique. Ministres du gouvernement pan-russe, les mencheviks géorgiens nous avaient accusés d’être les alliés de l’état-major allemand et livrés aux juges tsaristes pour crime de haute trahison. Ils avaient qualifié de trahison à la Russie la paix de Brest-Litovsk qui avait ouvert « les portes de la révolution » à l’impérialisme allemand. C’est avec ce mot d’ordre qu’ils avaient mené campagne pour le renversement des bolcheviks. Or, lorsqu’ils sentirent le sol de la révolution s’échauffer sous leurs pieds, ils séparèrent la Transcaucasie de la Russie, puis la Géorgie de la Transcaucasie et ouvrirent toutes grandes les portes de la démocratie aux troupes du kaiser qu’ils accueillirent avec force révérences et flatteries. Après la défaite de l’Allemagne, ils agirent, comme nous le verrons, exactement de même envers l’Entente victorieuse. Sous ce rapport, comme sous les autres, la politique des mencheviks n’est que le reflet de la politique de la bourgeoisie russe : représentée par les cadets (Milioukov), cette dernière était entrée en Ukraine avec le consentement des troupes d’occupation allemandes et, après la défaite de l’Allemagne, avait immédiatement dépêché à l’Entente ces mêmes cadets, enfants prodigues, qui, dans tous leurs errements, n’avaient pourtant jamais perdu de vue le but fondamental : la lutte contre les bolcheviks. C’est pourquoi l’Entente leur ouvrit si facilement son cœur et, ce qui importe davantage, sa bourse. C’est pourquoi le ministre de la guerre, Henderson, qui avait fraternisé à Petrograd avec le ministre de la guerre, Tsérételli, accueillit comme un frère ce dernier que le général allemand von Kress venait de serrer sur son cœur. Volte-face, contradictions, trahisons, mais toujours contre la révolution du prolétariat.
Le 25 septembre 1918, dans une lettre à von Kress, Jordania disait à ce dernier : « Il n’est pas dans notre intérêt d’amoindrir le prestige de l’Allemagne au Caucase. » Or, deux mois plus tard, il fallait déjà ouvrir toutes grandes les portes aux troupes britanniques. Cet acte fut précédé des pourparlers dont le but principal était de prouver, d’expliquer, de persuader que la démocratie géorgienne s’était vu imposer un demi-mariage de raison avec le général allemand von Kress, mais que le véritable mariage auquel elle aspirait de toute la force de son sentiment était celui qui devait la lier au général anglais Walker. Le 15 décembre, d’après son propre témoignage, le vieux menchevik Topouridzé, représentant du gouvernement à Batoum, répondant aux questions de la mission de l’Entente, disait : « ]’estime que, par tous les moyens et de toutes les forces dont elle dispose, notre république aidera les puissances de l’Entente dans leur lutte contre les bolcheviks… » Le même Topouridzé déclare, à l’agent anglais Webster, que la Géorgie « considérera qu’elle fait son devoir si, au Caucase, elle prête son concours à l'Angleterre dans la lutte contre le bolchevisme… ». Lorsque le colonel anglais Jordan eut expliqué que les troupes alliées entraient en Géorgie « conformément au plan général de paix et d’ordre international », c’est-à-dire pour étouffer le bolchevisme et soumettre tous les peuples de la Russie à l’amiral Koltchak, Guéguetchkori l’informa que « le Gouvernement géorgien, animé du désir de travailler en accord avec les alliés à la réalisation des principes du droit et de la justice proclamés par ces derniers, donne son consentement à l’entrée des troupes ». En un mot, en passant de la nationalité allemande à celle de l’Entente, les chefs du menchevisme géorgien ne tinrent aucun compte du bon vieux conseil du poète russe :
« Flatteurs, flatteurs, dans votre bassesse sachez au moins conserver une ombre de noblesse ! »
Je ne me rappelle que trop bien la salle des séances de Brest-Litovsk. J’ai encore sous les yeux les personnages assis autour de la table : le baron Kühlmann, le général Hoffmann, le comte Czernin. Mais je me souviens encore plus nettement des représentants de la petite-bourgeoisie ukrainienne qui, eux aussi, s’intitulaient socialistes et qui étaient — par leur niveau politique — les sosies des mencheviks géorgiens. Au cours même des pourparlers ils firent bloc, en catimini, avec les représentants féodaux de l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie. Il fallait les voir s’empresser, faire le gros dos devant leurs nouveaux maîtres, chercher à lire dans leurs yeux leurs moindres désirs ; il fallait voir le dédain triomphant avec lequel ils nous regardaient, nous, les représentants isolés du prolétariat à ces séances de Brest-Litovsk !
« Je connais les volte-face de ces fripons, leurs flagorneries, leurs façons de semer la discorde et de jeter de l'huile sur le feu, leurs complaisances serviles ; je sais comment, pareils à des chiens, ils courent après les maîtres »[3]. Ces dernières années ont été fertiles en épreuves. Mais je ne sais pas de minutes plus pénibles, plus douloureuses que celles qu’il nous a fallu traverser, le rouge de la honte au front, à cause de l’ignominie, de la platitude, de la bassesse de la démocratie petite-bourgeoise qui, dans sa lutte contre le prolétariat, se jette aux genoux des représentants du monde féodal et capitaliste. Et n’est-ce pas là exactement ce qu’a fait à deux reprises le menchevisme géorgien ?
[1] Georgien. Eine Sozialdemokratische Bauernrepublik (Vienne, 1921).
« Je n’ai vu — raconte lui-même Kautsky — que ce que l'on peut voir de la portière d’un compartiment de chemin de fer ou à Tiflis. D’autant plus que j’ignore les langues géorgienne et russe. » Plus loin, il déclare : « Les communistes m’évitaient. » Il faudrait encore ajouter que les hospitaliers mencheviks trompaient à chaque pas leur honorable visiteur, qui d’ailleurs se prêtait volontiers lui-même à cette duperie. Le fruit d’une enquête menée dans des conditions si favorables fut l’opuscule en question, qui couronne dignement la campagne internationale contre la Russie.
[2] Kautsky confond les événements et altère la vérité même quand cela ne lui est pas nécessaire pour atteindre son but : ainsi il raconte que Tchkéidzé et Tsérételli avaient été à la tête du soviet de Petrograd, en 1905. En réalité, personne à cette époque n’avait entendu parler d’eux à Petrograd.
[3] Shakespeare : Le roi Lear.