1922 |
Entre l'impérialisme et la révolution
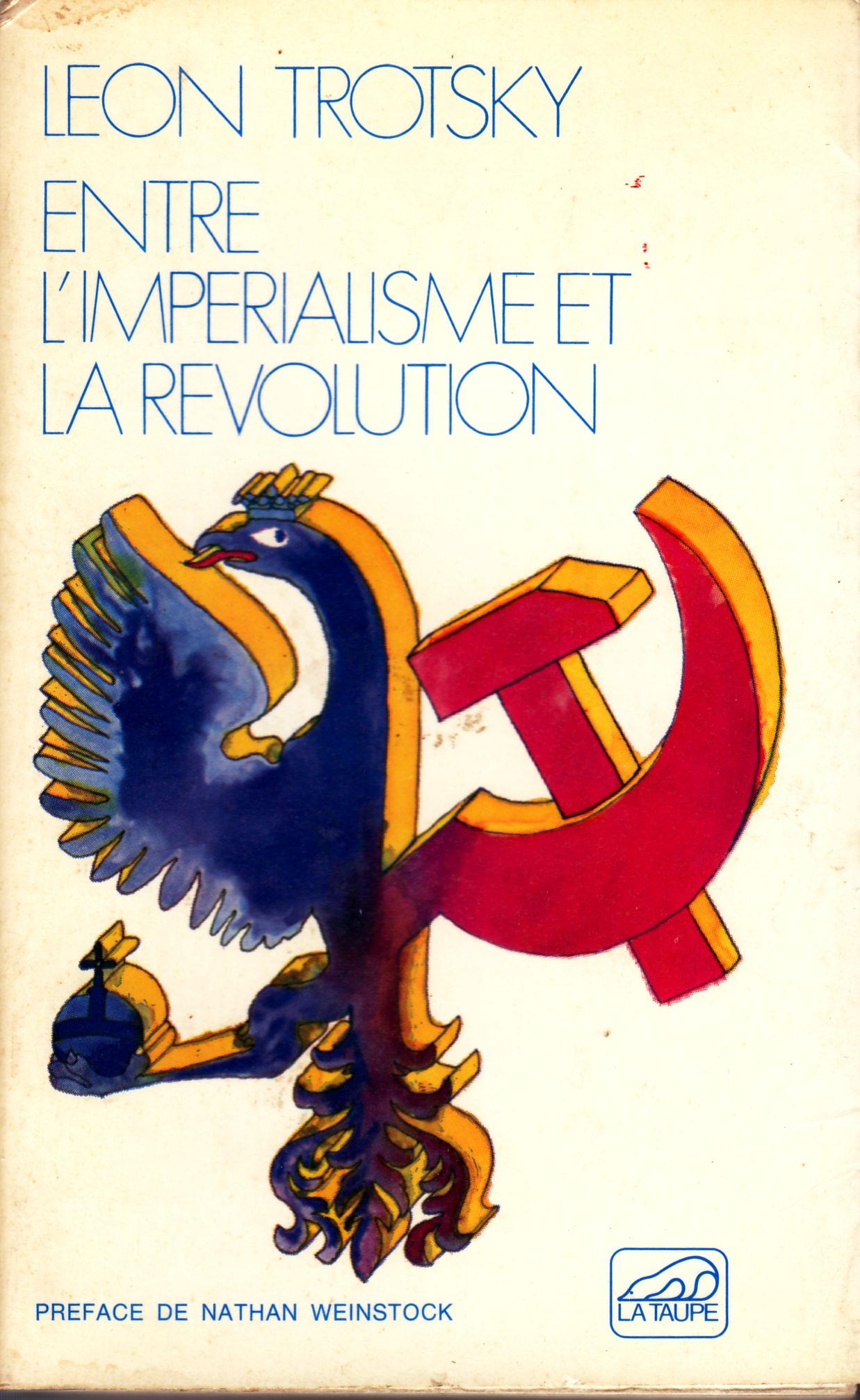
chapitre VIII.
Maintenant que nous en avons fini avec le récit des événements, qu’il nous soit permis de nous arrêter à quelques considérations générales.
L’histoire de la Transcaucasie durant les cinq dernières années est un cours extrêmement instructif de démocratie en période révolutionnaire. Aux élections à l’Assemblée Constituante pan-russe, aucun des partis caucasiens n’avait inscrit dans son programme la séparation d’avec la Russie. Quatre ou cinq mois plus tard, en avril 1918, le Seïm transcaucasien composé des députés de cette même Assemblée Constituante décrétait la séparation de la Géorgie d’avec la Russie et sa constitution en État indépendant. Et ainsi, sur cette question fondamentale de la vie étatique : avec la Russie soviétique ou sans elle et contre elle, personne ne consulta la population de la Transcaucasie ; il ne fut question ni de référendum, ni de plébiscite, ni de nouvelles élections. La séparation de la Transcaucasie d’avec la Russie fut décrétée par les mêmes députés qui avaient été élus pour représenter la Transcaucasie à Saint-Pétersbourg sur la base des plates-formes démocratiques amorphes de la première période de la révolution.
La République Transcaucasienne fut proclamée tout l’abord comme fédération de toutes les nationalités du Caucase. Mais la situation créée par la séparation d’avec la Russie et la recherche de nouvelles orientations internationales amena le fractionnement de la Transcaucasie en trois parties distinctes : l’Azerbeïdjan, l’Arménie et la Géorgie. Le 26 mai 1918 déjà, c'est-à-dire cinq semaines après la séparation, le Seïm — formé de députés de l’Assemblée Constituante pan-russe — qui avait créé la République Transcaucasienne, proclamait sa liquidation. Comme auparavant, l’on ne demanda point leur avis aux masses populaires ; il n’y eut ni élections ni aucune autre forme de consultation. Et ainsi, tout d’abord, sans s’occuper du désir de la population, on l’avait séparée de la Russie pour réaliser, comme l’expliquaient les dirigeants du Seïm, une union plus étroite des Tartares, des Arméniens, des Géorgiens. Ensuite, à la première secousse extérieure, Tartares, Arméniens et Géorgiens avaient été, sans qu’on les consultât, scindés en trois États distincts.
Le même jour, la fraction géorgienne du Seïm proclamait la Géorgie république indépendante. Les ouvriers et les paysans géorgiens ne furent point consultés : on les mit en présence du fait accompli.
Durant les dix mois qui suivirent, les mencheviks consolidèrent le « fait accompli » : ils pourchassèrent les communistes qu’ils réduisirent à l’action clandestine, entrèrent en relations avec les Turcs et les Allemands, conclurent des traités de paix, remplacèrent les Allemands par les Anglais et les Américains, accomplirent leurs réformes fondamentales, surtout créèrent leur force armée prétorienne, la Garde Populaire, et, après tout cela seulement, se décidèrent à convoquer l’Assemblée Constituante (mai 1919), mettant ainsi les masses dans la nécessité d’élire des représentants au Parlement de la république géorgienne indépendante, dont elles n’avaient jamais entendu parler et à laquelle elles n’avaient jamais pensé.
Que signifie tout cela ? Si Macdonald, par exemple, comprenait tant soit peu l’histoire, c’est-à-dire s’il était capable de voir dans l’histoire le mouvement des forces et des intérêts vitaux et de distinguer leur aspect véritable du masque qui les recouvre, leurs causes réelles des contingences, il arriverait tout d’abord à la conclusion que les politiciens mencheviks, ces démocrates par excellence, s’efforçaient de réaliser, et réalisaient en fait, les mesures les plus importantes, contrairement aux méthodes de la démocratie politique. Ils utilisèrent, il est vrai, la fraction transcaucasienne de l’Assemblée Constituante pan-russe, mais ils l’employèrent à des buts diamétralement opposés à ceux pour lesquels elle avait été élue. Puis il soutinrent artificiellement ce résidu de la révolution de la veille pour faire opposition au lendemain de cette révolution. Ils ne convoquèrent l’Assemblée Constituante géorgienne qu’après avoir mis la Géorgie dans une situation à laquelle il n’y avait pour la population d’autre issue que celle qu’ils lui avaient imposée : la Transcaucasie était séparée de la Russie, la Géorgie de la Transcaucasie ; les Anglais occupaient Batoum ; les blancs, amis rien moins que sûrs, étaient aux frontières de la république ; les bolcheviks géorgiens étaient mis hors la loi, le parti menchevik restait le seul intermédiaire possible entre la Géorgie et l’Entente dont dépendaient les arrivages de blé. Dans ces conditions, les élections « démocratiques » ne pouvaient avoir pour résultat que le sanctionnement de cette série d’actes accomplis au moyen de la contrainte contre-révolutionnaire par les mencheviks eux-mêmes et par leurs complices et protecteurs étrangers.
Que l’on compare à cela le coup d’État du 7 novembre préparé par nous au grand jour en rassemblant les masses autour du programme : « Tout le pouvoir aux soviets », en construisant les soviets, en luttant pour les soviets, en y conquérant la majorité contre les mencheviks et les socialistes-révolutionnaires dans une lutte sans merci, et que l’on nous dise où est la véritable démocratie révolutionnaire !
Il nous faut maintenant revenir à quelques questions relatives au mécanisme de la révolution tel que nous le connaissons par l’expérience des temps modernes.
Jusqu’à l’heure actuelle, la révolution n’était possible qu’au cas où les intérêts de la majorité du peuple, par suite, de classes différentes, étaient en contradiction avec le système existant de la propriété et du régime étatique. C’est pourquoi la révolution débutait par les revendications « populaires » élémentaires, dans lesquelles l’intérêt de la classe des possédants, l’ineptie de la petite bourgeoisie, l’état politique arriéré du prolétariat trouvaient leur expression. Ce n’est qu’au cours de la réalisation effective de ce programme que des antagonismes d’intérêts se révèlent dans le camp même de la révolution. Les éléments possédants, conservateurs sont rejetés progressivement ou d’un seul coup dans le camp de la contre-révolution. Les unes après les autres les différentes couches des masses opprimées se lèvent pour la lutte. Leurs revendications se font plus catégoriques, leurs méthodes de lutte plus implacables. La révolution atteint son point culminant. Pour qu’elle continue son ascension, il lui manque soit des bases matérielles (dans les conditions de la production), soit une force politique consciente (le parti). Alors la courbe commence à s’abaisser pour une courte durée de temps ou pour une longue période historique. Le parti extrême de la révolution ou bien est éliminé du pouvoir, ou bien restreint son programme d’action, en attendant qu’il se produise un changement en sa faveur dans le rapport des forces. Nous ne donnons ici que la formule algébrique de la révolution sans ses significations exactes de classe, mais cela nous suffit pour le moment, car il s’agit du rapport entre les forces vives, qui s’accroissent dans la lutte, et les forces de la démocratie.
Les institutions parlementaires héritées du passé (États Généraux en France, Douma d’Empire en Russie) peuvent, à un certain moment, donner une impulsion à la révolution, mais bientôt elles la contrecarrent.
La représentation élue à la première période de la révolution reflète inévitablement l’amorphisme politique, la naïveté, la bonhomie, l’indécision de cette dernière. Aussi devient-elle rapidement un frein pour le développement révolutionnaire : s’il n’existe pas une force révolutionnaire capable de franchir cet obstacle, la révolution piétine sur place, puis fait machine en arrière. La contre-révolution balaye la Constituante. Ainsi en fut-il pendant !a Révolution de 1848 : le général Wrangel liquida l’Assemblée Constituante prussienne qui n’avait pas su le liquider et qui n’avait pas été liquidée elle-même au moment nécessaire par le parti révolutionnaire. Nous avons eu aussi, on le sait, notre général Wrangel, qui avait hérité des penchants de son aïeul. Mais nous l’avons liquidé. Si nous y avons réussi, c’est parce que nous avions liquidé préalablement l’Assemblée Constituante. La Constituante de Samara, elle, a refait l’expérience prussienne et elle a trouvé son fossoyeur en Koltchak.
La Révolution française n’a pu opérer pendant un certain temps au moyen d’institutions représentatives encombrantes, toujours en retard sur les événements, que parce que l’Allemagne, à cette époque, était réduite à rien et qu’il était difficile à l’Angleterre, alors comme maintenant, de s’engager sur le continent. Ainsi la Révolution française — et c’est ce qui la distingue de la nôtre — a eu à ses débuts une longue « halte » extérieure qui lui a permis, jusqu’à un certain point, d’ajuster et d’adapter, sans se presser, les représentations démocratiques successives aux besoins de la révolution. Quand la situation devint menaçante, le parti révolutionnaire dirigeant n’orienta pas sa politique dans le sens de la démocratie formelle, mais, avec le couperet de la guillotine, tailla à la hâte la démocratie à la mesure des besoins de sa politique : les Jacobins exterminèrent les membres de la droite de la Convention et intimidèrent les centristes du Marais. La révolution ne suivit pas le lit du fleuve démocratique ; elle marcha par les défilés et les ravins de la dictature terroriste. L’histoire, en somme, ne connaît pas de révolution qui se soit terminée par la voie démocratique. Car la révolution est un litige grave, qu’on ne résoud jamais suivant la forme, mais selon le fond. Il arrive assez souvent que les gens perdent leur fortune et même ce que l’on appelle l’honneur à un jeu purement conventionnel comme le jeu de cartes ; mais les classes ne consentent jamais à perdre leur avoir, leur pouvoir et leur honneur au jeu conventionnel du parlementarisme démocratique. Elles résolvent toujours la question sérieusement, c’est-à-dire conformément au rapport véritable des forces matérielles et non pas suivant leur représentation plus ou moins fictive.
On ne saurait douter que, même dans les pays où le prolétariat, comme en Angleterre, forme la majorité absolue de la population, une institution représentative qui serait créée par la révolution ouvrière ne refléterait, en même temps que les premières revendications de la révolution, les traditions monstrueusement conservatrices de ce pays. La personne d’un leader trade-unioniste anglais d’aujourd’hui est un amalgame de préjugés religieux et sociaux remontant à une époque extrêmement reculée, contemporaine, pour le moins, de la restauration de la cathédrale de Saint-Paul ; d’habitudes pratiques de fonctionnaire d’organisation ouvrière vivant à une époque de maturité politique ; de raideur de petit bourgeois visant à la respectabilité ; de conscience frelatée de politicien ouvrier familiarisé avec toutes les trahisons. Ajoutez à cela les influences intellectuelles, doctrinales, « fabiennes » diverses : morale socialiste des prédicateurs de dimanche, systèmes rationalistes des pacifistes, dilettantisme des socialistes amateurs, étroitesse obstinée et hautaine du « fabianisme ». Si les conditions sociales actuelles en Angleterre sont extrêmement révolutionnaires, le long passé historique de ce pays a marqué d’une empreinte conservatrice puissante la conscience de la bureaucratie ouvrière et même de la couche supérieure des ouvriers les plus qualifiés. En Russie, les obstacles à la révolution socialiste sont objectifs : ils consistent dans le morcellement de la propriété paysanne et dans l’état arriéré de .a technique ; en Angleterre ils sont subjectifs : ils consistent dans le croupissement idéologique de tous les Henderson et Mrs. Snowden du Royaume-Uni. La révolution ouvrière aura raison de ces obstacles par des méthodes d'épuration qu’elle appliquera sur elle-même. Mais il n’y a aucun espoir qu’elle puisse en avoir raison par la voie de la démocratie. M. Macdonald l’en empêchera, non pas par son programme, mais par le fait même de son conservatisme personnel.
Étant donné l’instabilité des rapports sociaux à l’intérieur et les changements brusques et toujours dangereux à l’extérieur, il n’est pas douteux que, si la révolution russe s’était mise aux pieds les entraves du démocratisme bourgeois, elle serait depuis longtemps déjà étendue sur la grand-route, la gorge tranchée. Kautsky, il est vrai, déclare dans ses écrits que l’écroulement de la République soviétique ne serait pas un coup sensible pour la révolution internationale. C’est là une autre question. Nous sommes persuadés que l’effondrement de la République du prolétariat russe serait un soulagement considérable pour beaucoup de gens, qui expliqueraient immédiatement qu’ils avaient, dès le début, prévu la chose. Kautsky écrirait sa mille et unième brochure, dans laquelle il expliquerait pourquoi le pouvoir des ouvriers russes succombé, mais oublierait d’expliquer pourquoi lui-même est condamné à n’être qu’une nullité. Quant à nous, nous considérons que le fait que la République soviétique a tenu bon pendant les années les plus pénibles est la meilleure preuve de la vitalité du système soviétique. Ce système, évidemment, ne renferme en soi aucune vertu mirifique. Mais il s’est révélé assez souple pour conserver au Parti communiste, qu’il a lié étroitement aux masses, la liberté de manœuvre nécessaire pour ne pas paralyser son initiative, pour le préserver des dangers du jeu parlementaire, qui est chose de deuxième et de troisième ordre par rapport aux tâches fondamentales de la révolution. Quant au danger contraire, qui consisterait à ne pas remarquer les changements survenus dans l’état des esprits et les modifications dans la corrélation des forces, il faut reconnaître que, durant la dernière année, le soviétisme a montré, sous ce rapport, une vitalité supérieure. Les mencheviks du monde entier se sont mis à parler du thermidor de la révolution russe. Mais ce n’est pas eux, c’est nous-mêmes qui avons établi ce diagnostic. Et, ce qui est encore plus important, c’est que le parti communiste a fait aux aspirations « thermidoriennes », aux tendances de la petite bourgeoise, les concessions nécessaires pour la conservation du pouvoir au prolétariat sans briser le système et sans lâcher le gouvernail de direction. Un professeur russe, qui aime à réfléchir et auquel la révolution a été d’un certain profit, a qualifié, assez spirituellement d’ailleurs, notre nouvelle politique économique de « descente faite en serrant les freins ». Très probablement, notre professeur — et il n’est pas le seul — se représente cette descente, dont nous n’avons d’ailleurs nullement l’intention d’amoindrir l’importance, comme quelque chose de définitif et de décisif. Il devra bientôt se convaincre que, malgré l’importance de certains de ses écarts, notre politique se redresse toujours et conserve sa direction fondamentale. Pour s’en convaincre, il faut la juger non pas d’après un fait isolé, sensationnel, mais suivant son sens général et les nécessités de toute une époque. En tout cas, la « descente faite en serrant les freins » a pour le prolétariat au pouvoir les mêmes avantages qu’ont, pour le régime bourgeois, les réformes accomplies en temps utile, lesquelles diminuent la pression révolutionnaire. Voilà qui doit être facile à comprendre pour Henderson, dont le parti tout entier n’est qu’un frein de sûreté à l’usage de la société bourgeoise.
Que penser maintenant de la « dégénérescence » du système soviétique, dont, depuis longtemps déjà, les mencheviks de tous les pays parlent tant dans leurs discours et dans leurs écrits ? Ce qu’ils appellent « dégénérescence » est en rapport étroit avec ce qui a été nommé plus haut la « descente faite en serrant les freins ». La révolution internationale traverse en ce moment une période de cristallisation, de rassemblement de ses forces ; extérieurement c’est une sorte de piétinement sur place et même de recul. C’est ce qu’exprime en partie notre nouvelle politique économique. Il est naturel que cette période pénible, où le mouvement international subit un temps d’arrêt, se répercute sur la situation et sur l’état d’esprit des masses laborieuses de Russie et, partant, sur le travail du système soviétique. Notre appareil administratif et économique a fait, durant cette période, de grands progrès. Mais, évidemment, la vie des soviets, en tant qu’organes de représentation des masses, n’a pu conserver cette tension qui était sa caractéristique dans la période des premières victoires intérieures ou aux moments où le danger extérieur était menaçant. Les luttes stériles des partis parlementaires, leurs combinaisons et leurs intrigues peuvent revêtir et revêtent fréquemment un caractère « dramatique » extraordinaire, au moment où les masses traversent une période de grande dépression morale. Le système soviétique ne jouit pas d’une telle indépendance. Il reflète beaucoup plus directement les masses et leur état d’esprit. Il est monstrueux de lui reprocher comme une infériorité ce qui est sa supériorité essentielle. Seul le développement de la révolution en Europe redonnera une impulsion plus puissante au système soviétique. Mais peut-être pourait-on « remonter le moral » des travailleurs grâce à une opposition menchevique et aux autres systèmes du parlementarisme ? Les pays à démocratie parlementaire ne manquent pas. Eh bien ! où sont les résultats ? Il faudrait être le plus « bouché » des professeurs de droit constitutionnel, ou le plus impudent des renégats du socialisme pour nier que les masses ouvrières de Russie, maintenant, au moment de la soi-disant décadence du système soviétique, participent à la direction de toutes les branches de la vie sociale, d’une façon infiniment plus active, plus directe, plus constante, plus décisive que dans n’importe quelle république parlementaire.
Dans les pays où le parlementarisme est déjà de date ancienne, il s’est formé toute une série de mécanismes de transmission complexes et variés, au moyen desquels la volonté du Capital trouve son expression par l’intermédiaire d’un Parlement issu du suffrage universel. Dans les pays jeunes et à civilisation peu avancée, la démocratie basée sur la classe paysanne revêt un caractère beaucoup plus sincère et, par là même, très instructif. De même que l’on commence l’étude des organismes animaux par les amibes, de même il faudrait commencer l’étude des mystères du parlementarisme anglais par l’étude de la pratique des constitutions balkaniques. Les partis dirigeants qui ont été au pouvoir en Bulgarie depuis la reconnaissance de l’indépendance de ce pays ont mené entre eux une lutte implacable, quoique leurs programmes fussent sensiblement les mêmes. Chaque parti appelé au pouvoir par le souverain — que ce parti fût russophile ou germanophile — commençait par dissoudre l’Assemblée populaire et procédait à de nouvelles élections qui lui donnaient invariablement une majorité écrasante et ne laissaient à chacun des autres partis rivaux que deux ou trois sièges au Parlement. Deux ou trois ans plus tard, un de ces partis réduits à rien par les élections démocratiques, était appelé à son tour au pouvoir par le souverain, prononçait la dissolution de l’Assemblée populaire et obtenait l’immense majorité des mandats aux nouvelles élections. La classe paysanne bulgare, qui, par son niveau intellectuel et son expérience politique, n’est nullement inférieure à la classe paysanne géorgienne, manifestait invariablement sa volonté politique en votant pour le parti au pouvoir. Pendant la révolution, les paysans ne soutiennent un parti que lorsque le cours des événements leur montre que ce parti peut prendre ou bien a déjà pris le pouvoir. C’est pourquoi ils marchent avec les socialistes-révolutionnaires après la révolution de mars 1917 et avec les bolcheviks après novembre. La domination démocratique des mencheviks en Géorgie avait, au fond, ce caractère « balkanique », mais avec cette seule différence que l’époque était révolutionnaire ; elle s’appuyait sur les paysans dont l’impuissance de fonder, en régime bourgeois, un parti autonome, capable de diriger l’État, est attestée par l’histoire. Ce sont les villes qui, dans les temps modernes, ont toujours fourni un programme et une direction politique. Les révolutions ont invariablement revêtu un caractère d’autant plus décisif que les masses populaires liaient dans une plus large mesure leur sort à celui du parti extrême gauche des villes. Il en fut ainsi à Munster, à la fin de la Réforme. Il en fut ainsi pendant la grande Révolution française, durant laquelle le club des Jacobins réussit à s’appuyer sur la campagne. Si la révolution de 1848 se cassa le cou à ses premiers pas, c’est précisément parce que son aile gauche, très faible, ne sut pas trouver d’appui dans les campagnes et que la classe paysanne, représentée par l’armée, resta le soutien de l’ordre. La révolution russe actuelle n’a pris une telle envergure que parce que les ouvriers ont su faire la conquête politique des paysans en leur montrant qu’ils étaient capables de créer un pouvoir.
En Géorgie, la faiblesse numérique et l’état arriéré du prolétariat, isolé en outre des centres de la révolution, permirent au bloc politique des intellectuels petits-bourgeois et des groupes ouvriers les plus conservateurs de se maintenir beaucoup plus longtemps au pouvoir. Par les émeutes et les insurrections, la classe paysanne géorgienne tenta d’imposer au pouvoir ses revendications fondamentales, mais, comme toujours, se révéla incapable de créer un pouvoir. Ses insurrections isolées furent réprimées. Parallèlement à la répression, la duperie parlementaire faisait son œuvre.
La stabilité relative du régime menchevique était due à l’impuissance politique des masses paysannes éparses, impuissance que les mencheviks entretinrent artificiellement.
Ils y réussirent d’autant plus facilement qu’ils résolurent la question du pouvoir effectif contrairement aux principes de la démocratie en organisant une force armée indépendante, sans lien aucun avec les institutions démocratiques. Nous voulons parler de la Garde Populaire, à laquelle nous n’avons, jusqu’à présent, touché qu’incidemment. L’organisation de la Garde Populaire nous dévoile les arcanes de la démocratie menchevique. Elle était soumise directement au président de la République et se composait de partisans du régime, triés sur le volet et parfaitement armés. Kautsky le sait : « Seuls — dit-il — les camarades éprouvés et organisés pouvaient recevoir les armes. » En sa qualité de menchevik éprouvé et organisé, Kautsky lui-même fut incorporé à titre honorifique dans la Garde Populaire géorgienne. Voilà qui est touchant ; pourtant l’organisation d’une garde se concilie bien peu avec la démocratie. Dans sa polémique contre les bolcheviks, Kautsky écrit dans la même brochure : « Si le prolétariat ou le parti du prolétariat n’a pas le monopole de l’armement, il ne peut, dans un pays agricole, se maintenir au pouvoir qu’avec l’appui moral des paysans. » Mais, qu’était-ce que la Garde Populaire, sinon le monopole de l’armement entre les mains du parti menchevique ? Parallèlement à la garde armée de la dictature menchevique, on créa, il est vrai, en Géorgie, une armée sur la base du service militaire obligatoire. Mais l’importance de cette armée était presque nulle. Au moment du renversement du menchevisme (février et mars 1921), l’armée nationale ne participa presque pas aux engagements et, règle générale, passa aux bolcheviks ou simplement se rendit sans combat. Peut-être Kautsky a-t-il là-dessus d’autres renseignements. Qu’il nous les communique. Mais, avant tout, qu’il explique pourquoi il fallait une force armée prétorienne soigneusement sélectionnée si la démocratie géorgienne s’appuyait uniquement sur les sympathies des masses laborieuses ? Pourquoi ce monopole de l’armement entre les mains des mencheviks éprouvés et des partisans patentés du régime ? Là-dessus, Kautsky garde le silence. Macdonald, on le sait, a pour règle de ne pas se casser la tête à approfondir les questions de la révolution, d’autant plus qu’en Angleterre il est habitué à voir des troupes réactionnaires mercenaires veiller à la sûreté de la démocratie. Pour les panégyristes de la démocratie menchevique, la force armée de ce régime est une bagatelle à laquelle il est inutile de s’arrêter. Toujours est-il que la Garde Populaire disposait effectivement de la plénitude du pouvoir. Avec la Police Spéciale, elle punissait ou faisait grâce, arrêtait, fusillait, déportait. Sans consulter la Constituante, elle décrétait le travail obligatoire. Ferdinand Lassalle avait déjà montré d’une façon saisissante que les canons constituent la partie essentielle de toute constitution. Comme nous le voyons, au-dessus de la constitution géorgienne s’élevait, armée jusqu’aux dents, la Garde Populaire, dont les effectifs, d’après Kautsky, se montaient à 30.000 [10] mencheviks qui opéraient, non pas avec le programme de la IIe Internationale, mais avec les fusils et les canons, cette partie la plus importante de la constitution.
Notons, en outre, qu’il se trouvait en Géorgie des troupes étrangères spécialement invitées par les mencheviks pour soutenir leur régime.
Le contre-espionnage de l’Entente, le contre-espionnage de Dénikine et de Wrangel et la Police Spéciale menchevique agissaient en commun sur un large front. Toujours au service de la Garde Populaire et des troupes d’occupation pour les besoins de la lutte contre l’anarchie, ils représentaient en somme la partie la plus achevée de la « constitution » du menchevisme géorgien.
Les 82 % des mencheviks que renfermait l’Assemblée Constituante n’étaient donc que la représentation parlementaire des canons de la Garde Populaire, de la Police Spéciale, de l’expédition militaire anglaise et de la prison cellulaire de Tiflis. Et voilà dévoilés devant nous, les mystères de la démocratie.
— Et chez vous ? nous demande la voix irritée de Mrs. Snowden.
— Chez nous, madame ? Tout d’abord, madame, si Ton compare les institutions, en tenant compte de l’étendue du pays et du chiffre de la population, Ton voit que l’appareil de la dictature du menchevisme géorgien est beaucoup plus considérable que celui du gouvernement soviétique. Pour s’en convaincre, il suffit d’une simple opération arithmétique. De plus, madame, nous avons eu contre nous tout l’univers capitaliste, qui nous a fait une guerre sans trêve, tandis que la Géorgie a été continuellement protégée par les pays impérialistes victorieux qui nous combattaient par les armes. Enfin, madame — et ceci n’est pas de peu d’importance — nous n’avons jamais et nulle part nié que notre régime fût le régime de la dictature révolutionnaire de classe et non de la démocratie pure qui, soi-disant, puise en elle-même les garanties de sa stabilité. Nous n’avons pas menti comme mentent les mencheviks géorgiens et leurs patrons. Nous sommes habitués à appeler les choses par leurs noms. Lorsque nous privons la bourgeoisie et ses valets de droits politiques, nous ne recourons pas au masque démocratique, nous agissons en déclarant ouvertement que nous réalisons le droit révolutionnaire du prolétariat victorieux. Lorsque nous fusillons nos ennemis, nous ne disons pas que ce sont les harpes d'Eole de la démocratie qui frémissent. Toute politique révolutionnaire honnête exige avant tout que l’on ne jette pas de la poudre aux yeux des masses.
[10] Le chiffre est considérablement majoré : comme toujours les menchéviks n’ont pas laissé passer l’occasion de duper une fois de plus l’honorable soldat de leur Garde Populaire.