1922 |
Entre l'impérialisme et la révolution
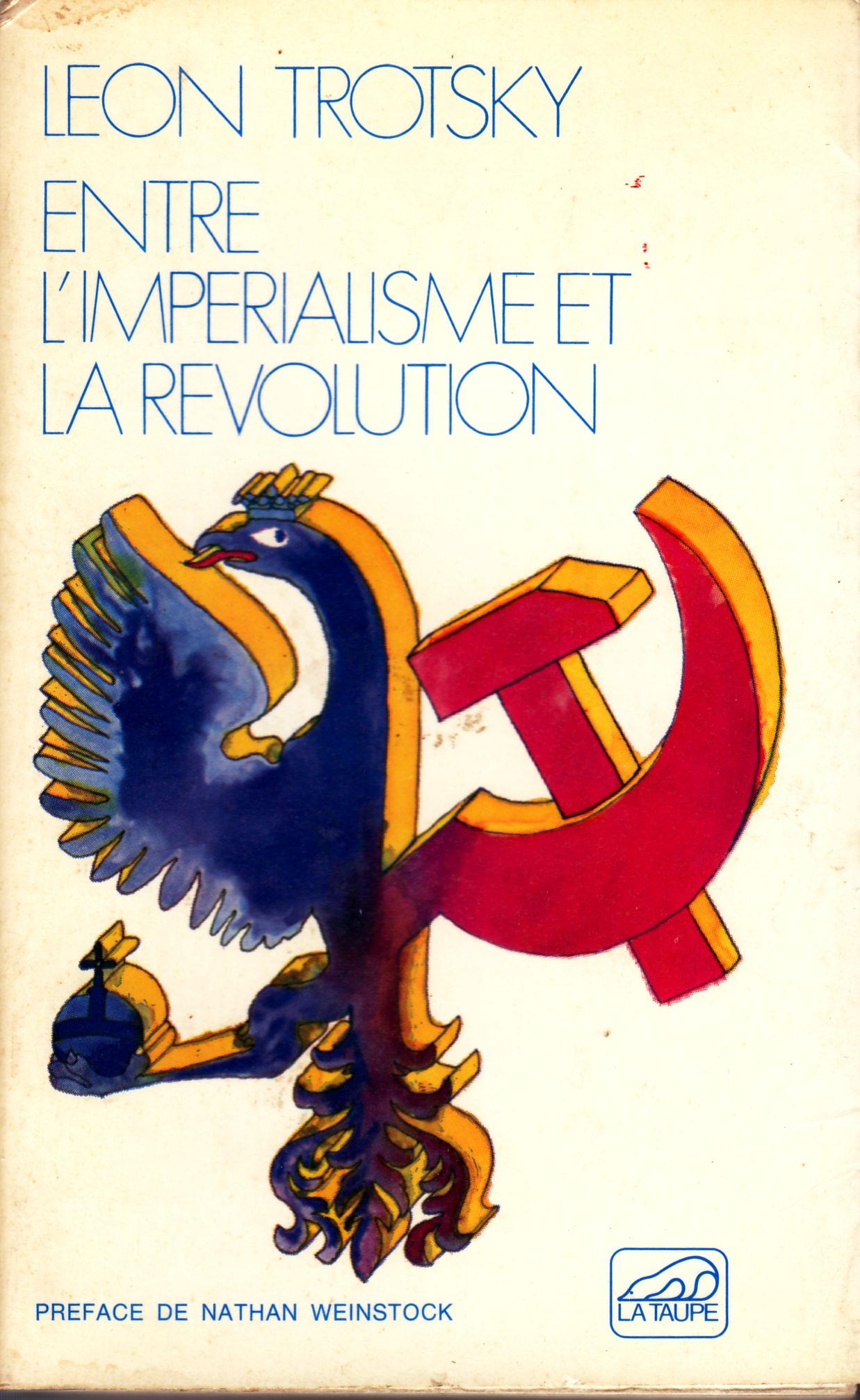
chapitre IX.
« Les puissances alliées n’ont pas l’intention de s’écarter du grand principe du droit des petits peuples à disposer d’eux-mêmes. Elles n’y renonceront que lorsqu’elles seront forcées de reconnaître qu’une nation quelconque, temporairement indépendante, par son impuissance à maintenir l’ordre, par son humeur querelleuse, par ses actes agressifs et même par l’affirmation enfantine et inutile de sa propre dignité, constitue un danger possible pour la paix de l’univers. Les grandes puissances ne toléreront pas une telle nation, car elles ont décidé que la paix du monde entier doit être sauvegardée. »
C’est dans ces termes énergiques que le général anglais Walker inculquait aux mencheviks géorgiens la conception de la relativité du droit des nations à disposer d’elles-mêmes. Politiquement, Henderson était complètement et est encore pour son général. Mais, en théorie, il est entièrement prêt à transformer le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes en un principe absolu et à l’utiliser contre la République soviétique.
Le droit des nations à disposer d’elles-mêmes est la formule essentielle de la démocratie pour les nations opprimées. Là où l’oppression de classe et de caste se complique de l’asservissement national, les revendications de la démocratie revêtent avant tout la forme de revendications pour l’égalité, l’autonomie ou l’indépendance complète.
Le programme de la démocratie bourgeoise comportait le droit pour les nations de disposer d’elles-mêmes. Mais ce principe démocratique est entré en contradiction ouverte, catégorique, avec les intérêts de la bourgeoisie des nations les plus puissantes. Il est apparu que la forme républicaine de gouvernement se conciliait parfaitement avec la domination de la Bourse. La dictature du Capital s’est emparée sans peine de la technique du suffrage universel. Mais le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes a revêtu et revêt un caractère de danger menaçant et immédiat, car il implique, en nombre de cas, le démembrement de l’État bourgeois ou la séparation des colonies.
Les plus puissantes démocraties bourgeoises se sont transformées en aristocraties impérialistes. Au moyen du peuple de la métropole, qu’elle tient en main par le régime « démocratique », l’oligarchie financière de la City étend sa domination sur une masse formidable d’êtres humains en Asie et en Afrique. La République Française, dont la population se monte à 38 millions d’hommes, n’est qu’une partie d’un empire colonial comptant actuellement jusqu’à 60 millions d’esclaves de couleur. Les colonies françaises, peuplées de Noirs, doivent fournir des contingents de plus en plus élevés pour l’armée destinée à entretenir l’esclavage colonial et à maintenir la domination des capitalistes sur les travailleurs en France même. L’impérialisme, c’est-à-dire la tendance à élargir par tous les moyens son marché au détriment des peuples voisins, la lutte pour l’accroissement de la puissance coloniale, pour la domination des mers, est devenue de plus en plus incompatible avec les tendances nationales séparatistes des peuples opprimés. Or, comme la démocratie petite-bourgeoise, y compris la social-démocratie, est tombée sous la dépendance politique complète de l’impérialisme, le programme du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes a été, en fait, réduit à rien.
Le grand carnage impérialiste a introduit des changements décisifs dans la question. Durant la guerre, tous les partis bourgeois et social-patriotes firent jouer — mais à rebours — le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Par tous les moyens, les gouvernements belligérants s’efforcèrent d’accaparer ce mot d’ordre, tout d’abord dans la guerre qu’ils menèrent les uns contre les autres, puis dans leur lutte contre la Russie soviétique. L’impérialisme allemand exploita l’indépendance nationale des Polonais, des Ukrainiens, des Lithuaniens, des Lettons, des Estoniens, des Finlandais, des Caucasiens tout d’abord contre le tsarisme, ensuite, sur une plus large échelle, contre nous. En union avec le tsarisme, l’Entente réclamait l’« affranchissement » des peuples des confins de la Russie.
La République soviétique, qui avait hérité de l’empire tsariste, soudé par la violence et l’oppression, proclama ouvertement le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et la liberté pour eux de se constituer en États nationaux indépendants. Comprenant combien ce principe était important à l’époque d’une transition au socialisme, notre parti ne le transforma pourtant jamais en un dogme absolu, supérieur à toutes les autres nécessités et tâches historiques. Le développement économique de l’humanité actuelle a un caractère profondément centraliste. Le capitalisme a créé les prémisses essentielles pour la réalisation d’un système économique mondial unique. L’impérialisme n’est que l’expression rapace de ce besoin d’unité et de direction pour toute la vie économique du globe. Chacun des grands pays impérialistes est à l’étroit dans les cadres de son économie nationale et aspire à élargir ses marchés. Son but, tout au moins idéal, est le monopole de l’économie universelle. La rapacité et le brigandage capitalistes sont maintenant l’expression de la tâche essentielle de notre époque : la coordination de la vie économique de toutes les parties du monde et la création, dans l’intérêt de l’humanité tout entière, d’une production mondiale harmonieuse, pénétrée du principe de l’économie des forces et des moyens. C’est là aussi la tâche du socialisme.
Il va de soi que le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ne saurait être au-dessus des tendances unificatrices, caractéristiques de l’économie socialiste. Sous ce rapport, il occupe dans la marche du développement historique la place subordonnée qui revient à la démocratie. Le centralisme socialiste né peut pourtant prendre immédiatement la place du centralisme impérialiste. Les nations opprimées doivent obtenir la possibilité de détendre leurs membres ankylosés sous les chaînes de la contrainte capitaliste. Combien de temps encore durera la période pendant laquelle la Finlande, la Tchéco-Slovaquie, la Pologne, etc., se contenteront de l’indépendance nationale, c’est là une question dont la solution dépend avant tout du cours général du développement de la révolution sociale. Mais l’impuissance économique de ces compartiments à cloisons étanches que sont les différents États nationaux se manifeste dans toute son étendue dès la naissance de chaque nouvel État national.
La révolution prolétarienne ne saurait avoir pour tâche ou pour méthode la suppression mécanique de la nationalité et la cimentation forcée des peuples. La lutte dans le domaine de la langue, de l’instruction, de la littérature, de la culture lui est complètement étrangère, car son principe dirigeant n’est pas la satisfaction des intérêts professionnels des intellectuels ou des intérêts nationaux des boutiquiers, mais la satisfaction des intérêts fondamentaux de la classe ouvrière. La révolution sociale victorieuse laissera à chaque groupe national la faculté de résoudre à sa guise les problèmes de sa culture nationale, mais elle unifiera — au profit et avec l’assentiment des travailleurs — les tâches économiques dont la solution rationnelle dépend des conditions historiques et techniques naturelles, mais non de la nature des groupements nationaux. La fédération soviétique créera une forme étatique extrêmement mobile et souple qui accordera entre eux, de la façon la plus harmonieuse, les besoins nationaux et les besoins économiques.
Entre l’Occident et l’Orient, la République soviétique a surgi, armée de deux mots d’ordre : dictature du prolétariat et droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Dans certains cas, ces deux stades peuvent n’être séparés l’un de l’autre que par quelques années ou même quelques mois. Pour l’immense Orient, cet intervalle de temps se mesurera vraisemblablement par des dizaines d’années.
Dans les conditions révolutionnaires où se trouvait la Russie, il suffit de neuf mois du régime démocratique de Kérensky-Tsérételli pour préparer les conditions de la victoire du prolétariat. Comparativement au régime de Nicolas II et de Raspoutine, le régime Kérensky-Tsérételli était historiquement un pas en avant. La reconnaissance de ce fait, à laquelle nous ne nous sommes, il va de soi, jamais refusés, n’est pas l’appréciation formelle, l’appréciation des professeurs, des popes, de Macdonald sur la démocratie, mais l’appréciation révolutionnaire, historique, matérialiste de la signification véritable de la démocratie. Neuf mois de révolution suffirent à la démocratie pour qu’elle cessât d’être un facteur progressif. Cela ne veut pas dire, certes, que l’on eût pu, en novembre 1917, au moyen d’un référendum, obtenir une réponse exacte de la majorité des ouvriers et des paysans, auxquels on aurait demandé s’ils considéraient avoir passé une école préparatoire suffisante de démocratisme. Mais cela veut dire que, après neuf mois de régime démocratique, la conquête du pouvoir par l’avant-garde prolétarienne ne risquait pas de se heurter à l’incompréhension il et aux préjugés de la majorité des travailleurs, que, bien au contraire, elle obtenait du coup la possibilité d’élargir et de consolider ses positions en attirant à une participation active et en gagnant à sa cause des masses laborieuses de plus en plus considérables. C’est en cela, n’en déplaise aux démocrates bornés, que consiste la signification du système soviétique.
La séparation des régions excentriques de l’Empire tsariste d’avec la Russie et leur transformation en républiques petites-bourgeoises indépendantes eut la même signification relativement progressive que la démocratie dans son ensemble. Seuls, les impérialistes et les social-impérialistes peuvent refuser aux peuples opprimés le droit de se séparer du pays auquel ils sont accolés. Seuls, les fanatiques et les charlatans du nationalisme peuvent voir dans l’indépendance nationale un but en soi. Pour nous l’indépendance nationale a été et reste encore l’étape historique, inévitable en beaucoup de cas, vers la dictature de la classe ouvrière qui, en vertu des lois de la stratégie révolutionnaire, manifeste, même au cours de la guerre civile, des tendances profondément centralistes, opposées au séparatisme national et concordant entièrement avec les besoins de l’économie socialiste rationnelle de l’avenir, méthodiquement réalisée.
Combien de temps faudra-t-il pour que la classe ouvrière se débarrasse de ses illusions sur l’indépendance nationale et se mette à la conquête du pouvoir ? C’est là une question dont la solution dépend de la rapidité du développement révolutionnaire (nous l’avons déjà signalé), ainsi que des conditions intérieures et extérieures spéciales à chaque pays. En Géorgie, l’indépendance nationale fictive a duré trois ans. Fallait-il véritablement trois ans et était-ce assez de trois ans pour que les masses laborieuses de Géorgie arrivassent à se débarrasser de leurs illusions nationales ? C’est là une question à laquelle il est impossible de donner une réponse académique. Lorsque l’impérialisme et la révolution se livrent une lutte ut humée sur chaque parcelle du territoire du globe, le référendum et le plébiscite se transforment en fiction: demandez plutôt à MM. Korfanty, Zéligovski ou aux commissions spéciales de l’Entente. Pour nous la question ne se résout pas par les méthodes de la statistique démocratique, mais par les méthodes de la dynamique i évolutionnaire. En somme, de quoi s’agit-il en l’occurrence? Du fait que la révolution soviétique géorgienne,accomplie incontestablement avec la participation active .le l’Armée Rouge (ç’aurait été une trahison que de ne i ms aider les ouvriers et les paysans de la Géorgie par la force armée, du moment que nous avions cette force innée à notre disposition), s’est produite, après une expérience politique de trois années d’indépendance nationale, dans des conditions qui lui assuraient entièrement, non pas seulement un succès militaire provisoire, mais le succès politique véritable, c’est-à-dire la faculté d’élargir et de consolider les fondements soviétiques de la Géorgie eIle-même. Et c’est précisément en cela, n’en déplaise aux pédants étroits de la démocratie, que consiste la tâche révolutionnaire.
A la suite de leurs mentors des chancelleries diplomatiques bourgeoises, les politiciens de la IIe Internationale font des grimaces ironiques lorsqu’ils nous entendent parler du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Attrape-nigauds ! Pièges de l’impérialisme rouge ! — s'exclament-ils. En réalité, ces pièges sont disposés par l'histoire elle-même qui ne résout pas les problèmes d’une façon rectiligne. En tout cas ce n’est pas nous qui transit -linons en pièges les zigzags du développement historique, car, reconnaissant en fait le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, nous montrons toujours aux masses a signification historique restreinte et ne lui subordonnons, en aucun cas, les intérêts de la révolution prolétarienne.
La reconnaissance par l’État ouvrier du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est par là même la reconnaissance du fait que la violence révolutionnaire n’est pas un facteur historique tout-puissant. La République soviétique ne se dispose nullement à substituer sa force armée aux efforts révolutionnaires du prolétariat des autres pays. La conquête du pouvoir par ce prolétariat doit être le fruit de sa propre expérience politique. Cela ne signifie pas que les efforts révolutionnaires des travailleurs — de Géorgie par exemple — ne puissent pas trouver un secours armé de l’extérieur. Il faut seulement que ce secours vienne au moment où le besoin en est préparé par le développement antérieur et a mûri dans la conscience de l’avant-garde révolutionnaire soutenue par la sympathie de la majorité des travailleurs. Ce sont là des questions de stratégie révolutionnaire et non de rituel démocratique.
La politique réelle de l’heure actuelle exige que nous accordions, par tous les moyens en notre pouvoir, les intérêts de l’État ouvrier avec les conditions découlant du fait que cet État est entouré de toutes parts par des États bourgeois national-démocratiques, grands et petits. Ce sont précisément ces considérations découlant de l’appréciation des forces réelles qui ont déterminé notre politique de concessions, de patience, d’expectative envers la Géorgie. Mais quand cette politique de conciliation, après avoir produit politiquement tous ses fruits, ne donna plus les garanties élémentaires de sécurité ; quand le principe du droit des nationalités, entre les mains du général Walker et de l’amiral Dumesnil, fut devenu une garantie juridique pour la contre-révolution qui préparait un nouveau coup contre nous, nous ne vîmes et ne pouvions voir aucun obstacle de principe à répondre à l’appel de l’avant-garde révolutionnaire de Géorgie, à faire entrer les troupes rouges dans ce pays pour aider les ouvriers et les paysans pauvres à renverser, dans le plus bref délai possible et avec le minimum de sacrifices, cette misérable démocratie qui s’était elle-même perdue sur sa politique.
Non seulement nous reconnaissons, mais nous soutenons de toutes nos forces le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes là où il est dirigé contre les États féodaux, capitalistes, impérialistes. Mais, là où la fiction de l’autonomie nationale se transforme entre les mains de la bourgeoisie en une arme dirigée contre la révolution du prolétariat, nous n’avons aucune raison de nous comporter à son égard autrement qu’envers tous les autres principes de la démocratie transformés en leur contraire par le Capital. Par rapport au Caucase la politique soviétique s’est trouvée juste également sous le rapport national : c’est ce que démontrent, mieux que tout, les rapports réciproques actuels des peuples transcaucasiens.
L’époque du tsarisme avait été une époque de pogroms barbares au Caucase. Arméniens et Tartares se massacraient périodiquement. Ces explosions sanglantes de nationalisme sous le joug de fer du tsarisme étaient la continuation de la lutte séculaire des peuples transcaucasiens entre eux.
L’époque « démocratique » donna à la lutte nationale un caractère beaucoup plus net et beaucoup plus organisé. Dès le début, des armées nationales se formèrent qui, hostiles les unes aux autres, en venaient fréquemment aux mains. La tentative de créer une République transcaucasienne bourgeoise sur les bases du fédéralisme démocratique échoua pitoyablement, honteusement. Cinq semaines après sa création la fédération se désagrégeait. Quelques mois plus tard, les républiques « démocratiques » guerroyaient déjà ouvertement les unes contre les autres. Ce seul fait suffit pour trancher la question. Car, du moment que la démocratie, à la suite du tsarisme, s’avérait impuissante à créer, pour les peuples de la Transcaucasie, des conditions de voisinage pacifique, il '"•tait évidemment nécessaire d’entrer dans une nouvelle voie.
Seul, le pouvoir soviétique a pu établir la concorde entre les nations caucasiennes. Dans les élections aux soviets, les ouvriers de Bakou et de Tiflis élisent un Tartare, un Arménien ou un Géorgien sans s’occuper de sa nationalité. En Transcaucasie, les régiments rouges musulmans, arméniens, géorgiens et russes vivent côte à côte. Chacun d’eux sent, comprend qu’il est une partie d’une armée unique. Aucune force ne parviendra à les lancer l’un contre l’autre. Par contre, tous ensemble, ils défendront la Transcaucasie soviétique contre toute agression extérieure ou intérieure.
La pacification nationale de la Transcaucasie, obtenue grâce à la révolution soviétique, est par elle-même un fait d’une immense importance au point de vue politique, ainsi qu’au point de vue de la civilisation. C’est ainsi que se crée et se développe l’internationalisme véritable, vivant, que nous pouvons opposer sans crainte aux dissertations pacifistes et vides par lesquelles les chevaliers de la IIe Internationale complètent l’action chauvine de ses patries nationales.
Le retrait des troupes soviétiques de Géorgie avec l’organisation d’un référendum sous le contrôle d’une commission mixte composée de socialistes et de communistes n’est qu’un piège impérialiste, des plus vulgaires, que l’on veut nous tendre sous le drapeau démocratique du droit des nations.
Nous laissons de côté toute une série de questions fondamentales : En vertu de quel droit les démocrates veulent-ils nous imposer la forme démocratique de consultation de la nation au lieu de la forme soviétique, plus élevée à notre point de vue ? Pourquoi l’application du référendum est-elle limitée à la seule Géorgie ? Pourquoi pose-t-on cette exigence uniquement à la République soviétique ? Pourquoi les social-démocrates veulent-ils faire un référendum chez nous alors qu’ils ne font rien d’approchant chez eux ?
Adoptons, pour un instant, le point de vue de nos adversaires, si tant est qu’ils aient un semblant de point de vue. Prenons à part la question de la Géorgie et examinons-la isolément. Le problème posé est celui-ci : création des conditions permettant au peuple géorgien d’exprimer librement (démocratiquement, mais non soviétiquement) sa volonté.
1. Quelles sont les parties contractantes ? Qui assure l’exécution effective des conditions de l’accord : d’une part, vraisemblablement, les républiques soviétiques alliées ; mais de l’autre ? Ne serait-ce pas la IIe Internationale ? Mais où est la force matérielle dont elle dispose pour assurer l’exécution de ces conditions ?
2. Si même l’on admet que l’État ouvrier passe un accord avec... Henderson et Vandervelde et que, conformément aux clauses de cet accord, l’on crée des commissions de contrôle composées de communistes et de social-démocrates, comment faire avec la « troisième » force, avec les gouvernements impérialistes ? N’interviendront-ils pas ? Est-ce que les valets social-démocrates répondent de leurs patrons ? Mais où sont les garanties matérielles ?
3. Les troupes soviétiques doivent être retirées de Géorgie. Mais la frontière occidentale de la Géorgie est formée par la mer Noire. Or, les navires de guerre de l’Entente dominent cette mer sans contrôle. Les débarquements des gardes-blancs effectués par les navires de l’Angleterre et de la France sont trop bien connus de la population du Caucase. Les troupes soviétiques s’en iront, mais la flotte impérialiste restera. Pour la population géorgienne, cela signifie qu’elle doit chercher à tout prix un accord avec le maître véritable de la situation — avec l’Entente. Le paysan géorgien devra se dire que, quoiqu’il préfère le pouvoir soviétique, du moment que ce pouvoir est forcé, pour certaines raisons (évidemment, par suite de sa faiblesse), d’évacuer la Géorgie, malgré la menace permanente que fait peser sur ce pays l’impérialisme, il n’a, lui, paysan géorgien, qu’une chose à faire : chercher des intermédiaires entre lui et cet impérialisme. N’est-ce pas ainsi que vous voulez faire violence à la volonté du peuple géorgien et lui imposer les mencheviks ?
4. Ou bien va-t-on nous proposer de faire sortir de la mer Noire les navires de guerre de l’Entente ? Qui le proposera ? Les gouvernements de l’Entente ou Mrs. Snowden ? Cette question a une certaine importance. Nous demandons des éclaircissements.
5. Où seront dirigés les navires de guerre : dans la mer de Marmara ou dans la Méditerranée ? Mais, du moment que l’Angleterre est maîtresse des Détroits, cette distance n’a aucune importance. Quelle est donc l’issue ?
6. Peut-être pourrait-on fermer à clé les Détroits ? Et peut-être, par la même occasion, en remettre la clé à la Turquie ? Car le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, n’implique nullement pour la Grande-Bretagne le droit de tenir en mains les Détroits, Constantinople, la mer Noire et, par suite, tout le littoral, surtout si l’on considère que notre flotte de la mer Noire nous a été volée par les bandits blancs et se trouve aux mains de l’Entente.
Et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Nous avons consenti à poser la question ainsi que cherchent à la poser nos adversaires, c’est-à-dire sur le terrain des principes et des garanties démocratiques. Et il en ressort qu’on cherche à nous tromper de la façon la plus impudente : on exige de nous le désarmement matériel du territoire soviétique et, comme garantie contre les usurpations et les coups d’État des impérialistes et des gardes-blancs, l’on nous propose... une résolution de la IIe Internationale.
Serait-ce qu’aucun danger impérialiste ne menace le Caucase ? Mrs. Snowden n’a-t-elle pas entendu parler du naphte de Bakou ? Bien possible que non. En tout cas, nous pouvons l’informer que la voie de Bakou passe par Tiflis. Ce dernier point est le centre stratégique de la Transcaucasie, chose que n’ignorent pas les généraux anglais et français. Au Caucase, il existe actuellement des organisations conspiratives de gardes-blancs sous la dénomination solennelle de « Comités de libération » et autres, ce qui ne les empêche pas de toucher des subventions pécuniaires des propriétaires de naphte anglais, des propriétaires de mines de manganèse italiens, etc. Les bandes blanches reçoivent par mer des armes. La lutte est menée pour le naphte et le manganèse. Comment arriver au naphte : par Dénikine, par le parti musulman des moussavats ou par les portes de « l’indépendance nationale » dont la IIe Internationale tient les clés ; voilà qui est bien égal aux propriétaires du naphte, pourvu qu’ils arrivent au but. Dénikine n’a pas réussi à battre l’Armée Rouge ; Macdonald, se dit-on, réussira peut-être à la faire partir pacifiquement : le résultat sera le même.
Mais Macdonald n’y réussira pas. De telles questions ne se tranchent pas par des résolutions de la IIe Internationale, quand bien même ces résolutions ne seraient pas aussi pitoyables, aussi contradictoires, aussi friponnes et aussi balbutiantes que la résolution adoptée sur la Géorgie !